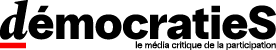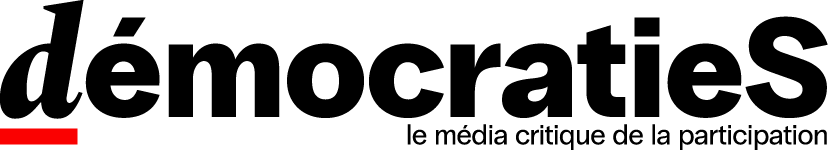Entretien avec
Stéphanie Wojcik
Maîtresse de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’université Paris Est Créteil.
Les réseaux sociaux peuvent-ils être un outil de participation citoyenne ? Incontrôlables, sans fonctionnalité délibérative à la différence des civic tech, ces plateformes numériques sont pourtant des sources essentielles pour le débat public, relève la chercheuse Stéphanie Wojcik.
Quelle place les réseaux sociaux occupent-ils dans les démarches de participation citoyenne ?
Les institutions et les organisations publiques qui utilisent les réseaux sociaux le font essentiellement pour publiciser leurs démarches de participation et pas véritablement pour impliquer les gens dans la démarche. À ma connaissance, ils ne sont pas utilisés comme des lieux de débat ou de participation des personnes.
Les organisations préfèrent avoir la main sur le dispositif qui permet l’expression des citoyens. Plutôt que de laisser la porte ouverte à une expression foisonnante, libre, encadrée par des règles de modération sur lesquelles elles n’ont pas de prise, elles utilisent des plateformes spécialement conçues pour leur consultation, leur concertation ou leur démarche de participation [déployées par les civic tech]. Elles peuvent alors en maîtriser les différentes fonctionnalités. Ces consultations sont canalisées et souvent implémentées dans un dispositif de construction d’un projet.
Même si les institutions cantonnent les réseaux sociaux à un rôle d’information, ils s’invitent d’eux-mêmes dans le débat. Quels en sont les effets ?
Les réseaux sociaux peuvent permettre de relever les « points chauds » d’un débat. Les personnes chargées de la veille d’opinion peuvent ainsi détecter des points de vigilance, qui peuvent être réinjectés, ou pas, dans le cadre d’une démarche participative. C’est surtout le cas pour des débats menés à l’échelle nationale, qui font par ailleurs l’objet d’une couverture médiatique et qui sont discutés sur Twitter ou sur Facebook, comme on l’a vu avec les gilets jaunes. C’est moins facilement observable sur les projets locaux, où les gens qui s’expriment sur les réseaux sociaux sont beaucoup moins nombreux.
Il est certain que les réseaux sociaux peuvent mettre en visibilité des sujets qui sont peu ou mal traités par l’autorité politique ou par les médias traditionnels, comme cela a été le cas avec Me Too ou Black Lives Matter. Ce sont des situations qui ne sont ni maîtrisées, ni forcément souhaitées par les institutions et qui, sous certaines conditions, peuvent ensuite rejoindre l’agenda politique.
Peut-on considérer les réseaux sociaux comme des acteurs de la démocratie ?
Oui, évidemment. Avant, il y avait la télévision et la presse écrite, qui pouvaient être, historiquement, des contre-pouvoirs. Dans les faits, ces plateformes sont devenues des lieux essentiels du débat public. Mais elles n’ont pas été conçues pour ça, n’ont pas de légitimité et leur objectif est de générer du profit, ce qui peut paraître contradictoire avec les objectifs démocratiques de permettre une expression libre et, si possible, éclairée des citoyens.
Même si ce n’est pas leur vocation, elles peuvent avoir un rôle dans la reconnaissance et l’expression de groupes marginalisés qui, jusqu’à présent, n’avaient pas ou peu la parole dans l’espace public. Elles le font même assez bien, pour le meilleur et pour le pire, sachant qu’il y a des différences importantes entre TikTok, YouTube ou Facebook.
Les réseaux sociaux ne sont pas des outils de communication au sens traditionnel du terme, ils ne sont pas neutres. Des études ont montré qu’ils peuvent favoriser tel contenu ou telle orientation politique. Ce sont des médiateurs, des instruments qui peuvent rendre visibles des contenus selon des logiques qui, parfois, échappent pour partie à leurs concepteurs.
Quel peut être l’intérêt des réseaux sociaux dans les dispositifs de participation ?
La diffusion d’informations est toujours positive. C’est un principe de communication politique : pour une institution, il vaut mieux qu’on parle de ses projets et démarches, même si c’est en mal. Les réseaux sociaux peuvent permettre de diffuser de l’information à des publics peu sensibles aux canaux traditionnels, avec le risque de voir émerger des points de vue contraires, voire fabriqués ou faux. Mais il faut être assez solide pour pouvoir supporter la critique et la contestation.
Le problème est que, sur les réseaux sociaux, les gens ne font pas de distinction entre l’information et l’opinion. Dans les médias traditionnels, normalement, l’information est vérifiée et l’opinion identifiée en tant que telle. Sur les réseaux sociaux, tout le monde a son mot à dire et peut émettre une information ou une opinion. Pour les jeunes générations en particulier, je pense que cette distinction n’est pas très claire.
Est-il possible de réguler ces plateformes pour limiter la désinformation ?
Les initiatives ne manquent pas : régulations de la part des plateformes elles-mêmes, protestations des utilisateurs, rubriques désintox dans les journaux…. Mais elles ne suffisent pas à juguler la masse d’informations fausses qui circulent et, surtout, elles n’atteignent pas forcément les publics auxquels elles sont destinées. La croyance en quelque chose de faux ne peut pas uniquement être combattue avec la publication d’une vérité. Encore plus si la vérité émane d’une institution officielle.
Peut-on parler d’un nouveau rapport à l’information ?
Une des évolutions les plus importantes est que, avec les nouvelles technologies, n’importe qui peut émettre une opinion qui sera lue par ses milliers d’abonnés, alors qu’antérieurement, elle n’aurait pas dépassé le cadre d’une soirée entre amis. Cela peut prendre une ampleur démesurée. On assiste ainsi à des possibilités de critique à l’égard du savoir académique, patiemment construit par le travail scientifique. Il y a une concurrence entre l’information et le savoir qui n’est pas toujours au bénéfice du monde académique.
Entretien réalisé par Gilles Peissel