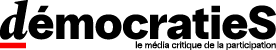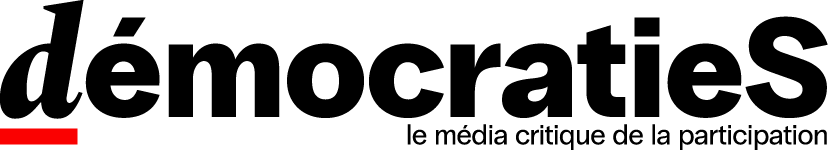Entretien avec
Alexandra Villarroel
Coordinatrice des Réseaux de Sciences Participatives au Muséum national d’Histoire naturelle
Les scientifiques ne connaissent pas la crise de participation. Au contraire, les profanes sont de plus en plus nombreux à s’investir bénévolement dans les projets de recherche. Cet essor des sciences participatives ne va pas sans un gros effort de mobilisation. Et une exigence de transparence sur la finalité et le niveau d’implication des citoyens.
Se demande-t-on, dans le domaine des sciences participatives, si les citoyens et les citoyennes veulent vraiment participer ?
Alexandra Villarroel – Non. À ma connaissance, il n’y a pas de crise de la participation dans les programmes de sciences participatives. Globalement, les citoyens qui s’investissent sont même de plus en plus nombreux. Le recrutement de bénévoles n’est pas un sujet de préoccupation pour la majorité des responsables de ces programmes.
Les observatoires de biodiversité, par exemple, mobilisent facilement. On en recense aujourd’hui plus de 150, qui regroupent au total 121 000 bénévoles. Ils n’étaient que 20 000 en 2011[1]. L’augmentation du nombre des programmes est en partie la cause de la croissance continue du nombre de citoyens engagés.
Il faut cependant nuancer ce constat. D’une part, le domaine des sciences participatives est très vaste et le Muséum national d’Histoire naturelle dispose de chiffres sur certains programmes seulement. D’autre part, tous les programmes de sciences participatives ne trouvent pas leur public. Enfin, lorsque la mobilisation des citoyens est au rendez-vous, elle n’est pas pour autant spontanée, elle doit faire l’objet d’efforts constants.
Pour cela, les organisateurs de ces programmes s’appuient sur des relais sans lesquels il serait très difficile de toucher la société civile. Il s’agit d’associations ou de sociétés savantes qui ne sont pas seulement des ambassadrices, mais des partenaires des équipes de recherche. Elles contribuent à la conception, la mise en œuvre et l’animation de ces programmes, jusqu’à en être co-porteuses. Dans la mesure où cela concourt à leurs objectifs, elles développent des activités de formation ou d’accompagnement des citoyens que les scientifiques ne pourraient pas réaliser. Leur rôle est donc déterminant. En conséquence, la première chose que font les équipes de recherche quand elles lancent un nouveau programme, c’est de tisser des partenariats avec des associations, des centres de culture scientifique ou diverses structures implantées au niveau local et qui sont en mesure de mobiliser des citoyens, de mener des activités d’animation et de s’associer avec elles pour un copilotage du programme.
Il faut ajouter que le nombre de contributeurs est parfois un critère, mais ce n’est pas toujours le cas. Certains programmes de recherche ne nécessitent pas un grand nombre de participants, comptant plutôt sur leur diversité. D’autres mobilisent des acteurs particuliers, comme les agriculteurs pour des programmes portant sur les semences, ou les familles des malades dans le domaine de la santé.
Vous employez l’expression “sciences participatives”. Quels niveaux d’investissement des citoyens, et de pouvoir d’agir, recouvre-t-elle ?
La terminologie est très diverse, en effet… L’une des classifications souvent utilisées définit trois niveaux de participation aux projets de recherche : projet contributif, projet collaboratif, et projet co-créé. On peut englober les deux premiers niveaux dans les sciences participatives ; le troisième niveau est plutôt du ressort de ce que l’on appelle la recherche participative. Cette classification permet de pointer à quelle étape de la recherche les citoyens s’investissent.
Au Muséum, les projets relèvent surtout des deux premiers niveaux, peu de projets de recherche ayant été co-créés dès le départ. Parfois les participants interviennent comme co-auteurs d’articles scientifiques, dans la définition de nouvelles questions de recherche une fois le projet lancé, ou encore dans la co-construction du protocole de recherche.
Pourquoi participe-t-on à un programme de sciences participatives ?
La première motivation, c’est l’envie de participer à l’avancée des connaissances. Contribuer à la science, c’est faire œuvre utile. Beaucoup de citoyens collectent des données en faisant des relevés botaniques, en guettant des oiseaux dans leur jardin, en identifiant des espèces d’insectes, en observant des météorites, en notant les dates d’apparition de bourgeons sur des arbres fruitiers ou en transmettant des relevés d’objets ou de lieux qu’ils estiment faire partie de leur patrimoine local. Ce sont de petits gestes répétés qui sont jugés utiles par les citoyens s’ils contribuent à alimenter des bases de données valorisées par les scientifiques afin de contribuer au bien commun : la protection de la biodiversité, l’adaptation au changement climatique, la préservation du patrimoine…
Pour que leurs attentes ne soient pas déçues, les chercheurs doivent proposer des questions de recherche claires et des protocoles robustes. Il faut également que les données soient effectivement valorisées et contribuent aux programmes de recherche. Dans le cas contraire, il s’agirait d’une fausse promesse faite aux participants. La confiance de ces derniers dans le dispositif est un maître-mot : il faut tenir les engagements qui leur sont faits. Il est également indispensable de prêter une grande attention à leurs besoins, notamment en faisant régulièrement des retours d’information. Le temps de la recherche est parfois long, une publication scientifique peut prendre des années, il ne faut donc pas craindre de discuter avec eux de résultats intermédiaires. On peut aussi diffuser des synthèses des résultats collectés sur un territoire particulier, ce qui offre aux citoyens concernés des données qui les intéressent plus particulièrement. Quoi qu’il en soit, le retour d’information est primordial et il doit être convainquant.
Un deuxième ressort de motivation des citoyens réside dans la convivialité, la création de liens sociaux, le sentiment de faire partie d’une communauté. Les rencontres sur le terrain favorisent la création de liens interpersonnels entre les équipes de recherche et les citoyens. Ce sont donc des activités importantes, qui demandent du temps mais qui sont indispensables pour maintenir la confiance dans l’utilité du programme et renforcer le sentiment d’appartenance à un réseau.
Troisième ressort de motivation : le plaisir qu’on éprouve à collecter ces données. C’est l’occasion d’admirer la nature, les étoiles ou le patrimoine… C’est sans doute pour cela que plus de citoyens sont enclins à observer les oiseaux que les lichens ou les roches !
Enfin, quatrième ressort : la montée en compétences. Les citoyens apprécient de faire progresser leurs connaissances, de s’enrichir d’un travail collectif. Les retours d’information ont donc également cet objectif : améliorer la connaissance des citoyens sur un sujet donné. Les apprentissages leur permettent de prendre davantage de responsabilités.
La collecte de données n’est donc pas la seule contribution des citoyens ?
Elle concerne un grand nombre d’entre eux mais ce n’est pas la seule façon de participer. Il existe une diversité de contributions possibles, de la collecte de données à leur analyse en passant par la formulation des questions de recherche. Certains citoyens ont des compétences professionnelles qui peuvent être valorisées, d’autres acquièrent de la connaissance grâce à ces programmes. Ils peuvent prendre progressivement plus d’initiatives et cela contribue à ce que chacun trouve sa place, se sente utile et valorisé.
Par exemple, il existe un programme qui consiste à observer la présence d’insectes pollinisateurs, que les citoyens identifient et dont ils postent des photos sur un site dédié. Certains, après échanges avec les scientifiques, ont commencé à vérifier les noms attribués par d’autres citoyens, une tâche auparavant réservée aux seuls experts du Muséum. Progressivement, les coordinateurs ont fait évoluer le protocole et permis à tous les citoyens qui s’en sentent capables de contrôler les données des autres. Désormais, on considère qu’une identification est confirmée dès lors qu’elle est validée par trois personnes, indifféremment participants ou experts. La montée en compétences des citoyens a été prise en compte et depuis lors, certains se consacrent exclusivement à valider les données.
Cela suppose, de la part des chercheurs, un certain lâcher-prise sur la détention des savoirs, une reconnaissance de l’expertise citoyenne. Ce n’est pas sans susciter des débats au sein de la communauté scientifique, à la fois sur la fiabilité des données ainsi recueillies et sur le changement que cela implique dans la posture traditionnelle du « sachant ». Dans ce domaine, on observe des avancées ainsi que des résistances parmi les équipes de recherche. Depuis quelques années, les retours d’expérience ont permis d’apaiser certaines craintes et de dépassionner les débats, même s’ils restent d’actualité.
Dans quels domaines les sciences participatives se sont-elles le plus développées ?
Historiquement, le recours aux citoyens est ancien dans les domaine de la taxonomie (la description d’espèces animales et végétales) ou de l’astronomie. Ce sont des sciences dans lesquelles on voit depuis longtemps des publications co-signées par des amateurs et des chercheurs. Plus récemment, les programmes se sont multipliés dans le domaine de la biodiversité et de la santé. Des champs nouveaux sont apparus, comme la préservation du patrimoine, l’archéologie, la transcription de manuscrits historiques, la musicologie, ou encore l’appropriation de l’espace public et des aménagements urbains. Dans les domaines qui s’apparentent à de la recherche-action, la distinction entre les sciences participatives et les dispositifs de participation citoyenne est très ténue.
Les institutions publiques s’intéressent-elles aux sciences participatives ?
Elles s’y intéressent vivement depuis plusieurs années. Les grands établissements publics de recherche reconnaissent et valorisent de plus en plus ces programmes. Ils n’y voient pas seulement un moyen d’améliorer les connaissances, ils s’intéressent aussi à la possibilité de resserrer les liens entre sciences et société. Cet objectif est louable, car ce qui était vu à l’origine comme un effet collatéral est parfois présenté aujourd’hui comme un objectif premier. De la même façon, la sensibilisation à l’environnement des citoyens, une conséquence possible de ces programmes, est parfois davantage valorisée que l’apport de ces derniers à la connaissance scientifique. Cela inverse l’ordre des objectifs, ce qui comporte un risque : celui d’instrumentaliser les citoyens, qui pourraient devenir, malgré eux, les objets de stratégies institutionnelles plus ou moins explicites.
Autre évolution en cours : l’incitation à inclure une dose de « participatif » dans certains programmes de recherche. Mais est-ce toujours utile ? Est-ce toujours correctement mené ? Cela peut constituer une incitation, mais cela peut aussi devenir une case à cocher pour le financement public d’un projet. Le risque est grand d’une routinisation de certaines pratiques et d’une perte de sens.
Pour éviter le dévoiement des pratiques, il faut faire preuve d’une transparence sans faille envers les participants. Quand un programme est mis en place, il est porté par des personnes qui peuvent avoir des objectifs différents. C’est légitime. Mais ces objectifs doivent être clairement énoncés et connus de tous, notamment des participants. La prise de conscience qu’il est nécessaire de faire preuve de rigueur gagne du terrain. Une charte a été mise en place en 2017[2], on parle de tiers veilleurs[3], des personnes qui pourraient s’assimiler aux garants de la concertation. Cela se rapproche d’évolutions en cours de la démocratie participative, signe que nous gagnerions probablement à croiser nos expériences.
Propos recueillis par Pierre-Yves Guihéneuf et Valérie Urman.