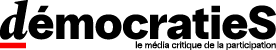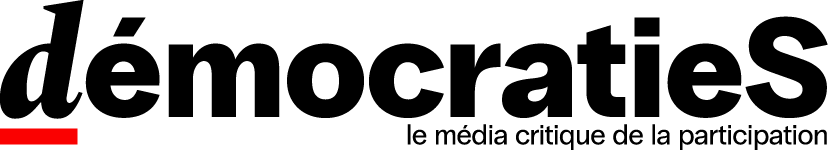par
Loïc Blondiaux
Professeur de science politique à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Donner des droits et une voix décisive à la nature dans nos institutions engage une double révolution, juridique et politique. Dans cette démocratie du vivant, se joue la survie de nos démocraties elles-mêmes, analyse le politiste Loïc Blondiaux dans l'article d'ouverture de notre dossier.
Quiconque s’intéresse au droit de l’environnement connaît aujourd’hui la chronologie des avancées récentes du mouvement de reconnaissance des droits du vivant : depuis l’article précurseur du juriste américain Christopher Stone en 1972, « Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ? » ; l’introduction dans la constitution équatorienne (2008) d’une référence au droit de la Terre mère (Pachamama), au « plein respect de son existence et au maintien et à la régénération de ses cycles vitaux » ; les reconnaissances successives de la personnalité juridique des fleuves Atrato (Colombie 2017) et Whanganui (Nouvelle Zélande 2017) ; jusqu’à l’événement qu’a été la consécration, pour la première fois en Europe, des droits d’un milieu naturel, la Lagune de Mar Menor (Espagne 2022), « d’exister en tant qu’écosystème (…) et d’évoluer naturellement »[1].
Partout à travers le monde aujourd’hui, des citoyens se mobilisent, des juristes s’engagent, des alliances se nouent dans les territoires autour de rivières, de forêts ou de glaciers afin de donner à ces entités le statut de personnes juridiques, ou de « bien communs naturels », porteurs de droits. De quoi cette révolution, dont l’issue est encore incertaine, est-elle le nom ? Qui la souhaite et qui l’entrave ? Quels en sont les enjeux, juridiques, politiques et culturels ? Que nous dit-elle des évolutions possibles de nos vieilles démocraties ? Tels sont les fils conducteurs de ce dossier publié par démocratieS.
Nous souhaiterions ardemment que soit prise aujourd’hui en France la mesure de l’ampleur, de l’urgence mais aussi de l’importance de ce changement potentiel de paradigme politique.
Révolutions juridique et politique
Ce qui se joue là est bien d’abord une évolution juridique dont l’enjeu le plus évident et le plus discuté est la possibilité de reconnaître juridiquement des autres qu’humains, lesquels, comme le rappellent à l’envi les détracteurs de ces réformes, ne peuvent ni parler ni plaider directement en faveur de leurs droits. Peut-on attribuer des droits à des entités dont tout indique qu’elles ne sauraient avoir ni devoirs, ni responsabilité ? Face à cette apparente impossibilité, les juristes qui portent ces changements ont beau jeu de rappeler que ni les entreprises, ni les associations, dont la personnalité morale est reconnue depuis le début du XXème siècle, ni les enfants ou les majeurs sous tutelle ne remplissent l’ensemble de ces caractères. Ils n’en sont pas moins porteurs de droits. Les contours du droit, miroir des évolutions sociales et politiques, pourraient dès lors très bien évoluer en faveur d’une protection particulière des milieux naturels.
Mais la révolution attendue est aussi de nature politique : comme le souligne Judith Ferrando dans son article, il s’agit à la fois de repenser les frontière du « demos », en y incluant les non humains, mais aussi de faire advenir une « démocratie de tous les affectés », selon expression de Robin Eckerseley, c’est-à-dire une démocratie dans laquelle toutes les entités, présentes et à venir, susceptibles d’être impactées par une décision politique, ont la possibilité de faire entendre leur voix et d’être défendues[2]. Cela inclut dès lors, non seulement les entités et milieux naturels, mais aussi les générations futures.
Inventer les modes de représentation
Comment penser les instruments de représentation politique susceptibles de matérialiser cette démocratie du vivant ? L’effort d’imagination à fournir est colossal et ce n’est sans doute pas un hasard si la forme parlementaire – du Parlement des choses proposé naguère par Bruno Latour au Parlement de Loire ou à l’Assemblée populaire du Rhône – est souvent, par mimétisme avec les institutions existantes, sollicitée en théorie comme en pratique. Mais d’autres configurations sont pensables : conseils de gardiens, conseils terrestres[3] ou désignation de porte-parole mandatés par les communautés concernées, comme le montrent les entretiens et articles de ce dossier (lire les entretiens avec Pascal Ferren et Myriam Ouddou). Il reviendra aux politistes, mais surtout aux citoyens concernés, de penser ces mécanismes de représentation d’un nouveau type.
Mais ces deux révolutions, juridique et politique, ne sont envisageables qu’à la condition que s’opère une troisième révolution, culturelle celle-là. Ce nouveau paradigme implique un changement de nos manières d’’être, d’agir et de penser, comme le souligne Philippe Descola. C’est parce que les cultures occidentales ont opéré depuis l’époque moderne un grand partage entre l’homme et la nature, et que les communautés humaines se sont pensées comme détachées et affranchies de leurs milieux naturels et des êtres vivants qui les composent, qu’elles se trouvent aujourd’hui menacées dans leur existence propre.
C’est la terrible leçon que nous donnent aujourd’hui les mouvements autochtones qui sont à l’origine des innovations qui se diffusent en Europe. Ce sont leurs « cosmovisions », fondées sur la reconnaissance de liens indéfectibles et souvent sacrés entre les humains et le reste du vivant, qui inspirent aujourd’hui les luttes contre les projets industriels et miniers destructeurs, ainsi que les premières décisions de justice reconnaissant les droits de la nature. Cette alliance inédite d’acteurs en lutte au nom de la préservation de leurs droits économiques, politiques et culturels et de juristes et d’activistes engagés à leur côté, fait la force de ce mouvement instituant. A leurs côtés l’on retrouve également souvent des scientifiques et des artistes, capables de se mettre à l’écoute de ces fleuves ou de ces forêts et de les faire parler.
Sources d’espérance démocratique
Mais à observer aujourd’hui les expériences qui, à l’instar du Parlement de Loire, de l’Assemblée populaire du Rhône ou du Peuple du Ciron évoquées et décrites ici par Camille de Toledo, Justin Soubanère et Alexandre Zabalza, mobilisent en France des citoyens de plus en plus nombreux autour de milieux de vie à défendre, ce qui frappe surtout c’est l’enthousiasme que cette cause du vivant rencontre chez les citoyens. Et ce, au-delà des collectifs mobilisés, auprès de tous ceux que le hasard du tirage au sort ou d’une simple exposition à ces idées lors d’une conférence confronte à ces questions. C’est ce que nous avons pu observer lors de l’Assemblée populaire du Rhône, de la Convention citoyenne parisienne sur les droits de la Seine ou de la présentation du projet de Microparlements des vivants [4]. Tout se passe comme si, au moment où les institutions classiques de la démocratie représentative déçoivent et s’effondrent, il y avait là une source d’espérance, d’autant plus précieuse en ce contexte de dégradation de notre écosystème démocratique.
Car ce qui est en jeu, ni plus ni moins, derrière ce projet d’une démocratie plus respectueuse du vivant, ce pourrait bien être la survie de nos démocraties elles-mêmes. Derrière ces luttes pour la reconnaissance des droits du vivant, il y a toujours des citoyens qui s’engagent pour obtenir le droit de participer aux décisions qui les concernent. Comme dans le mouvement en faveur des communs ou dans les initiatives municipalistes et communalistes, ce qui importe surtout c’est la possibilité d’associer les citoyens à la gouvernance des milieux naturels dont leur existence dépend.
Des mode de gouvernance incluant les citoyens
De fait, la plupart des décisions de justice qui ont reconnu les droits de la nature ont aussi débouché sur la mise en place de dispositifs de représentation et de gouvernance incluant des citoyens. Au Sud, il s’agit le plus souvent de représentants des populations autochtones. Au Nord, il pourrait s’agir de citoyens tirés au sort, comme de représentants des communautés concernées. Certes, les arrangements institutionnels qui permettent cette participation ne sont pas toujours complètement satisfaisants. Nous en sommes encore au stade de l’expérimentation. Dans ces dispositifs, à l’exemple des trois collèges chargés de gouverner et de représenter la lagune de Mar Menor en Espagne, la place des citoyens, comme celle des élus et celle des scientifiques, doit être pensée et l’horizontalité de la prise de décision garantie (lire l’entretien avec Eduardo Salazar Ortuno). Il faut également une place pour les savoirs locaux ou profanes, détenus par les usagers et les habitants vivant dans ces milieux, de façon à éclairer la décision (lire l’entretien avec Charles Stepanoff).
Il est plus que probable, et jour après jour l’actualité nous le rappelle, que nos actuelles institutions démocratiques ne survivront pas à la destruction de la biodiversité et au dérèglement climatique. La concomitance, sinon la corrélation, entre l’effondrement des écosystèmes et le délitement de nos démocraties saute aux yeux. Les processus de durcissement des conflits sociaux, l’accroissement des inégalités sociales et l’avènement de pouvoirs autoritaires ont toute chance d’être accélérés et intensifiés par la raréfaction des ressources naturelles. Continuer de laisser le pouvoir de décision sur le vivant aux seuls représentants issus de l’élection, eux-mêmes sous l’influence d’intérêts économiques et financiers de court terme, est une folie dont nous commençons à constater les effets.
Donner une voix politique
Dans une logique suicidaire, la plupart des gouvernements aujourd’hui au pouvoir ont décidé, soit de tourner le dos et d’ignorer la question environnementale, ravalée au rang de question secondaire, soit d’aggraver la situation en intensifiant les processus de destruction de la planète, dans le sillage de Donald Trump. Qu’en serait-il si les citoyens avaient une possibilité réelle d’être informés sur l’état du vivant (ce que les médias aujourd’hui ne leur permettent pas), d’en comprendre les mécanismes (à travers la médiation des scientifiques), de s’en rapprocher (grâce à la sensibilisation par des artistes ou des passeurs de savoirs indigènes) et d’influencer réellement les décisions le concernant ? Toutes les expériences menées jusqu’à présent autour de la démocratie du vivant ont montré que l’implication directe des citoyens les amène inéluctablement à se positionner en faveur du vivant et à s’engager politiquement pour lui.
A l’inverse, l’extractivisme décomplexé, la mise en coupe réglée des milieux, la recherche effrénée du profit et de la croissance resteront la norme, tant qu’une voix politique ne sera pas donnée au vivant et aux communautés humaines qui en dépendent pour leur survie. Au-delà des seuls peuples autochtones, les premiers concernés et les premiers engagés, il y a tous ceux et celles qui sont à la fois exclus des richesses et du pouvoir politique, les populations les plus pauvres et aussi les plus exposées aux risques naturels et climatiques. Les droits de la nature et les droits humains sont inextricablement liés. Derrière la nature que l’on défend, il y aussi la démocratie que l’on étend et la participation des citoyens exclus des circuits de pouvoir et de richesses, que l’on rend possible.
La démocratie du vivant est bien l’avenir de nos démocraties.