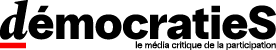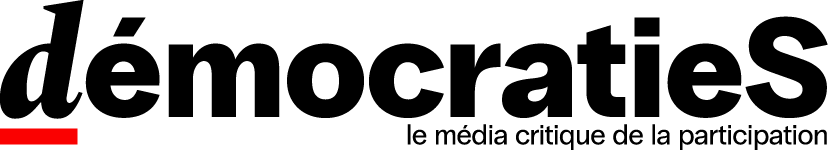par
Judith Ferrando y Puig
Sociologue, co-directrice de Missions Publiques
Accueillir les voix du vivant et des générations futures dans les dispositifs de participation publique est un enjeu de revitalisation de la démocratie, fait valoir Judith Ferrando y Puig, praticienne et sociologue.
Les citoyennes et les citoyens, au sein des dispositifs délibératifs sur la transition écologique, partagent des aspirations convergentes : des modes de vie plus simples et plus sains, une vie en proximité plus collective et de forte intensité sociale, une société reconnectée à la nature. Des années de démarches participatives le montrent[1] : ils butent sans cesse sur la conciliation difficile, voire impossible, de ces aspirations avec les injonctions de croissance économique et matérielle qui dominent nos sociétés d’hyperconsommation. Comment dépasser cette problématique posée à chacune des assemblées citoyennes successives ? Comment pousser plus loin des compromis collectifs dans un monde fini[2] ? Le changement parait insurmontable, l’effort à consentir insupportable, si l’on n’envisage pas les bénéfices possibles pour les générations à venir et pour l’ensemble du vivant.
Que pouvons-nous proposer en tant que praticiens de la participation publique ? Nous avons souvent une faible marge de manœuvre sur la question posée au panel par les décideurs publics. En revanche, nous pouvons, et devons, intégrer un moyen de penser le temps long tout en donnant la possibilité de construire un récit collectif ouvert sur l’action. Je vous livre ici quelques retours d’expériences menées à Missions Publiques.
Elargir le champ de conscience des participants
Il ne suffit pas de brandir des statistiques alarmantes sur la 6ᵉ extinction de masse ou de disposer de projections climatiques à cent ans. Il faut d’abord élargir le champ de conscience des participants pour y faire entrer le vivant non humain (la biodiversité, les milieux naturels) ainsi que celles et ceux qui n’ont pas encore voix au chapitre : les générations qui hériteront de nos choix.
Un exemple : la démarche de visualisation guidée, développée par Missions Publiques, est inspirée des traditions amérindiennes. Depuis 2010, sous la houlette d’Yves Mathieu, des assemblées citoyennes sont invitées à entrer en dialogue avec la « septième génération » – ces êtres humains qui auront 30 ans en 2140 – pour formuler la question qu’ils voudraient leur poser. Après un échange virtuel, les participants rapportent leurs messages clés dans la délibération présente, réorientant le débat vers les impacts de nos décisions sur un horizon radicalement différent de l’échéance électorale.
D’autres voies sont possibles : la marche-découverte de la faune et de la flore urbaines, ou l’exercice de totémisation proposé par l’association italienne La Prossima Cultura, qui visent à instaurer un lien empathique avec le vivant. Ou encore les approches artistiques : vidéos immersives, chant des baleines, sons des plantes, poésie visuelle… En faisant ressentir, et pas simplement conceptualiser, la fragilité des écosystèmes, ces expériences sensibles ouvrent la voie à une délibération moins abstraite et plus incarnée.
Des jeux de rôle pour faire entendre les invisibles
Au-delà de la mise en conscience, il s’agit aussi d’élargir le chœur des voix délibérantes par l’usage de personae non humaines et futures. Lors de l’atelier de la Relève organisé en juin 2023 par la Commission nationale du débat public sur l’eau potable en Île-de-France, 62 jeunes ont été répartis en trois catégories de personnages : habitantes et habitants de 2060 ; actrices et acteurs socio-économiques futurs ; espèces non humaines (épinoche, iris des marais). Munis de cartes descriptives, ils ont adopté ces points de vue pour anticiper les tensions d’usage entre baignade, qualité de l’eau et préservation de l’étiage [niveau d’eau minimal en été] nécessaire à la biodiversité. Ces sujets ne sont sortis que dans les groupes ayant joué ces personae non humaines. Ce décentrement a révélé des conflits potentiels que les débats classiques auraient ignorés.
Dans un autre registre, les Rencontres annuelles des agences d’urbanisme d’octobre 2024 ont permis à une quarantaine d’élu·e·s et d’expert·e·s de se glisser, le temps d’un jeu de rôle, dans la peau du tilleul, de la chauve-souris noctule ou d’un habitant de 2144 pour repenser les espaces publics de Tilques, dans le Pas-de-Calais. Après une déambulation sensible, chaque groupe a formulé des propositions d’aménagement (où leur personnage se sentirait bien), dévoilant des visions divergentes entre muséification de la nature et reconnaissance d’une personnalité juridique ; entre une approche décorative de la nature en centre-ville (ou symbolique, avec un hôtel à insectes) ou au contraire des corridors réservés dans les franges de la ville à une biodiversité en liberté, sans humains… ni chiens domestiques.
Ces expériences montrent l’intérêt de combiner des approches mêlant données scientifiques, intelligence collective, créativité, arts. Le mouvement des droits de la nature et l’approche de la justice intergénérationnelle fournissent un socle conceptuel, mais ils peinent à se traduire dans le cadre strict des assemblées citoyennes. Et surtout, ils sont souvent développés séparément[3]. Loin de se substituer à l’argumentaire rationnel, ces « artifices d’inclusion »[4] facilitent l’émergence d’une empathie durable, indispensable à la mise en place de critères de justice plus larges. Ils aident, comme l’écrit Réjane Sénac, à « penser la cohabitation la plus juste des intérêts, potentiellement divergents, des différentes espèces humaines et non humaines »[5].
Vers une démocratie du vivant et des futurs possibles
En intégrant explicitement le vivant non humain et les générations futures, ces dispositifs ouvrent un nouveau paradigme de la participation : ils transforment des citoyens passifs en acteurs d’une délibération plurielle et capable de revisiter nos priorités. En incorporant cette perspective dans le processus de délibération, nous pouvons élargir les critères de justice pour apporter des réponses plus claires à des questions vertigineuses : qu’est-ce qui est essentiel pour l’humanité et son avenir ? Que sommes-nous prêts à changer ? Qu’est-ce qui doit être abandonné, créé, amplifié, soutenu, et pourquoi ?
Ces détours ne prétendent pas parler à la place d’un chêne ni représenter pleinement l’intérêt des habitantes et habitants de 2140. Ils visent à enrichir notre cadre de référence.
Pour autant, la démocratisation du temps long ne doit pas s’opposer aux combats en cours pour l’inclusion des publics contemporains. L’accueil des divers registres d’expression – colères, paroles d’enfants, voix de quartiers marginalisés, initiatives citoyennes – demeure un défi majeur. L’appropriation des savoirs dans un contexte d’inégalités liées aux origines sociales, ainsi que l’accessibilité de l’information, sont indissociables de toute innovation délibérative. Sans elles, les voix de la nature risqueraient d’être mises en concurrence symbolique, alors même que les premières expériences de reconnaissance juridique d’entités naturelles montrent qu’elles concourent à la protection des populations, notamment les plus fragiles. C’est le cas en Equateur où l’interdiction du chalut, sur le fondement des droits de la nature inscrits dans la Constitution, protège les pêcheurs traditionnels. De même, la cour constitutionnelle espagnole a validé la loi de la Mar Menor, contestée, estimant que les nouveaux droits de la lagune renforcent les droits humains en défendant un milieu de vie sain.
Nous rêvons, à Missions Publiques, d’accompagner une assemblée citoyenne composée de trois corps : un tiers de citoyens – ou pourquoi pas de décideurs – parlant en tant qu’humains d’aujourd’hui, un tiers parlant au nom des générations futures et un tiers parlant au nom du vivant non humain. Nous en avons expérimenté une version pilote, sur une demi-journée, en avril 2024 à Barcelone, lors d’un évènement onusien[6].
Prolonger ces expérimentations implique de réfléchir à de nouvelles architectures participatives. Cela nécessite de repenser la gouvernance publique et privée, en intégrant les enjeux de long terme dans la délibération entre décideurs, au sein des assemblées élues, des conseils d’administration[7]…
Cela adresse, enfin, la question du « qui » en politique, alors que le demos[8] dans nos sociétés d’hier et d’aujourd’hui a déjà mis longtemps à intégrer femmes et esclaves comme sujets et non comme objets. Si le demos de demain intégrait les vivants non humains et les générations futures ? Cet élargissement esquisse une « permadémocratie » – à l’image de la permaculture favorisant des sols vivants – où la coopération des voix plurielles enrichirait le débat et assurerait la robustesse des décisions face aux aléas.