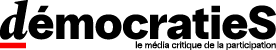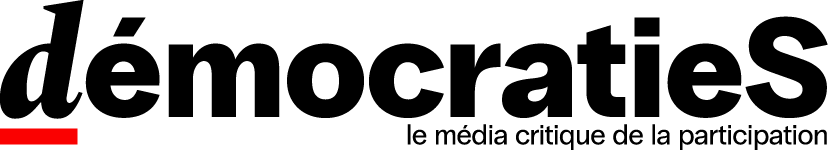Entretien avec
Ilaria Casillo
Ancienne vice-présidente de la Commission nationale du débat public
Garante du droit à l’information des citoyens, la Commission nationale du débat public incarne la démocratie environnementale. Mais elle souffre d’un défaut de compétences techniques, et surtout du manque de temps qui « affecte lourdement la qualité de l’information », analyse la vice-présidente, Ilaria Casillo.
Selon Chantal Jouanno, qui a présidé la Commission nationale du débat public (CNDP), « la grande faille dans le débat aujourd’hui est le droit à l’information des citoyens »[1]. Comment garantir ce droit ?
Le premier piège est de considérer les citoyens comme des verres vides qu’il faut remplir. Il faut arrêter cela. Nous sommes plutôt face à des montagnes de savoirs, de fausses croyances, de lieux communs, de connaissances, qu’il va falloir explorer, arpenter, contourner… Nous devons donc à la fois préparer et diffuser des données techniques, mais aussi organiser la manière dont d’autres informations nous viennent du reste de la société, pour faire un tour pluriel et contradictoire de la question en débat.
Le second piège est la fausse accessibilité, il ne suffit pas de rendre disponible l’information. Cela concerne le travail de « traduction » et de simplification des données techniques. Dans le débat sur l’ouverture d’une mine de lithium[2], nous exposons le procédé d’extraction, l’acheminement des matériaux : on explique comment ça marche. Or, l’objectif est toujours de passer de comment ça marche – la technique- à qu’est-ce que ça change – le politique. Qu’est-ce cette extraction du lithium change pour mon environnement ? Pour mon portefeuille ? Pour ma santé ? Cela exige de rendre l’information compréhensible : c’est cela l’effectivité du droit à l’information. Parfois on y arrive, parfois non. Lors du débat sur l’éolien en mer, on a eu recours à des youtubeurs spécialisés dans la vulgarisation des sciences pour nous aider dans ce travail d’accessibilité de l’information.
Diriez-vous que la qualité de l’information évolue de façon satisfaisante ?
On ne peut pas faire abstraction du problème de temps, c’est un poids énorme. Chaque fois pour les mêmes raisons : l’impératif de l’urgence, la vitesse et l’accélération des projets. La précipitation – parfois du gouvernement, parfois des maîtres d’ouvrage – fait obstacle à l’information qui a besoin de temps pour circuler, pour être cumulative et pour répondre aux besoins des acteurs.
Pour évaluer les effets de parcs éoliens ou d’autres projets, il faudra peut-être attendre une année pour savoir comment des espèces animales se comportent. L’information qui aide à décider, celle qui éclaire, a besoin d’un temps d’installation, de simplification, puis d’appropriation. Comment voulez-vous informer toute la société sur des sujets majeurs en deux mois ?
Cette question du temps affecte lourdement la qualité de l’information, pour nous comme dans toute la sphère publique.
Des réformes récentes – comme la loi Industrie verte ou la loi de simplification et d’accélération de l’action publique (ASAP) – raccourcissent les procédures. Au détriment de l’information et de la participation ?
La rhétorique de la vitesse, qui accompagne certaines réformes, est problématique. On confond procédures et respect des droits. Comprimer des droits, les rétrécir au nom de l’accélération de procédures, c’est dangereux pour la garantie des droits. In fine, c’est dangereux aussi pour la transparence des projets, pour la protection de l’environnement, pour la qualité des choix politiques.
Quelles sont les conséquences pratiques ?
La réduction des délais et l’accélération empêchent parfois de faire le tour complet et contradictoire de la question mise en débat. Cela touche aussi d’autres procédures, comme l’enquête publique, dans lesquelles il y a beaucoup d’informations environnementales disponibles mais qu’il faudrait pouvoir structurer, simplifier et rendre accessible en un temps record. C’est tout le paradoxe : on souffre d’un déficit d’information parce qu’on croule sous des données impossibles à exploiter. On est incapable, dans ces cas-là, de rendre effectif le droit à l’information. Des institutions comme la CNDP ou des personnes comme les commissaires enquêteurs arrivent au moins à garantir que cette information existe, mais ce n’est pas pour autant qu’elle concoure au jugement des citoyens et au choix des décideurs. C’est la différence entre le droit et l’effectivité du droit. Le mot-clé, qui devrait orienter les réformes, c’est effectivité du droit.
La CNDP, qui ne produit pas l’information, n’a pas de moyens propres pour expertiser et contrôler l’information présentée par les maîtres-d’ouvrage. Cela complique-t-il sa mission ?
Oui, une des pistes d’amélioration est d’internaliser des expertises, notamment sur la biodiversité, l’eau, l’énergie. Nous en avons besoin lors de l’instruction des dossiers, et lors du débat pour mieux organiser le passage du « comment ça marche » à « qu’est-ce que ça change ». Nous travaillons avec des collectifs de chercheurs qui nous aident à cadrer les termes du débat, mais c’est insuffisant.
Il semble inconcevable que la démocratie environnementale ne dispose pas des compétences techniques sur les sujets cruciaux. Voilà une idée de réforme.
Certains pays, comme le Canada, font le choix d’une instance produisant des études d’impact, une information indépendante et non à la main du maitre-d’ouvrage. Est-ce une voie intéressante ?
L’information n’est pas laissée à la main des maitres d’ouvrage. La CNDP en est garante et valide l’information produite par le maître d’ouvrage ; de plus, elle collecte un grand nombre d’autres informations, de sources très diverses. Cela a déjà été le cas pour plusieurs débats, notamment sur les déchets radioactifs. Je crois préférable de diversifier les sources plutôt que produire nous-même l’information, pour préserver notre devoir de neutralité.
Lors du débat sur la mine d’or en Guyane, le procédé de cyanuration a été mis en doute par le public qui a mis en avant des alternatives. Dans ces cas-là, la CNDP a le pouvoir de diligenter des expertises complémentaires qu’elle finance. C’est fondamental pour outiller la critique sociale qui émerge des débats. Le système français dispose d’outils adaptés.
Le modèle canadien, c’est celui d’une institution – le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) – qui organise des audiences contradictoires très formelles, codifiées par la procédure. Son point fort, c’est l’expertise interne [lire notre article sur le cas canadien]. Le modèle français, quant à lui, est à cheval sur la procédure environnementale et le processus démocratique : il incarne la démocratie environnementale. C’est sa singularité et, je trouve, sa force.
La CNDP va sur le terrain, essaye d’embarquer le plus grand nombre de personnes et de représentants des corps constitués et de la société civile organisée. Par exemple, lors du débat sur la Politique agricole commune, nous avons visité des fermes, nous sommes allés dans de très petits villages pour réunir des militants de la FNSEA, de la Confédération paysanne, de la Coordination rurale, des associations écologistes : des personnes qui ne se parlent pas habituellement et qui sont des relais démocratiques à embarquer dans le débat.
Nous agissons dans la conviction que les procédures environnementales que nous menons sont d’abord un exercice démocratique, ce serait fort dommage de se passer de cette dimension-là.
Le débat public sur l’ouverture d’une mine de lithium s’est tenu sans étude d’impact disponible. Est-ce acceptable ?
Depuis 2016, la loi pose le principe, sain, d’une participation le plus tôt possible afin de pouvoir débattre aussi de l’opportunité même du projet, quand toutes les options sont encore possibles y compris l’abandon. Le désavantage, en effet, c’est que vous n’avez pas encore toutes les informations.
L’opportunité est-elle loyalement mise en débat quand la puissance publique fait bloc, du préfet au gouvernement, jusqu’au chef de l’État qui a annoncé l’ouverture de la mine ?
La loi est très claire : le débat public doit permettre de discuter de l’opportunité du projet, de ses impacts, de ses caractéristiques. Ces trois éléments ont été mis en débat, nous n’empêchons personne d’exprimer son opposition au projet ou de remettre en question la place du lithium dans la politique énergétique française. Toutes les contributions sont versées au décideur, c’est à lui de pondérer et de décider. Que le décideur donne sa position, c’est une bonne chose dans le débat. C’est catastrophique s’il laisse entendre que le projet est déjà décidé, cela alimente la défiance.
Le bilan[3] du débat public sur l’éolien en mer insiste sur les lacunes de l’information. Que retenez-vous ?
Le déficit d’information est l’élément que le débat public a le plus mis en exergue. Il a mesuré ce que l’on sait, les études sont limitées, et tout ce que l’on ne sait pas. Il a pointé l’énorme effort de recherche scientifique à consentir. Les pêcheurs, aussi, ont fait valoir ce qu’ils observent sur le terrain, contribuant à montrer que des savoirs divers, pas seulement des données scientifiques, doivent être intégrés à la décision.
On n’a jamais construit 50 parcs marins sur les quatre façades maritimes françaises, il n’y a pas encore d’informations à cette échelle. A quel moment aura-t-on assez d’éléments pour prendre des décisions ? Ce débat montre la complexité qui nous attend car il faudra composer avec une incertitude continue et des ajustements au fur et à mesure que les connaissances arrivent. Cela exige d’autres systèmes de décision. C’est un sacré défi, le débat public l’a exposé clairement : le décideur ne pourra pas dire qu’il ne savait pas.
Propos recueillis par Valérie Urman