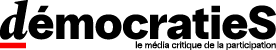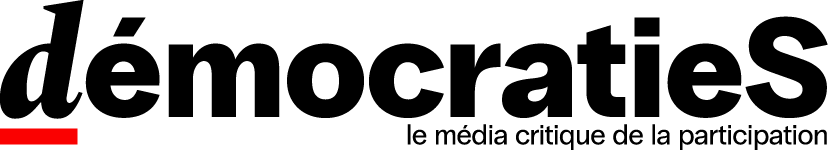Entretien avec
Guillaume Petit
Politiste, spécialiste de l’engagement démocratique.
Difficile de mobiliser au-delà des citoyens disponibles, éduqués, engagés... Les faits sont têtus, analyse le politiste Guillaume Petit, car ils reflètent des inégalités sociales et politiques que les démarches participatives ne peuvent, à elles seules, dépasser. Le chercheur pointe des facteurs d'amélioration, mais aussi l'enjeu de reconnaître des formes de participation citoyenne aujourd'hui disqualifiées.
On dit que les citoyens séduits par la démocratie participative sont toujours les mêmes. Est-ce vrai ?
Guillaume Petit – Celles et ceux qui s’engagent dans la démocratie participative ne sont pas à l’image de la diversité de la population, c’est une réalité. C’est le cas par exemple dans les conseils de quartiers mais plus largement dans les ateliers, les débats publics et tous les dispositifs de démocratie locale basés sur le volontariat du public.
Dans tous ces cas, le profil type du participant est une personne plus âgée que la moyenne, avec un niveau de diplôme plus élevé. Elle appartient à une catégorie sociale relativement favorisée et elle est intéressée par la chose publique. On observe aussi un effet fort du fait d’être propriétaire et de vivre depuis longtemps dans la commune ou le quartier. Les retraités en recherche d’utilité sociale ou désireux de maintenir un réseau de relations constituent un contingent important.
La disponibilité dont on dispose quand on est en retraite facilite le bénévolat. Il est vrai que pour assister à ces réunions, il faut avoir du temps et que, pour nombre de personnes professionnellement actives ou ayant des obligations familiales, c’est une limite importante. Mais cela n’explique pas tout. Parmi ces retraités, dont une part importante est formée de pré-retraités, on remarque en effet que ceux et celles qui participent étaient ou sont actifs par ailleurs, que ce soit dans le cadre de leur travail ou parce qu’ils ou elles ont une activité syndicale ou associative.
A contrario, les raisons de la non-participation sont multiples : les personnes dont la situation est instable, voire précaire, ou celles qui sont dans une période de mobilité professionnelle ou résidentielle, participent très peu. C’est aussi une question de posture et d’habitudes : participer s’apprend et celles de ces personnes qui se trouvent ou qui se sont trouvées, dans leur vie personnelle ou professionnelle, dans des situations de subordination ou de dépendance, sont moins enclines à s’investir et à participer activement. Certaines sont moins facilement sollicitées du fait de leur isolement. D’autres encore craignent de ne pas se sentir en phase avec les autres, du fait de leur faible insertion dans les réseaux d’interconnaissance locaux. Enfin, certaines personnes ont une vision de la vie politique qui fait une place à la participation, quand d’autres préfèrent déléguer et affirmer leur attachement aux représentants élus.
L’exclusion ou l’auto-exclusion peuvent donc s’expliquer par de très nombreuses raisons : l’absence de sollicitations, le manque de temps, le désintérêt pour le sujet, le défaut de confiance dans les institutions, le sentiment de ne pas être capable ou légitime… Tous ces facteurs sont – en partie au moins – le reflet d’inégalités dans la société. Si on souhaite promouvoir durablement la participation citoyenne, il faut réfléchir à notre politique éducative, à l’insertion de chacun dans les organisations collectives, au ratio temps de travail et temps libre, aux façons d’habiter et de consommer, à la reconnaissance sociale de la participation, aux moyens de recréer de la confiance dans la chose publique, etc.
Mais le recrutement ne fait pas tout. Il ne suffit pas d’avoir des participants divers dans une même assemblée. Il faut également veiller à ce que chacun puisse prendre la parole, que les arguments de tous soient pris en considération de la même manière. Ce n’est pas évident, même si l’animation se veut « bienveillante ».
À ce sujet, est-il pertinent de réserver des espaces de parole à certains publics éloignés ?
Pourquoi pas. Il existe en effet des dispositifs non-mixtes, composés délibérément de certaines catégories de personnes, par exemple des personnes en situation de précarité économique ou, dans des cercles militants, des personnes racisées. Cela présente l’intérêt de faciliter la prise de parole des uns et des autres puisque les participants – parce qu’ils partagent des conditions d’existence communes ou similaires – sont alors davantage entre égaux, sans les rapports de domination que l’on peut observer dans les dispositifs habituels, où les mieux dotés sur le plan culturel ou social limitent de fait l’expression des autres.
Ces dispositifs non-mixtes peuvent donc contribuer à une prise de confiance progressive des personnes concernées. Je dirais qu’idéalement, ils constituent une étape préalable dans un processus plus long, au cours duquel la mixité finit par retrouver sa place. Cette articulation serait une solution pour, d’une part, éviter les accusations de communautarisme ou de subversion d’un cadre dit républicain et, d’autre part, limiter la tentation d’une participation à plusieurs vitesses où se côtoient des dispositifs pour certaines catégories de personnes et d’autres pour le reste de la population. C’est ce que l’on observe parfois avec la participation en ligne.
Pour assurer la diversité des participants, le tirage au sort est-il une solution ?
On voit en effet se diffuser des pratiques, comme la mise en place de conventions citoyennes, à la suite des jurys citoyens, qui passent par le tirage au sort. Mais ce n’est pas une solution miracle. Les taux de réponse des personnes sollicitées sont faibles, de l’ordre de 3 à 5 %. Les organisateurs ont souvent recours à des quotas et des échantillons stratifiés plutôt qu’à un tirage au sort purement aléatoire, afin de constituer un panel qui réponde à certains équilibres en termes de genre, d’âge, de catégories socio-professionnelles, etc. En somme, il s’agirait d’une diversité socio-démographique dont on postule qu’elle se traduit par une diversité d’intérêts et de préférences politiques. Dans la pratique, on s’aperçoit vite que s’il est relativement facile de trouver des volontaires appartenant à certaines catégories socio-professionnelles, il est beaucoup plus laborieux de remplir les quotas pour d’autres. Pour y parvenir, on va alors s’appuyer sur des « variables cachées » : quand on cherche par exemple une personne avec le profil « ouvrier », il est fréquent que l’on finisse par mobiliser un responsable syndical ou associatif, un salarié ayant eu un parcours atypique ou quelqu’un qui a un lien particulier à la thématique – en tous cas, qui n’est pas à l’image de la catégorie d’appartenance qu’on lui attribue et dans laquelle on le ou la confine.
À juste titre, les organisateurs rappellent toujours que la représentativité n’est pas un objectif et qu’il s’agit plutôt de garantir une certaine diversité au sein du panel, gage de richesse dans la discussion. C’est vrai, mais on voit que les difficultés de recrutement lors des tirages au sort renvoient aux mêmes phénomènes d’auto-exclusion que j’évoquais précédemment. Il faut donc nuancer l’affirmation qui consiste à dire que cette méthode permet de mobiliser des panels qui reproduiraient la diversité de la société.
Je ne conteste pas l’intérêt du tirage au sort en lui-même, mais plutôt son usage actuel. Autrefois, il s’agissait d’assurer une rotation des responsabilités dans la société démocratique, donc de tendre vers un « autogouvernement »[1]. Cet objectif égalitaire devrait être mis en avant, plutôt que sa capacité – qui est assez relative – à diversifier le profil des personnes mobilisées ou à constituer un échantillon à l’image de la société. Aujourd’hui, les dispositifs mobilisant un « mini-public délibératif » sont mis en place pour répondre à un besoin d’un décideur, qui ne cherche pas forcément à créer du débat démocratique mais à bénéficier d’une expertise citoyenne, un peu comme il le ferait en commandant une étude par sondage ou par focus groups. Les avis recueillis sont alors évidemment beaucoup plus construits et argumentés, mais on est loin des objectifs attribués à la participation citoyenne de « démocratiser la démocratie » ou de contribuer à une forme d’éducation permanente.
« Toujours les mêmes » : est-ce donc un constat indépassable ?
On peut se poser la question. Mais il faut également se demander dans quelle mesure cela représente un problème. Il serait dommage de limiter les objectifs de la démocratie participative au nombre ou à la diversité des participants. On peut également apprécier la qualité des contributions recueillies, les modifications apportées à un projet ou d’autres critères. Le fait qu’il y ait des « habitués de la participation » ne disqualifie pas pour autant la démocratie participative, de la même façon que le fait qu’il y ait des électeurs fidèles ne conduit pas à proposer de supprimer les élections. On peut au contraire apprécier que des institutions et leurs agents fassent vivre le principe d’un droit à la participation, quand bien même sa mise en œuvre peut s’avérer décevante. Il existe des inégalités dans la participation qui renvoient à des caractéristiques structurelles de notre société. Cela ne dispense pas de faire des efforts de mobilisation du public même s’il faut sans doute se donner des objectifs réalistes et savoir ne pas se bercer d’illusions. Repenser collectivement nos façons de travailler, de s’éduquer ou d’habiter pourrait avoir bien plus d’impact démocratique que toutes les démarches de facilitation de la participation aux dispositifs participatifs.
Comment remédier au manque de confiance envers les institutions ?
La principale mesure à recommander est de faire en sorte que les processus participatifs aient une influence réelle sur la décision publique. Et que toutes les personnes qui y prennent part sachent où elles mettent les pieds et comprennent sur quoi et comment elles vont pouvoir agir par ce biais. Le manque d’impact est le premier motif d’insatisfaction des participants. Si on veut que ces démarches soient prises au sérieux, il faut améliorer leur caractère décisionnel (leur poids sur la décision) et leur caractère décisif (le fait qu’elles concernent des enjeux importants).
On peut aussi élargir notre champ de vision et observer les différentes formes de mobilisation du public. Par exemple, quand un projet est contesté, on voit se mobiliser des personnes qui n’ont pas nécessairement participé à la concertation préalable. Au lieu de considérer cette opposition tardive comme un échec du dialogue antérieur, on peut la voir comme une nouvelle forme de participation, une étape qui mobilise un public différent.
Le problème est qu’on dit à ce public qu’il est trop tard, que le temps du dialogue est passé, que la « fenêtre de légalité » s’est, en quelque sorte, refermée. Pourtant, il me semble que l’on gagnerait, sur le plan démocratique, à considérer ces oppositions légitimes comme une forme de participation digne d’intérêt.
Comment prendre en considération ces mobilisations citoyennes, protestataires ou tardives ?
C’est un problème de temporalité car l’organisation de la participation crée des moments d’ouverture et de fermeture. Ce réflexe de séquençage suit une logique de gestion de projets, dont la participation devient une phase. De ce fait, une partie des gens se mobilise « trop tard » ; par exemple, elles et ils vont s’exprimer sur un projet urbain seulement quand le chantier démarre. Le défi, c’est de considérer ces formes de participation comme tout aussi légitimes que celles qui se sont exprimées au bon moment, au bon endroit, de la bonne façon. Sans cela, on est à l’inverse d’une démocratie permanente. Cela est vrai des mobilisations protestataires, mais plus largement cela concerne toutes celles qui ne répondent pas à l’offre de participation parce qu’elle ne leur convient pas. La participation citoyenne a glissé vers des expériences d’intelligence collective qui façonnent une opinion dite éclairée au sein d’un espace idéal d’écoute et d’échange. Mais elle l’a fait en s’éloignant des conflits d’usage et de représentation des intérêts sociaux qui existent en dehors de la bulle délibérative.
Propos recueillis par Pierre-Yves Guihéneuf et Valérie Urman.