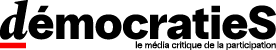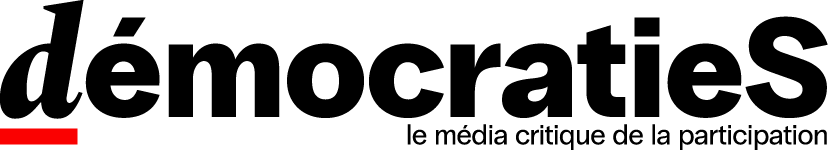Entretien avec
Guillaume Desnoës
Entrepreneur, coprésident de la Communauté des entreprises à mission
Les statuts juridiques des entreprises ne sont pas des labels de vertu, mais certains cadres favorisent la démocratisation. Pour l’entrepreneur Guillaume Denoës, la qualité de société à mission dépoussière la société anonyme classique, un minimum qui serait à généraliser à toute l’économie.
Vous avez créé l’entreprise d’aide à domicile pour les personnes âgées, Alenvi, une société anonyme avec l’agrément Esus et la qualité d’entreprise à mission[1]. Le statut des entreprises est-il révélateur de leur projet démocratique ?
La société anonyme est le statut par défaut, puisque c’est celui de 90 % des entreprises, c’est un choix naturel quand on vient comme moi d’HEC où l’on n’apprend pas l’économie sociale et solidaire et les SCOP. Nous avons créé l’entreprise à trois, pour produire de l’innovation sociale, et attirer des investisseurs pour financer l’activité pouvant transformer le secteur. C’est la pure logique capitaliste des gens qui, comme nous, apportent l’idée. On n’était pas dans la logique des travailleurs qui eux font et se groupent en société coopérative, pour mettre en commun leurs forces de travail. En créant l’activité, on ne pensait pas vraiment au partage de la valeur et à la gouvernance.
Pourquoi ces questions se sont-elles posées ?
Aujourd’hui l’entreprise compte 115 salariés, dont 80 auxiliaires de vie. On a adopté un modèle d’organisation du travail centré sur l’autonomie des salariés, fortement inspiré de Buurtzorg[2] aux Pays-Bas : il s’agit de rompre avec un management qui calcule tout, combien de temps il faut pour faire une piqûre, un pansement, qui contrôle les performances individuelles par les chiffres, pour adopter un modèle très décentralisé avec des équipes autonomes. Cela nous a porté vers une logique en opposition avec ce que l’on constatait du secteur de l’aide à domicile : l’emploi précaire, mal payé, en temps partiel subi. On est parti du principe que s’occuper d’une personne âgée est un métier compliqué, si les auxiliaires de vie sont capables de le faire, elles peuvent faire plein d’autres choses en participant à l’organisation de leur travail.
Quelles évolutions cela entraine-t-il ?
Nous avons créé une forme de travail plus collaborative. Les auxiliaires de vie, en CDI, à temps plein, travaillent dans des équipes sectorisées. Elles se réunissent toutes les deux semaines, deux heures en équipe, cela parait anodin mais très peu de services d’aide à domicile le permettent. Une partie des heures de travail est consacrée à des tâches internes, la gestion du planning, le recrutement de collègues et la formation, pour savoir évoluer en équipe autonome, apprendre la décision par consentement, savoir communiquer, etc. Cela ne résout pas tous les problèmes de ce métier, difficile par nature, mais les professionnels se montrent plus engagés.
D’autres structures, dans l’aide à domicile, se sont transformées sur ce modèle d’organisation autonome. Nous sommes aujourd’hui une soixantaine regroupés dans le collectif l’Humain d’abord[3]. C’est une dynamique précieuse dans un métier où tout le monde galère, parce que c’est compliqué de recruter, c’est structurellement difficile de bien rémunérer les gens. Et les personnes âgées vivent elles-mêmes une situation évolutive, à laquelle il faut pouvoir rapidement ajuster nos aides.
La démocratisation de l’entreprise prend quel sens pour vous, dans votre secteur ?
C’est une dynamique qui suit les phases d’évolution de l’entreprise. Nous l’avons amorcée en appuyant notre modèle d’organisation sur la coresponsabilité et l’autonomie, en ouvrant des espaces délibératifs pour les équipes de travail. Les auxiliaires discutent les pratiques d’accompagnement des bénéficiaires, au plus proche du terrain. Très vite, on a réalisé qu’on avait un souci de cohérence en ne touchant pas à la gouvernance centrale et au cadre général de l’entreprise. Nous avons alors créé un comité de pilotage partagé : cette instance intègre des représentants de chaque équipe, pour décider sur les sujets transversaux liés au cadre de travail. On a produit, par exemple, un accord d’entreprise sur la façon de gérer les heures supplémentaires.
Jusqu’où cette dynamique peut-elle aller ?
Aujourd’hui l’entreprise n’est pas organisée en cogestion. Il y a un comité de gouvernance partagée, mais il n’y a pas de salarié dans le comité stratégique où siègent nos investisseurs. Les salariés disposent d’un pouvoir d’agir sur l’organisation du travail, mais les choix stratégiques de diversification, d’investissement, sont pris par les dirigeants dans leur relation avec les actionnaires. Pour pouvoir lancer notre service d’habitat partagé pour seniors atteints d’Alzheimer, nous utilisons le schéma disponible qui consiste à se présenter devant des investisseurs et à leur demander de l’argent. Nous en sommes là aujourd’hui, c’est une démarche expérimentale et pragmatique. Dans sa phase de maturité, l’entreprise pourra évoluer vers d’autres schémas, peut-être l’actionnariat salarié sur le modèle des sociétés de participation ouvrière[4].
Que vous a apporté la qualité d’entreprise à mission ?
Cela a permis de valoriser et de structurer notre démarche, car il faut réunir un comité, établir des objectifs de mission, rendre compte. C’est une autodiscipline, par exemple pour dépasser la simple intention d’impact social et conduire une évaluation. Maintenant, on suit le taux d’absentéisme au mois, le taux de temps plein, le pourcentage de bénéficiaires du tarif social… Cela favorise l’alignement des investisseurs. Quand on a lancé notre activité de formation, une diversification aussi rapide heurtait la logique de rentabilité économique, mais c’était très pertinent au regard de notre mission. Nous défendons l’idée que toutes les entreprises devraient devenir des sociétés à mission pour se transformer.
Elles ne sont pas encore très nombreuses à le faire…
Aujourd’hui ce sont 1500 entreprises, qui concernent plus d’un million de salariés, c’est déjà significatif. Dans la plupart des secteurs, des entreprises pionnières utilisent ce cadre pour opérer des transformations systémiques. La société anonyme porte le germe de la déresponsabilisation, depuis toujours. La qualité d’entreprise à mission est une mise à jour de ce vieux logiciel. C’est un minimum, qui doit donc se généraliser, à commencer par les secteurs de l’alimentation, de la santé : qu’une entreprise de soins crée des troubles psychosociaux chez ses employés en raison de son organisation du travail, c’est insupportable. L’entreprise à mission n’est pas un label de vertu, c’est un cadre.
Propos recueillis par Valérie Urman