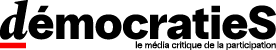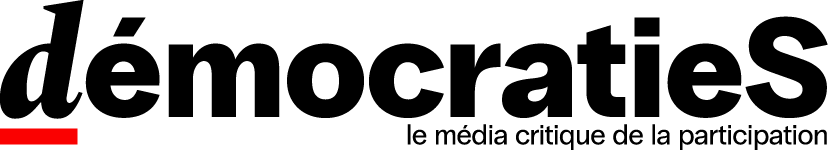Entretien avec
Eduardo Salazar Ortuño
Avocat, membre du Conseil de tutelle de la Mar Menor
La lagune de la Mar Menor, en Espagne, est le premier milieu naturel, et le seul à ce jour en Europe, devenu une personne juridique. Citoyens et scientifiques occupent une place déterminante dans la nouvelle gouvernance de la lagune, installée en juin 2025.
Quels ont été les facteurs déterminants pour parvenir à une loi reconnaissant à la Mar Menor les droits d’une personne ?
Le premier est l’effondrement écologique de la lagune[1], qui a révolté les habitants. Le deuxième est le déficit démocratique, car les gens n’avaient pas de moyen d’agir. L’Europe avait le pouvoir d’intervenir auprès de l’État et de la région de Murcie pour que s’appliquent les lois communautaires protégeant des écosystèmes aussi uniques, mais la Commission européenne n’a jamais réagi à nos demandes. Il nous fallait forcer les autorités espagnoles à prendre des mesures. Pour cela, nous avons actionné l’initiative législative populaire, troisième facteur déterminant : cet instrument déclenche automatiquement l’examen parlementaire d’une proposition législative, lorsque la pétition atteint le seuil de 500 000 signatures. Nous en avons eu plus de 600 000, en pleine crise du covid. Rien n’aurait été possible sans cette mobilisation citoyenne.
Il y a eu 80 recours à l’initiative législative populaire depuis la fin de la dictature en Espagne, seules deux ont abouti dont celle qui concerne la Mar Menor. Cela pointe vers un autre élément clé : le contexte politique nous était favorable, avec un gouvernement socialiste ouvert aux droits de la nature. Le chef du gouvernement, Pedro Sanchez, a lui-même a signé notre pétition, à titre personnel. Le Parlement, dans ce momentum populaire, n’avait d’autre choix que d’adopter la loi.
Des juristes ont incarné le mouvement, comme Teresa Vicente et vous-même. Est-ce aussi une clé ?
Le leadership de Teresa Vicente[2] est un facteur très important. Je ne sais pas si c’est vrai pour tous les soulèvements, mais la Mar Menor a eu besoin d’une personne visionnaire. Elle connaissait les cas de la rivière Atrato en Colombie et du fleuve Whanganui en Nouvelle-Zélande, pionniers des droits de la nature[3], elle savait vers où aller. Nous étions plusieurs avec elle.
La loi a été adoptée en 2022, validée par la Cour constitutionnelle en 2024 et finalement le décret d’application a été signé en février 2025. En êtes-vous satisfait ?
Oui, le décret est cohérent, il affermit les nouveaux droits de la nature face à une opposition qui ne s’est pas limitée à l’extrême-droite. La loi est controversée parmi les juristes, les experts, dont beaucoup considèrent qu’il y a suffisamment de lois pour protéger l’environnement et qu’il suffirait de les faire appliquer. Le décret royal permet d’avancer. Nous avons mis en place officiellement le Conseil de tutelle de la lagune le 29 mai 2025.
Comment cette gouvernance d’un écosystème, inédite en Espagne et en Europe, s’organise-t-elle ?
Le Conseil de tutelle s’appuie sur trois comités ayant tous le même poids décisionnel. Le premier, le Comité des représentants, compte trois représentants nommés par l’État, trois nommés par la Région et sept sont des citoyens locaux. Autrement dit, les citoyens sont majoritaires en nombre. Le deuxième, le Comité des gardiens, compte des représentants de la municipalité et les parties prenantes locales : éleveurs, agriculteurs, acteurs du loisir et du tourisme… Enfin, le Comité scientifique réunit une dizaine d’experts, tous spécialistes de la Mar Menor. Les paroles citoyennes et scientifiques pèsent donc beaucoup.
Comment sont désignés les citoyens ?
La loi dit qu’il s’agit d’habitants dont l’action et l’histoire personnelle les ont impliqués dans la défense de la lagune. Nous adopterons un processus de sélection pour l’avenir, mais dans l’immédiat il s’agit de nous, sept personnes du collectif entourant Teresa Vicente. J’en fais partie.
Il s’agira donc de personnes soigneusement choisies ?
Oui, les citoyens qui intègrent le Comité des représentants sont des habitants et habitantes qui démontrent leur engagement en faveur des intérêts de la lagune. C’est différent dans le Comité des gardiens où certaines parties prenantes, les agriculteurs par exemple, seront peut-être guidées par des points de vue et des intérêts spécifiques.
Pour faciliter le travail collectif des comités, nous faisons appel à des animateurs professionnels. Ces médiateurs sont à nos côtés depuis le début, ils connaissent le sujet, les controverses, les jeux d’acteurs.
Le Conseil de tutelle ne suit pas les principes de représentativité mis en jeu dans les conventions citoyennes. Nous ne représentons pas la société, nous n’exprimons pas l’intérêt général, nous défendons les intérêts de la lagune. Et il arrivera peut-être que nos positions soient impopulaires.
Comment cette organisation, assez complexe, parviendra à parler d’une seule voix ?
Ce ne sera pas facile. Nous devons convaincre en interne, en nous appuyant sur la parole des scientifiques ; mais aussi trouver un alignement entre des élus nationaux, régionaux et municipaux, issus de partis politiques différents. On parle là d’un profond changement, d’une transition écologique et démocratique.
Les comités délibèreront chacun de leur côté pour adopter une position que leur président défendra ensuite en Conseil de tutelle. Les trois présidents devront se mettre d’accord sur une décision pour agir au nom de la Mar Menor. Comme le décret le stipule, un directeur général est également désigné, il incarne la lagune dans les tribunaux et dans les institutions politiques.
Êtes-vous confiant dans ce modèle ?
Le modèle idéal n’existe pas, on invente en marchant. En tout cas, ce mode de gouvernance me semble beaucoup plus favorable à l’environnement. Déjà, toute cette bataille produit des impacts. Sous pression, les autorités ont déjà mis un terme à 90 % de l’irrigation illégale. L’État a décidé d’investir 675 millions d’euros dans la restauration écologique de la lagune. La Région bouge aussi, parce que tout le monde observe attentivement ce qui se passe. Dès 2023, trois actions en justice ont été intentées au nom de la Mar Menor.
Le Conseil de tutelle n’existait pas encore, qui a pris l’initiative de ces actions en justice ?
Des ONG. Sans qu’il soit besoin d’attendre le décret, la loi pour les droits de la Mar Menor permet à tout citoyen ou toute personne morale de défendre la lagune, sous le régime du droit privé. Cela signifie que vous ne défendez pas l’intérêt général, ni le vôtre, mais celui de la Mar Menor. Si vous demandez des dommages et intérêts, le montant accordé ne va pas dans votre poche ni dans celle de l’administration, mais sur le compte en banque de la lagune.
Quels jugements avez-vous obtenu ?
L’une des affaires sera jugée en mai 2026. Une deuxième est toujours au stade de l’enquête.
Dans le troisième cas, nous avons été déboutés sur le caractère privé de l’accusation. Nous avons porté l’affaire devant la Cour européenne des droits de l’Homme, dont la jurisprudence s’étend déjà à des personnes morales. Nous voulons que la Mar Menor soit la première « personne écologique » à bénéficier de la protection des droits de l’Homme.
Propos recueillis par Valérie Urman