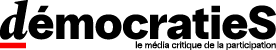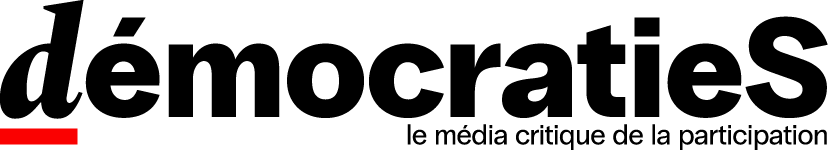Par
Rémi Radiguet
Juriste, maître de conférences en droit public à l'université de Perpignan
Sous prétexte d'urgence à mettre en œuvre la transition, on entame consciemment la démocratie environnementale. Depuis plusieurs années, de nouvelles réglementations limitent le droit de participer des citoyens. Ce qui alimente des réactions de désobéissance d'une fraction de la population et même de certains élus.
« Acter l’urgence. Engager les moyens ». Le dernier rapport du Haut Conseil pour le Climat rappelle que l’humanité est à un tournant. L’inaction collective conduira à une transition imposée, possiblement brutale et socialement inéquitable. Le propos est connu et source d’inquiétudes.
Faut-il penser que la somme des efforts de chacun suffira ? Ne pas manger de viande, ne pas prendre l’avion, réduire le chauffage dans son habitation : que chacun fasse sa part – dans son coin – et l’humanité sera sauvée ? Certes, les efforts individuels sont importants et justifient d’être accompagnés par les pouvoirs publics, mais ils ne peuvent suffire. Il est estimé que les efforts individuels même « héroïques » permettraient au mieux de réduire de 25 % les émissions de gaz à effet de serre, ce qui serait largement insuffisant pour respecter l’objectif de 2°C de l’Accord de Paris qui implique une baisse de 80 % des émissions actuelles. La sur-responsabilisation des individus n’est donc pas la bonne réponse, la bataille à mener ne peut qu’être collective[1]. Les transformations systémiques qui sont nécessaires doivent être insufflées à l’échelle de l’État.
Désobéissance civile ou désobéissance institutionnelle : la démocratie comme seule lumière ?
Investies de cette responsabilité particulière pour enclencher la transition, les autorités publiques sont, de fait, les principales responsables des retards constatés. Une fraction de la société civile se mobilise pour endiguer ce qu’elle considère comme des projets « d’un autre temps » : méga-bassines pour l’agriculture ; retenues collinaires pour la neige artificielle des stations de ski ; autoroute Castres-Toulouse, pour ne citer que les plus récents… Une certaine « radicalisation » des actions se fait jour et les mobilisations évoluent vers une désobéissance civile accrue.
En parallèle de ces mobilisations, le droit est mobilisé pour que la justice climatique se fasse dans les prétoires. Cela se traduit par une multiplication de contentieux à travers le monde. La France n’y échappe pas avec les décisions « Grande-Synthe » (Conseil d’Etat, 19 novembre 2020, Commune de Grande-Synthe) et « Affaire du siècle » (Tribunal Administratif de Paris, 3 février 2021, Association Oxfam France et a.). Ces décisions mettent en exergue l’insuffisance de l’État pour respecter la trajectoire climatique actée par les Accords de Paris. En creux, elles légitiment le bien-fondé « moral » de la radicalisation des actions voire, aux yeux de certains politiques, la nécessaire instauration d’une « dictature verte », seule capable de satisfaire nos objectifs.
L’urgence à agir en faveur de la transition se traduit dans le droit, conduisant à une course effrénée à l’adoption de lois qui visent à accélérer toujours plus la transition. Ces lois sont confectionnées sur la base d’objectifs ambitieux, retard dans la transition oblige.
Comme toute transformation systémique, cela n’est pas sans conséquence sur le quotidien des individus. L’exemple des zones à faible émission-mobilité (ZFEM) interdisant la circulation de véhicules anciens dans les métropoles l’illustre bien : elle frappe prioritairement les populations les plus fragiles si elle n’est pas accompagnée financièrement. Les mesures prises au nom de la transition polarisent donc les tensions et trouvant sur leur chemin ses réfractaires. Une certaine classe politique s’en fait l’écho. « J’ai décidé que la Région se retirait du processus de zéro artificialisation nette » affirmait Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne Rhône-Alpes, le 30 septembre 2023. Il conteste ainsi l’une des mesures phares adoptée par la loi « Climat et résilience » du 22 août 2021, prise sur la base des propositions de la convention citoyenne pour le climat. Il symbolise du même coup l’émergence d’une « désobéissance institutionnelle ».
Ce clivage sociétal doit être apaisé. La recherche d’un consensus sur les chemins à prendre pour opérer la transition écologique est une condition pour que les conséquences qui en découlent soient pleinement mesurées par chacun et soient considérées comme socialement acceptables. En somme, pour parvenir à « faire société » autour de la transition.
L’urgence écologique contre la démocratie environnementale
Le droit de l’environnement va-t-il dans ce sens ? Pas précisément. Sa réforme a pour ambition d’accélérer la réalisation des projets environnementaux au nom de l’urgence à agir en matière de transition écologique. Elle a été initiée en 2013 sous l’égide des États généraux de la modernisation du droit de l’environnement et a été poursuivie depuis à un rythme soutenu. Faisant suite au rapport Kasbarian « Cinq chantiers pour simplifier et accélérer les installations industrielles » du 23 septembre 2019, le point de bascule s’opère avec la loi du 7 décembre 2020 « d’accélération et simplification de l’action publique » dite « ASAP ». Dans son sillage, les dernières moutures en date sont les lois du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables et du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte. Ce flot de réformes inscrit dans le temps ce mouvement de simplification des procédures avec pour seule finalité de réduire les délais de réalisation des projets au nom de l’urgence de la transition en s’attaquant à la phase d’instruction de ceux-ci.
Il s’est agi en premier temps de rassembler, sous la houlette d’une autorisation environnementale unique, de nombreux régimes juridiques auparavant autonomes. Les entrepreneurs devaient en effet obtenir des autorisations de la part de différentes administrations – incluant les emblématiques « autorisation de défrichement » et « dérogation au droit des espèces protégées » – en constituant plusieurs dossiers faisant eux-mêmes l’objet d’instructions distinctes prenant ainsi en compte la complexité sous-jacente de la protection de l’environnement dans ses différentes dimensions. Exit la prise en compte distincte des intérêts protégés par les différentes réglementations, l’autorisation environnementale offre une approche globale sous forme de « guichet unique » rassurante pour l’entrepreneur, charge aux services instructeurs de s’organiser.
On peut légitimement penser que cette approche procédurale du « tout-en-un » est bien fondée car elle est le signe d’une recherche d’efficacité, voire de « performance administrative ». Mais en réalité, s’y cachent de réelles atteintes à la bonne instruction des dossiers.
Ainsi, l’appréciation des effets que le projet aura sur l’environnement est affectée, alors qu’elle est capitale, car l’approche globale optée par l’autorisation environnementale unique pressure les services instructeurs en réduisant les délais nécessaires pour une instruction sereine. On rogne également la partie relative à la participation du public au processus décisionnel en réduisant les délais dans lesquels celui-ci peut intervenir, en privilégiant la consultation électronique plutôt que l’enquête publique ou encore en en réduisant les possibilités d’expression au cas par cas par une approche globale et groupée des projets.
Il y a plus. Ce « tout-en-un » poursuit ses effets sur la justice environnementale afin que d’éventuelles « frustrations participatives » ne s’expriment trop longuement dans le prétoire. Outre le fait que la réforme limite mécaniquement les possibilités de contestation en réduisant le nombre de décisions prises par l’administration et donc d’actes attaquables devant le juge administratif, le législateur s’est attaché à atténuer les conséquences temporelles des contestations. Il réduit les voies et délais de recours – suppression de l’appel pour les projets éoliens par exemple – tout en renforçant considérablement les pouvoirs du juge administratif. Le but est que la régularisation des décisions administratives illégales se fasse au profit des annulations, qui impliqueraient de recommencer le processus décisionnel en sanctionnant, si besoin, les requérants gênants. Ceux-ci verraient leur responsabilité engagée au motif qu’ils auraient fait perdre du temps au porteur de projet.
Du tout-en-un poussé à son paroxysme, on entre aujourd’hui dans une ère du « dérogatoire ». Ainsi en est-il de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. Cette loi arpente les voies d’une exemption possible d’études d’impact ou encore d’une présomption de « raison impérative d’intérêt public majeur » accordée aux projets de développement des énergies renouvelables afin de justifier une dérogation au droit des espèces protégées.
La démocratie environnementale qui repose sur le triptyque « information, participation, accès à la justice » est passablement écornée au motif de l’urgence de la transition. Quels effets ces réformes auront-elles sur l’acceptabilité sociale des changements à mener ? Cela n’a pas été évalué. La direction prise n’engendrera que fractures sociétales alors que les transformations systémiques induites par la transition constitueraient une belle opportunité d’interroger l’efficacité de la démocratie environnementale pour repenser le « faire société » autour de notre environnement, patrimoine commun.