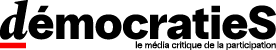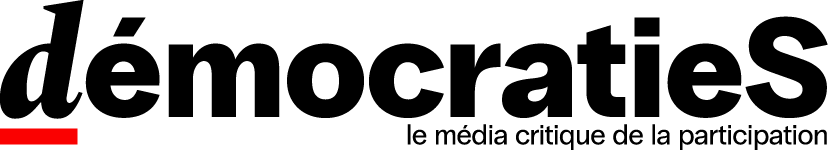Entretien avec
Charles Stépanoff
Anthropologue à l'Ecole des hautes études en sciences sociales
L’homme n'est pas fatalement destructeur, il peut tenir le rôle d’espèce clé de voûte dans son environnement, montre l’anthropologue Charles Stépanoff. À condition de préserver les savoirs locaux, porteurs de « réseaux denses » d’attachements au milieu de vie.
Comment définir les liens que les humains entretiennent avec leur environnement ?
Le succès extraordinaire de notre espèce tient au fait de ne pas être attachée à une seule source de nourriture. L’ouverture à l’exploration de toutes sortes d’algues, mollusques, mammifères, oiseaux, végétaux, a permis aux humains de se répandre partout, de l’Afrique au Groenland. Nous sommes hypergénéralistes, capables de trouver notre place dans des écosystèmes totalement différents en raison de cette capacité d’ouverture à la fois métabolique, psychique et affective. Aucune espèce n’entretient des liens si denses avec autant d’autres êtres vivants.
Les Inuits ont pu se nourrir de phoques et de cétacés parce qu’ils ont été capables d’observer les comportements de ces espèces, d’imaginer leur mode de vie. Les techniques de ruse impliquent de la curiosité, de l’observation, du savoir, de l’imagination, c’est-à-dire une intelligence écologique au cœur du rapport des humains à leur environnement.
S’agit-il toujours d’un rapport d’exploitation ?
Les intérêts humains conduisent aussi bien à aimer qu’à faire souffrir, à soigner qu’à tuer. Notre intelligence écologique s’appuie sur la complexité fondamentale des attachements, métaboliques autant que psychiques. Ce qui rend ces liens si forts, c’est la dépendance vitale à l’égard du monde vivant.
Les humains sont prédateurs d’environ 15 000 espèces animales, c’est infiniment plus que les lions ou les requins. Mais nous sommes des superprédateurs empathiques. Prédateurs parce qu’empathiques, les deux sont inséparables.
Les humains dominent-ils inéluctablement leur milieu de vie, jusqu’à le dévaster ?
Il y a 12 000 ans déjà, les activités humaines avaient modifié 75 % des écosystèmes terrestres. Toutes les sociétés humaines, dès l’ère glaciaire, façonnent leur environnement. Partout, les humains sont une espèce ingénieure qui remanie la forêt, crée des savanes, supprime des prédateurs concurrentiels, aménage par l’irrigation… La conception moderne opposant nature sauvage et paysage artificialisé ne tient pas. L’homme n’est pas extérieur aux dynamiques écologiques.
Dans le contexte de petites sociétés aux modes de vie communautaires, chacun fait facilement l’expérience de sa dépendance aux autres êtres vivants et comprend la nécessité d’en préserver le renouvellement. Les travaux des écologues montrent qu’en Australie, les populations de varans et de kangourous sont plus nombreuses là où ces animaux sont chassés par les Aborigènes, car les petits incendies contrôlés qu’ils organisent chaque année favorisent la diversité écologique de cet habitat. Dans ces contextes, l’humain a une fonction écologique, il tient le rôle d’espèce clef de voûte.
Les communautés humaines sont partie prenante de leur écosystème, c’est pourquoi il vaut mieux parler de socio-écosystème.
Cela permet-il d’établir une vision plus juste, moins pessimiste aussi ?
Les nouvelles approches de l’écologie humaine[1] réincluent l’homme dans son environnement et découvrent qu’il peut être facteur de résilience, pas forcément source de perturbation. Notre « cosmologie moderne », comme disent Philippe Descola et Bruno Latour, a opposé nature et culture. On sait aujourd’hui que cette opposition ne correspond pas à une description correcte des écosystèmes terrestres. Ainsi, les politiques de conservation de la nature qui exigent l’exclusion des communautés humaines reposent sur une erreur à la fois philosophique et écologique. Par exemple, les études d’écologie humaine sur le socioécosystème des Martu, en Australie, décrivent la fonction essentielle de ces groupes aborigènes semi-nomades que le colonialisme britannique a expulsés de leur terre ancestrale. Leur retrait a entraîné le déclin de l’écosystème, avec la disparition de plusieurs espèces endémiques de marsupiaux et l’expansion d’espèces invasives.
Comment nos liens au vivant ont-ils évolué dans les sociétés contemporaines post-industrielles ?
Aujourd’hui, quand on vit en ville, notre rapport à l’environnement est épuré et appauvri : nous avons perdu nos liens métaboliques car les végétaux et les animaux de compagnie qui nous entourent ne nous fournissent ni combustible ni nourriture. Nous avons éloigné et délégué nos approvisionnements à des élevages intensifs et des champs pétrolifères que nous ne fréquentons jamais. C’est ce que j’appelle les « réseaux étalés », des liens peu nombreux et simplifiés avec l’habitat proche, par opposition aux réseaux denses de proximité. Cette rupture tient aux approvisionnements intercontinentaux d’énergie fossile et à la globalisation de l’alimentation.
Les réseaux étalés surviennent avec l’avènement de l’État, qui assure la sécurité nécessaire aux échanges. Déjà, les empires inca et romain connectaient des populations sur des milliers de kilomètres grâce à des organisations centralisées. Des biens et des êtres vivants deviennent alors des marchandises transférables, des objets détachés. Dans l’empire romain, le rapport des communautés locales à leur milieu se transforme avec la spécialisation dans le blé, la vigne, ou l’olive. L’histoire environnementale montre que le défrichement des collines pour ces cultures a favorisé l’érosion et la formation de marais qui sont devenus des réservoirs de malaria. L’impact est mesurable à la diminution de la taille des gens : partout en Europe, jusqu’aux îles britanniques, on retrouve ce marqueur paléopathologique de l’impact sanitaire de l’empire romain. La stature humaine moyenne diminue jusqu’à l’effondrement de l’empire, après quoi, la courbe de taille remonte. Dans l’empire inca s’observe aussi un mouvement comparable de spécialisation régionale. À l’époque moderne, la globalisation a étalé les réseaux jusqu’à une échelle planétaire. Comme la peste sous l’empire romain, ces réseaux sont une voie de transfert de pandémies, comme le Covid.
Comment les sociétés modernes peuvent-elles se reconnecter au vivant ?
J’ai enquêté sur la chute de l’URSS comme contexte d’effondrement des réseaux étalés d’un empire récent. L’Union soviétique a marchandisé le vivant pour nourrir un front colonial urbain à travers la Sibérie. L’idéal de modernisation s’est défini en rupture avec le passé. Les modernisateurs ont rompu les attachements entre les populations sibériennes et leurs milieux, interdisant les rites de remerciement envers la montagne, supprimant les techniques d’élevage et de chasse au profit de la rationalisation des productions de viande et de fourrure. Quand le système soviétique s’est effondré, les connaissances réputées archaïques du mode de vie nomade sont redevenues d’actualité. Les personnes capables de s’en sortir, de rester une bonne santé, sont celles ayant préservé ces savoirs et ces techniques.
Tout est là, disponible. L’intelligence écologique peut être réactivée très rapidement. Les humains restent doués d’une extraordinaire force d’adaptation. Les jeunes générations, les enfants, sont prêts à réapprendre.
Est-ce encore à la portée de nos sociétés, partout en voie d’uniformisation ?
J’enquête beaucoup en France. Je suis admiratif de la richesse des savoirs paysans, des connaissances disponibles sur les lieux, les toponymes, le comportement des animaux, la diversité des espèces végétales, sur les légendes et les mythologies associées au territoire. Notre société entretient l’illusion de l’homogénéité. Les sociétés modernes ont du mal à accepter qu’en leur sein des savoir-faire, des mythologies, les rapprochent des chasseurs-cueilleurs, des petits horticulteurs amazoniens. Pourtant, ces correspondances existent, évidentes.
La restauration des liens au vivant passe nécessairement par l’échelle locale. Ces savoirs très fins, les plus menacés et les plus négligés aujourd’hui, sont au cœur de l’intelligence écologique. La première étape d’un réseau dense, c’est de nommer, d’identifier les familiarités. À Harvard, les étudiants en biologie maitrisent de larges connaissances sur l’ADN et la reproduction des plantes, mais ils en savent moins qu’un petit amérindien sur les arbres autour d’eux. Les savoirs locaux sont remplacés par les savoirs abstraits enseignés partout, pour adapter les jeunes aux modes de vie fondés sur l’intégration à des réseaux étalés. On les prépare à occuper une fonction au sein d’un marché internationalisé.
Il est essentiel de se demander ce que deviennent les savoirs locaux. Dans le nord-ouest de la France, où l’on a arraché les pommiers à cidre et les haies, des écosystèmes ont disparu en peu d’années, et avec eux un monde. Le facteur majeur d’effondrement des populations d’oiseaux, c’est l’industrialisation agricole.
On ne peut pas décorréler l’effondrement de la biodiversité de l’effondrement des cultures et des savoirs. Il faut parler d’effondrement de la diversité bioculturelle.
Comment faire quand la majorité de l’humanité vit en ville ?
D’un point vue écologique, il n’y a pas d’incompatibilité absolue entre urbanisme et réseaux denses d’attachement au vivant. Au néolithique, les premières cités étaient des agglomérations de fermes. Paris, avant la Première Guerre mondiale, était plus peuplée qu’aujourd’hui et pourtant plus autonome sur le plan alimentaire, avec des vaches laitières et un réseau de maraîchers. La petite couronne est passée de 2 500 à 50 maraîchers. Les techniques des maraîchers parisiens du XIXe siècle passionnent aujourd’hui les théoriciens anglo-saxons : on redécouvre des méthodes manuelles simples qui permettent une forte productivité biologique sur de minuscules surfaces. Il ne s’agit pas de proposer aux Parisiens de vivre comme les Yanomami dans la forêt amazonienne, mais de redécouvrir nos propres savoir-faire locaux, adaptés à nos écosystèmes.
Les rites, laïques ou religieux, gardent-ils de l’importance pour porter nos attachements au milieu de vie ?
Dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, de petits horticulteurs, le rapport à l’environnement n’est jamais uniquement d’exploitation matérielle mais implique des excuses, des offrandes, de la réciprocité. La figure de l’ancien, de la chamane, du prêtre, incarne cette médiation avec les entités non humaines. Cela passe par des fêtes locales, des chants, des rites. Les Aborigènes transmettent, par des chants dansés, des secrets de cueillette et de préparation de plantes sauvages, savoirs qu’ils valorisent comme des trésors culturels.
Toutes les cultures humaines ont établi des liens affectifs et intersubjectifs avec des entités vivantes comme des montagnes, des sources, des animaux. En Sibérie, certains clans Tuva se réunissent auprès d’un arbre sacré familial et lui offrent nourriture et rubans. Ce n’est pas si différent en France, où les fontaines miraculeuses font l’objet d’un culte populaire encore vivace, bien que dénigré. Chaque fontaine est dédiée à un saint guérisseur, les habitants disent « c’est notre médecin », ils lui attachent des rubans. À Plougastel, chaque fontaine est spécialisée dans un mal, les problèmes de vue, les migraines, les cauchemars des enfants… Cela crée un réseau de liens entre le corps et le territoire.
Des démarches participatives de reconnaissance du vivant recourent à la performance artistique, par exemple par des processions. Cela fait-il écho à vos travaux ?
Plutôt que d’inventer des rituels et d’importer une culture savante, on peut déjà essayer de comprendre les pratiques locales existantes si souvent disqualifiées. Les choses sont déjà là, sur place, le culte des fontaines, la connexion des éleveurs de porcs en plein air avec la biodiversité sauvage, le savoir des oiseleurs… J’ai enquêté dans le Larzac, où le pastoralisme a façonné les paysages des Grands Causses et une diversité exceptionnelle de flore et de faune. Les éleveurs pratiquent la tendelle, une technique de piégeage des grives utilisant les baies de genévrier comme appât. Les grives sont consommées pour les fêtes, selon des recettes familiales. L’inverse du poulet de batterie importé. La sociabilité autour de la grive porte des savoirs écologiques, botaniques, que les enfants apprennent.
Cette pratique vient d’être interdite par le Conseil d’État. Pourtant, si l’on prend la peine de s’y intéresser, les travaux des écologues montrent que les landes à genévrier se sont maintenues avec les tendelles. Cette pratique prélève des grives mais elle n’empêche pas leur reproduction et elle maintient l’habitat d’autres espèces endémiques. Le pastoralisme décline, remplacé par des élevages hors-sol, et la disparition des oiseleurs s’accompagne de la disparition des landes, broyées pour planter du maïs. Nous sommes choqués par des techniques locales de mise à mort des animaux sauvages parce que nous avons été habitués à nous nourrir d’animaux domestiques dont la mort industrielle est invisibilisée, soigneusement camouflée.
Quel regard portez-vous sur le mouvement des droits de la nature ?
La judiciarisation consiste à soumettre les pratiques vernaculaires à « l’œil de l’État » comme dit James Scott[2]. Avec l’approche juridique, on court le risque d’une dualité entre ce qu’on protège et ce qu’on ne protège pas. On protège quelques réserves naturelles, un fleuve, quelques espèces, pour mieux surexploiter le reste. Dans les pratiques vernaculaires, il faut porter attention partout autour de soi, les limites de protection sont floues et se déplacent à travers le temps. Ce régime d’attention valorise la diversité des situations locales que les normes juridiques gomment en interdisant de toucher à tel lieu ou telle espèce. Nous avons besoin de redécouvrir des façons d’habiter la terre qui ne sont pas enfermées dans le dualisme exploitation/protection, notre régime moderne d’« exploitection ». J’ai étudié les conflits autour de la chasse. Le débat national se réduit à l’invective, la confrontation. Sur le terrain, dans l’espace du dialogue, on voit des alliances entre chasseurs et protecteurs de l’environnement pour défendre les territoires contre des projets d’artificialisation.
Propos recueillis par Valérie Urman
.