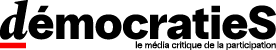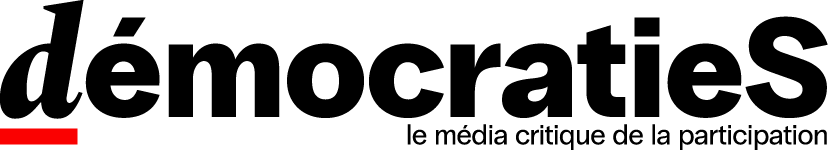Entretien avec
Jessica Sainty
Politiste spécialiste des comportements politiques, Université d'Avignon
Les dispositifs de participation, toutes échelles confondues, mobilisent environ 1% des citoyens. Pas sûr que la population y voit un remède aux maux actuels de la démocratie, estime la chercheuse Jessica Sainty. Pour convaincre, juge-t-elle, la participation institutionnelle doit garantir un nouveau partage du pouvoir de décision.
Selon vous, existe-t-il une demande sociale de participation ?
Jessica Sainty – Il n’est pas certain qu’un grand nombre de citoyens ait envie de participer. Les dispositifs institutionnalisés de participation mobilisent grosso modo 1 % de la population d’un territoire et la plupart des citoyens ignorent leur existence. Un petit groupe de chercheurs dont je fais partie a tiré ces conclusions d’une étude menée de 2009 à 2015[1] et qui a consisté en un sondage suivi de focus groups : des groupes de discussion composés de citoyens à qui nous avons posé des questions et qui en discutaient entre eux. Le politiste Guillaume Petit est arrivé à une conclusion similaire à partir de l’étude de plusieurs dispositifs de participation au niveau local. Ces analyses convergent avec une recherche marquante conduite aux États-Unis au début des années 2000, qui a introduit la notion de démocratie furtive ou discrète[2]. Les auteurs estimaient alors que la démocratie représentative était suffisante pour la grande majorité des citoyens américains, que ceux-ci ne voulaient pas participer et qu’ils préféraient confier la gestion des affaires communes à un gouvernement d’experts reconduit – ou non – périodiquement lors des élections. Cette thèse a fait l’objet de vifs débats aux États-Unis.
Pour comprendre les raisons de cette faible participation en France, nous avons mobilisé plusieurs groupes de citoyens, dans plusieurs régions, composés de participants de différentes catégories socio-professionnelles, avec des intérêts plus ou moins marqués pour les questions politiques.
Ces entretiens collectifs montrent que la grande majorité des personnes ne sont pas satisfaites de notre système politique mais qu’elles y sont résignées. Les critiques sont fortes et largement partagées mais elles sont accompagnées d’une sorte d’acceptation, de la conviction qu’il n’y a pas d’alternative et que la situation actuelle va perdurer. Le fatalisme est particulièrement marqué parmi les participants issus de catégories sociales défavorisées, même s’ils sont séduits par la démocratie directe, une idée que l’on a vue portée par le mouvement des « gilets jaunes » à travers le référendum d’initiative citoyenne. Les personnes plutôt situées à droite politiquement estiment que le système démocratique en lui-même est satisfaisant mais que ce sont les élus qui sont défaillants et qu’il faut les remplacer par des experts choisis pour leur compétence. Cette posture est beaucoup moins fréquente à gauche où l’on observe une plus grande attention au lien entre représentants et représentés. Globalement, l’imaginaire démocratique n’est pas très développé et, surtout, personne ne réclame de budget participatif ni aucun autre dispositif comme ceux qui sont aujourd’hui portés par les institutions, en particulier les collectivités territoriales.
Y a-t-il davantage de demande de participation à l’échelle municipale ?
Ce n’était pas le cas lorsque nous avons organisé ces focus groups, en 2014 et 2015. Les rares demandes à ce sujet restent socialement situées. Prenons l’exemple des listes citoyennes et participatives apparues dans les médias avec une première victoire électorale en 2014, Saillans, un village de la Drôme qui a proposé un fonctionnement très participatif de la commune. Lors des élections municipales de 2020, cette expérience a essaimé et environ 350 listes citoyennes se sont présentées partout en France. Mais ces expériences novatrices mobilisent des personnes déjà convaincues, politiquement engagées en marge des partis traditionnels. Globalement, il s’agit de personnes plus jeunes que la moyenne des candidats aux élections municipales, membres de catégories socio-professionnelles plus favorisées et plus diplômées, parmi lesquelles certains secteurs d’activité, comme le secteur sanitaire et social ou le secteur de l’éducation, sont bien représentés.
Le besoin de participer « autrement » à la vie politique municipale existe donc, mais il concerne des groupes de la population très spécifiques et probablement minoritaires. On n’y retrouve quasiment pas, par exemple, les personnes engagées dans le mouvement des « gilets jaunes ».
En tout état de cause, la présence d’une liste citoyenne dans certaines villes n’a pas suscité une plus forte participation électorale. De façon générale, la participation au scrutin municipal de 2020 a connu un fléchissement important : elle a été la plus faible de la Cinquième République. Certes, le contexte sanitaire était particulier et il faudra vérifier si cette désaffection se confirme en 2026, mais aujourd’hui, l’abstention électorale est devenue la norme, elle touche tous les âges et toutes les classes sociales. Les seuls taux de participation qui restent élevés sont ceux de l’élection présidentielle.
Pour autant, les citoyens ne se tournent pas vers les espaces participatifs créés par les collectivités ?
Non. En tous cas, ceux qui s’y investissent ne restent pas longtemps. Les Conseils de quartiers, les Conseils citoyens ou les autres dispositifs de ce type doivent perpétuellement rechercher des participants pour suppléer les départs de ceux qui ne voient plus où cela les mène. Les citoyens qui résistent au découragement sont toujours les mêmes : plutôt âgés, éduqués, à la recherche de lieux de socialisation… Les autres sont vite découragés par des élus qui passent leur temps à définir le périmètre de la participation autorisée. Il existe en France une appétence pour la chose publique mais pour participer effectivement, il faut que cela ait un sens, que cela semble aller quelque part.
Or, pour beaucoup d’élus, la participation citoyenne doit venir en soutien à leur projet politique. Le paternalisme se manifeste quand ils font remarquer par exemple que les choix politiques sont complexes, que les citoyens ne sont pas prêts à y contribuer, ou encore que l’exercice du pouvoir est une lourde responsabilité…
Autre difficulté en ce qui concerne l’aménagement du territoire : que ce soit dans le domaine des mobilités, de la transition énergétique ou des ressources naturelles, les collectivités et l’État sont des parties prenantes largement responsables des choix du passé, qui ont déjà perdu beaucoup de leur crédibilité au moment d’organiser des débats sur de tels sujets. Les décideurs publics préfèrent laisser aux citoyens un espace limité et leur demandent de soumettre des projets. C’est moins risqué, d’autant plus qu’ils leur imposent de rester dans les compétences des institutions, de respecter un cadre budgétaire strict et de s’adresser à tous. Les citoyens en sont ainsi réduits au rôle de pourvoyeurs d’idées. De plus, on leur suggère souvent de s’inspirer des bonnes pratiques d’autres collectivités et c’est pour cela que les citoyens proposent toujours d’installer des ruches urbaines, des jardins partagés et des hôtels à insectes plutôt que de parler par exemple de justice sociale ! Cette version modernisée des appels à projets risque de ne pas convaincre les citoyens très longtemps.
Il faut mesurer la contradiction qu’il y a entre le côté étriqué et normalisé des dispositifs de participation citoyenne et l’ambition qu’on leur attribue, qui est de recréer du lien entre les élus et la population.
Enfin, les propositions des citoyens ne sont pas suffisamment suivies d’effet. Dans une administration municipale, le service dédié à la démocratie participative est le plus souvent un département modeste qui peine à mobiliser les autres agents. Pour les services techniques, la participation apparaît comme un gadget. Ajoutez à cela les délais de mise en œuvre des projets et vous comprenez aisément comment les idées émises par les citoyens se perdent dans l’administration et comment les citoyens eux-mêmes en perdent la trace. Cela alimente le sentiment que toute cette mobilisation ne sert pas à grand-chose. Moins les citoyens sont insérés dans la vie politique, moins ils sont familiers des logiques administratives, moins ils comprennent ces lenteurs et cette dilution de leurs propositions, et moins ils se sentent écoutés.
Est-ce que cela signifie que les citoyens ne s’intéressent pas à la politique ?
Je ne pense pas que la participation institutionnelle soit vue par les citoyens comme un remède aux maux actuels de la démocratie. Ce qui est certain, c’est qu’elle ne résoudra pas à elle seule la crise de la représentation, qui est profonde. Cela ne signifie pas que les gens ne s’intéressent pas à la politique, on le voit lors des mouvements sociaux : celui des « gilets jaunes » ou ceux qui se sont manifestés à propos du « pass vaccinal » ou du mariage pour tous. sans parler, en 2023, de la plus importante mobilisation sociale contre la réforme des retraites que l’on ait connue depuis 1995… L’énergie ou la préservation des ressources en eau, plus généralement l’environnement ou la transition, sont aussi des thèmes mobilisateurs, notamment chez les jeunes. Quand les gens se sentent concernés, ils agissent. Mais ces formes de mobilisation ne sont évidemment pas encouragées par les pouvoirs publics et certaines réactions, comme la répression policière ou la délégitimation des mouvements sociaux, si elles s’installent durablement, pourraient conforter les citoyens dans l’idée que rien ne peut changer, ce qui contribuerait encore au fatalisme ambiant.
De la même façon, l’expérience de la Convention citoyenne pour le climat n’a pas envoyé un bon signal. Le processus lui-même n’est pas en cause, il est intéressant et a été mené de façon soignée, mais l’écart entre la promesse et les actes ne renforce pas la confiance dans les institutions. Dans ce cas particulier, le problème est moins dans le dispositif lui-même que dans sa traduction politique.
C’est donc tout un contexte qui décourage les diverses formes de participation politique que les citoyens ont à leur portée. Ce climat n’encourage pas le dialogue et n’invite pas à l’expression des revendications. Il ne faut pas s’étonner alors que les invitations des autorités publiques à participer restent lettre morte.
Quelle est la part de responsabilité des professionnels du secteur dans les constats que vous faites ?
La professionnalisation du secteur de la participation a donné naissance à des outils clés en main, comme les budgets participatifs ou d’autres dispositifs. Il faut bien reconnaître que pour les collectivités, cela constitue un gain de temps appréciable, mais cela conduit aussi à une certaine standardisation des pratiques. Globalement, l’offre est large car les outils sont divers mais les effets d’imitation entre collectivités conduisent à la mise en œuvre d’une gamme limitée de méthodes. La circulation de personnes entre le monde des consultants et celui des collectivités, dans un cercle somme toute limité, contribue également à la diffusion d’un petit nombre d’outils.
D’un autre côté, cette professionnalisation a contribué à un perfectionnement des pratiques. Nous avons aujourd’hui des dispositifs qui ont fait leurs preuves et des spécialistes qui savent les adapter aux besoins et aux différents contextes. On l’a vu lors du Grand débat national lancé en 2019 en plein mouvement des « gilets jaunes » : c’était une expérience hors normes par son ampleur, qui a donné lieu à des improvisations sur le plan de la méthode et révélé des carences. Mais elle a aussi montré, compte-tenu des délais impartis, la capacité des professionnels à déployer des outils, particulièrement sur le volet numérique.
Aujourd’hui, le problème est moins dans les méthodes de participation que dans le rapport difficile entre les espaces de participation et la décision politique. Ce sont les décideurs publics et l’administration qui déterminent quelle place ils consentent à laisser à la démocratie participative. En l’absence de pression extérieure suffisante, le système peine à se réformer et il cherche plutôt à perdurer. Personne n’a envie d’une véritable démocratie délibérative, ce qui restreint de fait les dispositifs participatifs à un rôle cosmétique.
Quelle place pour la participation dans l’avenir ?
Je ne me risquerai pas à prédire l’avenir. Je constate simplement aujourd’hui une déconnexion préoccupante entre les citoyens et les politiques, à laquelle la participation citoyenne, telle qu’elle est mise en œuvre par les institutions, ne peut manifestement pas remédier. Ce n’est pas spécifique à la France et cette fracture laisse le champ libre à des mouvements extrémistes qui menacent le principe même de démocratie, comme on l’a vu aux États-Unis ou au Brésil, ou plus près de nous en Europe.
Le contexte n’est pas complètement sombre puisqu’on voit aussi des mouvements citoyens s’affirmer, comme c’est le cas au Chili. La démocratie a donc encore des ressorts. Il n’est pas impossible que des évolutions majeures, comme le changement climatique, invitent à des réactions de la part de la population. Les citoyens sont parfaitement capables de se saisir de questions importantes et lourdes. On peut imaginer qu’une institution indépendante contrôle la participation et sa portée réelle, que ce soit à l’échelle locale ou nationale. Dans les faits, une telle institution risque d’être inefficace -ou contournée politiquement- si elle n’a pas l’autorité pour garantir aux citoyens un pouvoir décisionnel. La vraie question est celle du partage du pouvoir de décision.
Propos recueillis par Pierre-Yves Guihéneuf et Valérie Urman.