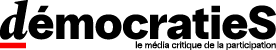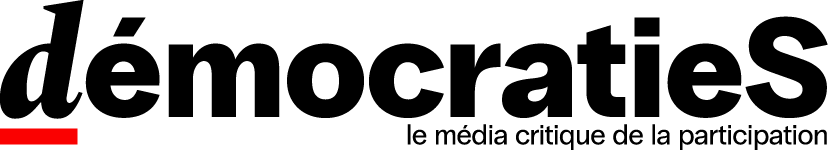Entretien avec
François Jégou
Designer industriel, agence Strategic design scenarios
Après 25 ans de démarches participatives, la ville de Gand en Belgique soulève, lors du bilan dressé avec le designer François Jégou, des malentendus et des manques. Et entend poser les jalons d’un nouveau contrat de participation.
Pourquoi la ville de Gand a-t-elle souhaité lancer une démarche d’analyse revenant sur 25 années de participation ?
La ville de Gand [1] se positionne comme une référence européenne de la participation citoyenne, avec des distinctions internationales. Mais à la fin de 2023, la commune s’est trouvée face à un paradoxe : alors qu’elle est plébiscitée au niveau européen, des voix s’élèvent et critiquent les dynamiques de participation. Le souhait était donc de produire un bilan identifiant les succès et les angles morts. Cette démarche répondait à plusieurs urgences : comprendre pourquoi certains citoyens ne se sentent pas écoutés, mesurer l’impact des dispositifs, clarifier ce que la participation peut – ou ne peut pas – promettre et, surtout, se projeter dans les 25 prochaines années. Nous avons accompagné Gand et son service de Policy participation dans ce travail rétrospectif et projectif [2] pendant plus d’un an.
Malgré l’engagement de la collectivité, des personnes disent toujours qu’elles ne sont pas entendues. Pourquoi ?
Si une part importante de citoyennes et de citoyens exprime toujours le sentiment de ne pas être entendue, c’est que les processus participatifs suscitent trop de promesses sans clarifier les attentes. Cela génère frustrations et malentendus. Par ailleurs, la participation reste souvent trop discrète : les actions menées sont nombreuses, mais elles manquent de visibilité et de communication. Les processus participatifs tendent aussi à être pris trop à la lettre par certains publics : « si on me sollicite pour exprimer ma voix, alors je vais la retrouver dans la décision finale ». Quand leurs propositions n’aboutissent pas littéralement ou semblent diluées, ils interprètent cela comme un manque d’écoute. Enfin, la ville a tenté d’adapter les dispositifs aux spécificités des quartiers et la perception d’inégalités de traitement entre les quartiers accentue encore le problème. L’expérience de Gand souligne ce risque de malentendus : la participation ne garantit pas une adoption systématique des idées, mais en revanche, elle doit toujours garantir transparence, explication et retour clair, faute de quoi le sentiment de déni s’installe.
Le sentiment de ne pas être entendu traduit ainsi moins une absence d’impact politique, comme cela est souvent pointé dans la littérature critique de la participation, qu’un déficit d’adaptation des dispositifs, de lisibilité et de reconnaissance.
Vous proposez de rédiger un « contrat de participation », pourquoi ?
L’une des dérives les plus fréquentes est de laisser croire que les habitants décideront de tout. Cette promesse génère des déceptions inévitables, car une collectivité est contrainte par des cadres légaux, des budgets, des équilibres politiques. Il faut clarifier ce que la participation peut et ne peut pas : définir ce que j’appelle un « contrat de participation », qui peut prendre la forme d’une ligne du temps qui replace le processus dans le contexte qui l’a suscité, explique les actions où les citoyens peuvent contribuer directement, les marges réelles et les suites qui seront données. Trop souvent, la participation est chargée de promesses vagues : inclusion totale, décisions partagées, transformation des services… sans préciser les conditions réelles. Le contrat doit rendre explicite ce qui est attendu des citoyennes et citoyens, mais aussi des institutions : quels sont les objectifs de la démarche, jusqu’où va le pouvoir d’influence, quels moyens et quel suivi sont garantis ? Il agit comme une balise commune qui réduit les malentendus et évite l’usure démocratique née de promesses non tenues. Loin d’un simple slogan, c’est une mise au clair : la participation ne peut pas tout, mais elle peut beaucoup si elle est encadrée par un pacte transparent, négocié et soutenable. Ce contrat devient alors une infrastructure de confiance, un cadre partagé qui rend la co-construction tangible et crédible.
Comment les questions d’équité, d’inclusion sont-elles abordées et comment les renforcer ?
Renforcer l’équité en participation suppose d’abord de reconnaître une réalité trop souvent occultée : la précarité participative. Toutes et tous ne disposent pas des mêmes ressources pour s’engager : temps, compétences, confiance, accès aux réseaux. Cette inégalité crée une fracture entre ceux pour qui la participation est un capital social et ceux pour qui elle est une charge supplémentaire. Pour y répondre, il faut diversifier les formats, aller vers les publics moins visibles, compenser les coûts d’engagement, former et accompagner. L’équité ne se réduit pas à ouvrir les portes elle implique de réduire activement les obstacles. Par exemple, est-ce que les intéressés sont au clair avec les enjeux, connaissent les implications techniques, juridiques ? Comment aider à trouver les modalités et le temps pour contribuer ? Mais aussi designer le processus de participation comme une expérience enrichissante et attractive…. En travaillant à sécuriser ces conditions d’accès, la participation cesse d’être un privilège pour initiés et devient une véritable ressource collective.
Comment mieux connaître celles et ceux qui ne participent pas et leur donner envie ?
La masse silencieuse représente près des deux tiers des habitants de Gand. Cette absence d’interaction ne signifie pas indifférence, mais reflète une pluralité de situations que le service de participation gagnerait à mieux distinguer et toucher : les participants passifs pour qui la participation est importante, qui ne souhaitent pas s’engager mais qui apprécient que d’autres le fassent ; celles et ceux qui participent dans une action mais ne veulent pas en faire plus ; les habitants qui se sentent exclus par manque de temps, de compétences ou de confiance ; les participatifs potentiels qui s’ignorent et que l’on doit aider à imaginer ce qu’ils pourraient faire ; enfin, éviter ce que l’on pourrait appeler le biais de recrutement : les services de la ville tendent à proposer aux citoyens des modalités de participation qui les arrangent, plus qu’elles ne conviennent aux citoyens, des actions qui soulagent le travail des services mais qui ne sont pas nécessairement ce dans quoi les citoyens ont envie de s’engager.
Derrière le silence, il y a donc des motivations et des obstacles très différents. Les identifier, les cartographier, c’est ouvrir la possibilité d’une participation plus inclusive, qui ne s’adresse pas seulement aux convaincus ou répond aux mécontents, mais qui reconnaît aussi la diversité des postures citoyennes.
Parmi les pistes d’amélioration, vous proposez de renforcer la participation-contribution tournée vers l’action citoyenne et ouvrez la voie vers des services publics collaboratifs. Pouvez-vous préciser ?
La participation n’est pas seulement affaire de consultation ou de délibération. Il faut élargir le spectre vers une participation-contribution, où les habitants deviennent aussi co-acteurs de la fabrique urbaine. Comme Gand le pratique déjà,, cela signifie encourager des projets dans lesquels la municipalité et les citoyens travaillent côte à côte : jardins partagés, services de mobilité locale, initiatives culturelles ou sociales, etc. On passe ainsi d’une logique de demander/valider à une logique de faire ensemble. Cette approche ouvre la voie à des services publics collaboratifs [3] : au lieu d’un service public purement descendant, il devient un écosystème où la collectivité fournit cadre et soutien, et où les habitants apportent énergie, expertise et engagement, les citoyens co-développant ce qu’ils sont prêts à faire, en synergie avec la ville.
Autre piste, celle de proposer à des citoyens de devenir ambassadeurs de la ville, quel serait leur rôle ?
Le rôle des ambassadeurs serait d’être des passeurs entre institutions et habitants, mais aussi des relais entre différents groupes sociaux. Ils ne sont ni des élus, ni des experts, mais des citoyens engagés, capables de porter la voix de leur quartier, d’expliquer les processus participatifs et de susciter l’intérêt de leurs pairs. Cette fonction suppose d’être reconnue officiellement, afin d’éviter toute ambiguïté : il ne s’agit pas d’instrumentaliser des bénévoles, ou d’investir certains de pouvoirs qui n’auraient pas été délibérés démocratiquement, mais de leur donner un vrai statut, une légitimité, voire un soutien financier ou logistique. Leur reconnaissance est clé pour qu’ils puissent agir avec crédibilité, tout en restant proches du quotidien des habitants. Ces ambassadeurs pourraient devenir des catalyseurs de confiance, en réduisant la distance perçue entre institutions et population.
Comment voyez-vous la participation citoyenne et sa structuration à Gand dans dix ans ?
J’espère que dans dix ans, la démocratie participative à Gand sera encore plus proche et plus robuste ! Proche, car elle capitalisera ses enseignements et les cartographiera systématiquement à l’échelle des quartiers, intégrant mieux les différences sociales et culturelles, avec des dispositifs adaptés aux réalités locales. Robuste et transparente, car elle sera clarifiée par un contrat de participation : chacun saura ce qu’il peut attendre, quels engagements réciproques sont garantis et comment les décisions sont réellement influencées.
Au-delà d’une suite d’événements ponctuels qui convoquent les citoyens à s’intéresser aux affaires de la ville comme c’est souvent le cas dans les collectivités locales, la participation sera celle d’une ville qui s’intéresse systématiquement à ce que font les citoyens, appuyée sur une communication forte et une visibilité des résultats. Elle intégrera aussi les dimensions d’inclusion et de capacitation, en levant les freins de la précarité participative, par exemple, en s’engageant à toucher chaque citoyen au moins une fois par an par une action de participation. Enfin, l’administration elle-même aura renforcé sa capacité d’agir avec les citoyens, chaque service de la ville fonctionnera de manière participative et aura fait évoluer ses modes d’action pour co-produire l’action publique avec les gens, transformant la participation en un levier d’innovation sociale et de gouvernance urbaine.
Entretien réalisé par Sylvie Barnezet
Que fait le service participation de Gand ?
Le service de participation politique de la ville de Gand organise la consultation et la participation à l’échelle de la ville et dans les 25 quartiers qui composent la ville. Chaque quartier dispose d’un “manager de quartier” dont le rôle est de faire le lien entre les citoyennes, les citoyens et les élus et services de la ville. Le rôle de ces managers est d’écouter les préoccupations des habitants sur la circulation, l’aménagement, etc., de les transmettre aux autres services municipaux et aux décideurs politiques et d’assurer les liens entre la vie des quartiers et l’élaboration des politiques publiques.
Le service pilote aussi le budget participatif, les formes numériques et créatives de participation, l’occupation temporaire de bâtiments et de sites vacants et, actuellement, la réforme des conseils consultatifs. Ces derniers doivent passer d’espaces d’experts fermés en forums plus ouverts. À noter que les Gantois sont aussi encouragés à prendre eux-mêmes des initiatives à l’échelle micro-locale par le biais du budget de quartier ou du fonds pour les occupations temporaires.