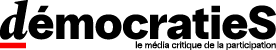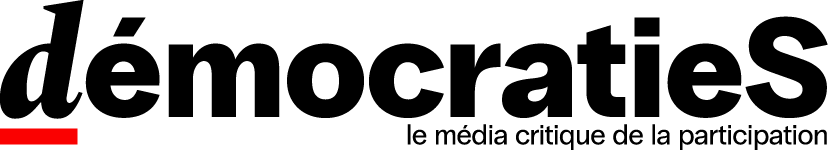Nicolas Camerati
Sociologue, chargé de médiation à la Maison de l’IA
Et si les critiques de la participation citoyenne regardaient toujours au même endroit, sous le seul angle de la démocratie représentative ? Nicolas Camerati propose d’éclairer un autre champ à la fois social, sensible et politique, en s’appuyant sur ses expériences chiliennes de co-construction d’espaces et d’équipements publics.
Les débats sur la participation restent sous le lampadaire de la démocratie représentative en oubliant ce qui se joue dans l’ombre : ce que les habitants racontent de leur rue, de leur place publique, de leur école ; ce qui s’échange sur le trottoir, s’exprime dans les gestes du quotidien. La vision de la participation forcément reliée à la démocratie représentative valorise toujours les mêmes formes de compétences — l’argumentation, la maîtrise des codes institutionnels — au détriment d’autres, moins visibles, tout aussi politiques : l’usage quotidien d’un espace, la mémoire d’un lieu, l’expérience corporelle. Autrement dit, l’expertise des habitants et leurs imaginaires, qui ne sont pas anecdotiques, mais bien des manières de faire et de voir la politique.
Cette logique enferme la participation dans un rôle réparateur, alors qu’elle peut être une force inventive.
Quand l’écoute redessine l’espace
Le projet de rénovation du collège Eduardo de la Barra, à Peñalolén, Santiago du Chili, illustre comment la participation peut transformer l’architecture. En 2015, le ministère de l’Éducation chilien publiait un document [1] qui redéfinissait les standards de qualité pour l’infrastructure scolaire. Au-delà des normes de surface et de confort, il introduisait une nouveauté : la nécessité d’intégrer la communauté éducative dans les étapes de la conception architecturale.
C’est dans cet esprit que l’équipe d’architectes de Marsino Arquitectura décide de reprendre le design initial du collège Eduardo de la Barra. Dans un premier temps, ils appliquent les méthodes prescrites par les standards officiels, des réunions et des questionnaires. Mais ces dispositifs révèlent vite leurs limites : faible participation, posture d’auditoire passif, réponses trop générales pour orienter le projet concret… Conscients de ces impasses, les architectes choisissent alors d’aller chercher d’autres types de savoirs. Comme l’explique Marcino aux habitants, « Ce que j’aimerais de votre part, c’est que vous m’apportiez des éléments issus du terrain qui me permettent d’innover dans l’élaboration du projet. Je voudrais que vous me posiez de nouvelles questions qui m’aident à penser la conception autrement… » Des cartes et des questionnaires sur les lieux de l’école et du quartier ont été proposés aux élèves, parents et enseignants pour localiser leurs trajets quotidiens, les lieux de peur, de conflit ou d’amitié, mais aussi les espaces oubliés. Des ateliers de Lego, adaptés à la construction scolaire, ont permis aux enfants et aux enseignants d’exprimer leurs désirs et de construire avec leurs propres mains l’école de leurs rêves, transformant la participation en moment d’imagination et de plaisir. Enfin, des photographies ethnographiques et des récits spontanés ont permis de révéler l’usage réel de l’espace : un banc pour se reposer, un mur pour se cacher, un coin à éviter.
Ces démarches ont mis en lumière une dimension sociale et symbolique d’usages ignorées. Les habitants rappelaient que l’école se trouvait au croisement de deux quartiers en tension avec des rivalités liées au football et qu’un mur aveugle, ainsi qu’une partie arrière de l’établissement, renforçaient le sentiment d’exclusion d’un côté du quartier et constituaient un espace perçu comme dangereux. L’arrière de l’école, espace résiduel et peu protégé, portait la mémoire d’événements violents, renforçant l’idée d’un lieu abandonné.
Ces récits ont conduit à une reconfiguration profonde du projet. L’école a été pensée sans dos [2], traversante, visible de tous côtés, avec plusieurs accès reliant équitablement les deux quartiers. Les espaces résiduels ont été transformés en lieux ouverts, visibles et fluides. Les photographies ethnographiques montraient également des usages concrets du sol – comme les élèves assis par terre – qui ont conduit à modifier le mobilier scolaire, afin de l’adapter aux pratiques réelles. Les cartographies du quartier révélaient, quant à elles, le besoin d’espaces publics sûrs et conviviaux.
L’établissement a ainsi assumé sa fonction de plaza sécurisée : un espace de vie collective, végétalisé, hospitalier, accessible aux familles et aux jeunes en dehors du temps scolaire. De plus, tous les éléments architecturaux qui rappelaient l’univers carcéral – grilles, barreaux et dispositifs de contrôle – ont été remplacés. L’école n’a plus été pensée comme un lieu fermé et contraint, mais comme un espace de circulation fluide, de visibilité partagée et d’appropriation collective.
Une oasis dans le désert
Dans un tout autre contexte géographique et social, à Sierra Gorda, au nord du Chili, au cœur du désert d’Atacama, nous avons travaillé avec l’équipe de Marsino sur un projet de relocalisation d’un complexe éducatif dans un environnement minier, aride et extrême.
Ce milieu ingrat s’est révélé être un véritable espace vécu : un lieu d’attachements, de résistances et de résilience pour une communauté confrontée aux contraintes environnementales et aux logiques extractives. Dans ce contexte, l’école ne pouvait être conçue comme un simple bâtiment fonctionnel ; elle devait incarner un espace de soin, un repère identitaire, un lieu protecteur et fédérateur. L’idée d’une oasis n’était pas un concept préétabli ni une hypothèse d’expert. Elle a émergé naturellement au fil du processus participatif, au croisement des récits, des observations et des usages quotidiens.
Le processus participatif s’est appuyé sur une pluralité de méthodes : ateliers d’imaginaires spatiaux, lectures sensibles du paysage, cartes affectives, entretiens croisés avec élèves, enseignants, habitants, associations et travailleurs de la mine. Trois niveaux d’analyse ont structuré ce travail : la relation au territoire désertique, la relation corporelle aux usages quotidiens de l’école et la relation symbolique à l’univers minier.
Un enjeu central est rapidement apparu : la difficulté pour les familles d’accéder à l’école et d’attendre les enfants à la sortie. Le vent constant, la chaleur accablante, l’absence d’ombre, la poussière, le passage des camions rendaient éprouvant, voire dangereux, le simple fait de venir chercher et d’attendre les enfants. Ce constat a débouché sur des aménagements spécifiques : des passerelles couvertes et des cheminements abrités ont été imaginés, non seulement pour protéger les élèves et les parents du vent et de la poussière, mais aussi pour permettre des circulations fluides et sûres. Enfin, une demande spécifique de prolongement budgétaire a été formulée pour intégrer une toiture à triple usage : ombrage, ventilation naturelle et gestion des flux de poussière.
Faire parler les corps
Dans un tout autre registre, le projet mené dans la commune de Maipú, toujours au Chili, sur les enjeux de sécurité. Ce projet repose sur un double constat. D’un côté, les dispositifs classiques de concertation ne mobilisent qu’un public restreint, souvent politisé, laissant de côté la majorité de ceux qu’on appelle parfois les « habitants à pied » ; de l’autre, les discussions sur la sécurité se polarisent rapidement, rendant difficile une expression libre dans les formats traditionnels.
Plutôt que d’attendre que les habitants viennent à une réunion, nous avons déplacé le dispositif dans leurs lieux de vie quotidiens : les marchés, les parvis d’église, les arrêts de bus, la Plaza de Maipú. Des tables installées dans l’espace public, équipées de cartes interactives et de questionnaires géographiques, permettaient à chacun de s’arrêter quelques minutes, de répondre et de pointer plusieurs lieux sur la carte. Les habitants racontaient alors : « ici, je marche vite parce qu’il n’y a pas de lumière », « là, je n’attends jamais le bus seule », « ce parc, je l’évite le soir », « dans ce passage, je me sens isolée, sans possibilité d’alerte ni d’aide en cas de problème ». Ces récits étaient immédiatement traduits en données spatiales et statistiques, donnant forme à une cartographie vivante : cartes de chaleur, points d’accumulation, zones de vigilance.
En deux semaines, près de 600 personnes ont participé. Ce chiffre montre surtout qu’en changeant de cadre, on change aussi de public. Là où les réunions rassemblent une vingtaine de militants ou d’associatifs, la démarche installée dans l’espace public touche une grande diversité d’habitants : commerçants, passants, étudiants, retraités. Les « habitants à pied », rarement présents dans les dispositifs institutionnels, devenaient ici les principaux contributeurs.
La parole des femmes
Les habitantes ont massivement cartographié des expériences d’insécurité : regards insistants, propos déplacés, gestes intrusifs dans les transports. La Plaza de Maipú, pourtant lieu central, a été identifiée comme hostile. Les jeunes filles évoquaient le besoin de marcher en groupe, de changer d’itinéraire pour éviter certains endroits. Les cartes se sont progressivement remplies de ces récits situés. Plus de 60 % des femmes interrogées déclaraient avoir subi une forme d’agression ou d’insécurité dans l’espace public ou dans les transports. Ces zones identifiées ne correspondaient pas seulement à des chiffres, elles traduisaient des logiques de vécu : absence de possibilités d’alerte, vols à la tire, difficultés propres à certains usages, perceptions différenciées selon l’âge ou le genre. Ce sentiment, rarement exprimé dans les réunions classiques, devenait ici visible, cartographié, reconnu. La sécurité, dans ce contexte, n’était pas un indicateur abstrait : elle était une pratique, une ambiance, une expérience corporelle et perceptive.
Cette expérience a montré que la sécurité est d’abord une donnée vécue, et donc politique.
Pour une démocratie située
La participation n’est donc pas seulement un outil pour corriger la démocratie représentative, encore moins un gadget consultatif. Elle est une manière de produire des savoirs collectifs, qui orientent concrètement l’action publique. Tant que nous restons sous le lampadaire de la démocratie représentative, nous en resterons aux mêmes critiques : pas assez légitime, pas assez représentative, pas assez équitable. Mais si nous acceptons de chercher dans l’ombre, là où les habitants vivent, circulent, se souviennent, alors la participation prend une tout autre valeur. Elle devient une enquête collective sur la manière d’habiter un lieu.
C’est ce que j’appelle la démocratie située. Une démocratie qui reconnaît la participation comme une source autonome de connaissance et d’action. Une démocratie qui se nourrit des attachements, des imaginaires, des corps en mouvement. Une démocratie qui accepte l’incertitude et le désaccord, au lieu de chercher à les lisser.