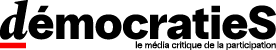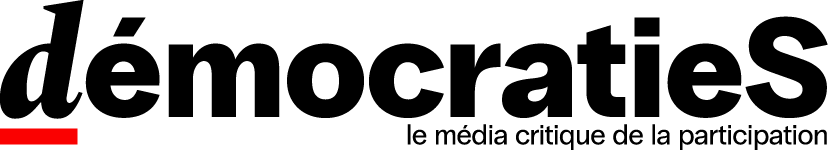Entretien avec
Yannick Gauthier
Docteur en science politique
La participation citoyenne dans la politique de la ville n’est plus ce qu’elle était. C’est la thèse portée par Yannick Gauthier qui en a étudié l’évolution, avec un regard plutôt critique.
Remontons un peu le temps : pouvez-vous dessiner la généalogie du lien entre quartiers populaires, politique de la ville et participation citoyenne en France ?
Après la seconde guerre mondiale, les autorités politiques encouragent l’immigration pour reconstruire le pays et nourrir ses industries en main d’œuvre. À cette époque, des bidonvilles sont érigés pour loger les travailleurs précaires ; l’exemple typique, c’est Nanterre. En 1954, l’abbé Pierre dénonce le problème du mal-logement. Mise à l’agenda politique, la réforme aboutit à la naissance des grands ensembles en 1957-1958. Mais dès les années 1960, on se rend compte que cette production urbaine avait, en fait, contribué à la ségrégation géographique et sociale des classes populaires et immigrées.
Partant de ce constat, plusieurs acteurs se mobilisent pour faire participer les habitants des quartiers populaires à l’amélioration de leur cadre de vie [1]. Mais les autorités publiques souhaitent, elles, limiter la responsabilité des habitants, des associations et des acteurs locaux à l’animation collective de leur quartier.
Ce décalage entre les aspirations démocratiques et la réalité des politiques publiques locales est fustigé par des mouvements sociaux qui se mobilisent dans les luttes urbaines des années 1960-1970 (lire l’article de Julien Talpin). Émergent là quelques-uns des épisodes les plus emblématiques de la participation citoyenne française : le conseil de résidents à Sarcelles, le groupe d’action municipale (GAM) à Grenoble et surtout l’atelier populaire d’urbanisme (APU) à Roubaix. Ces expériences de participation citoyenne ont un point commun : elles favorisent le développement du pouvoir d’agir des habitants des quartiers populaires et leur implication directe dans le processus décisionnel, au sein de structures à la fois inclusives, souples et ascendantes. C’est une perspective communautarienne très inhabituelle pour la France qui défend un paradigme universaliste.
Alors que la politique de la ville a accompagné la structuration et un certain développement de la participation citoyenne, pourquoi n’est-ce plus le cas aujourd’hui ?
Dans les années 1980, ce mouvement de démocratisation des processus décisionnels gagne l’État lorsqu’est engagée la décentralisation. En fait, le Parti socialiste se sert de la démocratie locale pour contourner des institutions politiques encore bien enracinées à droite. Cette approche jacobine donne aussi un rôle central à l’appareil étatique qui doit colmater la fracture territoriale pour réaliser l’égalité entre les citoyens et préserver l’idée de l’unité républicaine. Désormais, les quartiers populaires relèvent d’une catégorie d’action publique et leurs problèmes sont traités sous l’angle de l’exclusion. Les expérimentations d’antan sont institutionnalisées dans des dispositifs d’action publique : c’est la démocratie de proximité.
Après la création du ministère de la Ville en 1990, l’idéal de la démocratie locale connaît une éclipse prolongée dans le discours de l’État. La participation des habitants devient superflue, seule importe leur adhésion à des projets élaborés pour eux mais sans eux. Dans les années 2000, si la politique de la ville suscite l’implication des citoyens, c’est moins pour participer à sa fabrique que pour y résister. Cette politique publique devient l’affaire des élus et des agences, tandis que les dispositifs de démocratie participative sont institutionnalisés et instrumentalisés pour servir les stratégies locales ; c’est l’exemple des conseils de quartier créés en 2002.
Depuis les révoltes sociales de 2005 [2], les quartiers populaires sont assimilés à des ghettos dont l’existence même constituerait une menace pour la République française. Autant dire que le contexte n’est pas particulièrement propice à la démocratisation de la démocratie dans les quartiers populaires à cette époque-là ! Et les choses n’ont pas vraiment évolué depuis le discours de Grenoble prononcé par Nicolas Sarkozy en 2010.
Pourtant, la réforme de la politique de la ville de 2014 n’a-t-elle pas remis la question de la participation citoyenne à l’agenda politique ?
Face à une situation de crise de plus en plus aigüe dans les quartiers populaires après l’abandon du plan Espoir Banlieues de 2008, des élus, professionnels, militants et chercheurs universitaires forment une coalition de cause au sein de l’Association des maires ville et banlieue de France (AMVBF) et le collectif Pouvoir d’agir. Ils font la promotion de l’empowerment [3]. Mais après l’élection présidentielle de 2012, la refonte de la démocratie participative n’est pas mise à l’agenda. En fait, la réforme est essentiellement fondée sur des enjeux managériaux et austéritaires imposés par la Cour des comptes.
Cependant, la coalition de cause poursuit sa mobilisation et ses revendications se diffusent par l’intermédiaire d’alliés au sein du cabinet du ministre délégué chargé de la Ville. Finalement, une mission sur la participation des habitants des quartiers populaires est confiée à Mohamed Mechmache, un militant des quartiers populaires qui s’est fait connaître pendant les révoltes sociales de 2005 et à Marie-Hélène Bacqué, une chercheuse reconnue pour son expertise et son engagement.
Quelles sont les propositions du rapport Bacqué-Mechmache de 2013 ?
Dans leur rapport [4], les auteurs préconisent de mettre en œuvre une stratégie d’empowerment à la française. Ils défendent la création de tables locales de concertation, inspirées par les tables de quartier montréalaises. Ce sont des structures informelles, créées si besoin par les habitants et les associations à l’échelle d’un quartier, dans une approche ascendante. Idéalement, les tables de quartier sont orientées vers l’action, bénéficient du soutien financier de l’État et jouissent d’une indépendance et d’une autonomie vis-à-vis des élus locaux.
Pourquoi ces tables locales de concertation ne se retrouvent pas dans la Loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 ?
Au sein du gouvernement socialiste, François Lamy est pris dans un rapport de force politique défavorable. Dans le contexte des élections municipales de 2014, le ministre ne voulait et ne pouvait pas aller trop loin sur cette question. C’est la refonte de la géographie prioritaire qui constituait l’enjeu central de la réforme de la politique de la ville, pas la participation citoyenne ! Plutôt que les tables locales de concertation, le ministre a choisi de créer les conseils citoyens sur le modèle des conseils de quartier.
Malgré des avancées (principe de coconstruction, mise en place obligatoire, tirage au sort, indépendance et autonomie vis-à-vis des pouvoirs publics), les conseils citoyens s’inscrivent dans la longue histoire décevante de la démocratie participative à la française.
Comment s’orientent les nouveaux contrats de ville, qui viennent d’être signés, en matière de participation citoyenne ?
Tout d’abord, il faut rappeler que les autorités publiques ont pris beaucoup de temps à mettre en place les contrats de ville 2024-2030. Comme cette politique publique a été reléguée tout en bas de l’agenda gouvernemental, les contrats de ville ont été prorogés — c’est-à-dire que leur échéance a été renvoyée à une date ultérieure — par trois fois.
En réponse aux attentes des acteurs de la politique de la ville, Olivier Klein, alors ministre délégué chargé de la Ville et du Logement, s’est déclaré favorable à des démarches de participation citoyenne plus souples qui permettraient de développer le pouvoir d’agir des habitants. En novembre 2022, le ministre de la Ville a d’ailleurs confié une mission en ce sens à Mohamed Mechmache. Finalement, le rapport a été validé à la fin du mois de juin 2024, mais il n’a jamais été publié.
Parmi les propositions de la commission Mechmache [5], on retrouve le droit de vote des résidents étrangers non-communautaires aux élections locales, le financement d’un fonds d’initiative citoyenne ou encore la reconnaissance et le soutien à toutes les formes de participation citoyenne (pas seulement les dispositifs descendants). Le message est clair : ce qui manque, ce ne sont ni les diagnostics, ni les propositions, c’est la volonté politique !
Entretien réalisé par Sylvie Barnezet
Les conseils citoyens
Promulguée le 21 février 2014, la Loi de programmation pour la Ville et la cohésion urbaine (dite loi Lamy) dispose dans son article 7 de l’installation obligatoire des conseils citoyens dans les 1 514 quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ces dispositifs de démocratie participative ont vocation à être associés à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des contrats de ville dans une démarche de coconstruction inscrite pour la première fois dans la législation française.
Composés d’un collège d’habitants constitué par tirage au sort paritaire — c’était une innovation majeure, qui a récemment été abrogée — et d’un collège d’associations et d’acteurs locaux, les conseils citoyens participent à toutes les instances de pilotage de la politique de la Ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain.
Pour ce faire, ils exercent leur activité dans le respect des valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité et de neutralité, en toute indépendance et en toute autonomie vis-à-vis des pouvoirs publics qui sont tenus de garantir l’accès aux ressources nécessaires à leur fonctionnement (moyens, lieux de réunion et actions de formation).
En l’absence de décrets d’application, c’est un cadre de référence national dépourvu de portée juridique qui oriente la mise en œuvre des conseils citoyens dans les collectivités territoriales. En fait, les débats parlementaires ont conduit le législateur à la négociation de compromis politiques qui ont engendré un cadre juridique ambigu et des dispositions non-contraignantes.