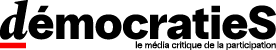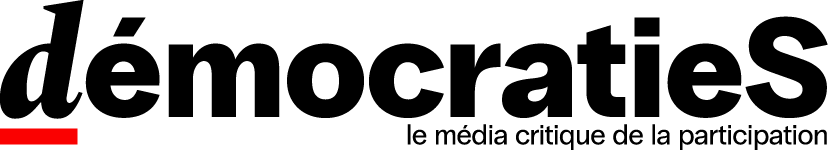Entretien avec
Myriam Ouddou
Co-fondatrice du collectif Le Lichen
L’association le Lichen développe une méthode de mise en dialogue des intérêts humains et non-humains qui renouvelle les pratiques de concertation traditionnelles. Mais ce n’est pas si simple de faire évoluer les pratiques dans les institutions, indique Myriam Ouddou, co-fondatrice du Lichen.
Quels sont les constats partagés qui ont donné lieu à la création du Lichen ?
Premier constat : nous, êtres humains, nous faisons intrinsèquement partie du vivant et sommes interdépendants avec le reste du vivant. D’un côté, l’effondrement de la biodiversité est fortement lié aux activités des humains sur les écosystèmes et, de l’autre, nous repérons les bienfaits des vivants sur les êtres humains, en termes de santé et de réponses à nos besoins essentiels, comme respirer, manger, boire, nous réchauffer. Mais nous ne souhaitons pas nous contenter d’un nouveau récit anthropocentriste dans lequel l’humain serait le grand sauveur de la nature….
Deuxième constat : pour nous, le vivant a une valeur intrinsèque en tant que forme de vie et en tant qu’habitant de la Terre, comme nous, en tant que sujet plutôt qu’objet, avec des intérêts, des besoins, des ressentis selon les espèces. Le principal rapport que nous avons au vivant aujourd’hui est un rapport de domination, d’exploitation, un rapport très utilitariste. Or, la valeur du vivant ne doit pas dépendre seulement de l’utilité à l’être humain. Nous devons passer d’une logique de domination à une logique de cohabitation harmonieuse entre vivants.
Lorsque le Lichen[1] a été créé, il existait des écrits de nombreux intellectuels sur la nécessité de transformer notre rapport au vivant. Mais comment l’organiser, comment tester ce que serait véritablement un Parlement de l’eau ou de la forêt, comment représenter le vivant… Tout cela n’était pas pensé.
Nous avons voulu créer un lieu de croisement de différents savoirs pour expérimenter comment nous pourrions nous reconnecter au vivant et tenter de prendre en compte ses intérêts et ses besoins, notamment dans la manière dont on aménage nos espaces de vie. Nous avions besoin de cet espace pour expérimenter de manière libre, en croisant des savoirs.
Quels sont les objectifs des méthodologies que vous développez pour rendre concrète, pratique et sensible la relation aux vivants ?
Avec nos méthodologies, nous souhaitons opérer un décentrement, un changement de regard et de représentation du vivant. L’expérience sensible est un levier de transformation, car cette façon de travailler engage, au-delà de la pensée rationnelle, le corps, les émotions, l’intuition, l’imaginaire. Pour cela, il est nécessaire d’opérer à la fois une transformation intérieure – celle de notre propre relation au vivant – et une transformation collective – celle des institutions, pour qu’elles prennent en compte les besoins et intérêts de tous les vivants dans les décisions qui les concernent. Mais encore très peu d’institutions ont testé ces approches, c’est embryonnaire. Des collectivités commencent à envoyer leurs agents se former, c’est un premier pas.
Comment avez-vous construit votre méthode de concertation avec les vivants ?
Nous avons croisé nos compétences. L’un est expert en concertation et s’est inspiré des
jurys citoyens. De mon côté, j’utilisais des méthodes de design. D’autres personnes proposaient déjà des approches sensibles… C’est un peu la magie du brainstorming. Nous tâtonnons, nous faisons évoluer les méthodes en les testant. Au départ, nous avions une approche théâtrale, menant à de la confrontation. Nous partions d’une proposition d’un représentant, les personnes réagissaient, donnaient leurs avis. Nous nous sommes rendus compte que cela construisait de l’opposition contre les humains, alors que nous souhaitions trouver des solutions qui répondent à nos intérêts collectifs. Depuis, nous partons plutôt des problèmes posés par un représentant d’une espèce (trop de lumière, pas assez d’eau, par exemple), pour croiser les perspectives des vivants du lieu, faire émerger les interdépendances et aboutir à des alliances et des compromis.
Certaines collectivités ont-elles testé vos méthodes ?
Nous avons eu une expérience à la fois intéressante et compliquée avec une collectivité. Nous avons organisé un atelier sur une problématique semi-fictive, avec des agents de la collectivité, sur un enjeu de réaménagement d’un parc urbain à propos duquel un processus de concertation avait été mis en place entre humains. Nous avons construit un récit qui revenait sur le passé dans lequel chaque territoire se dotait d’un conseil des vivants, au même type que les conseils citoyens ou les conseils de quartier. La question était : « Comment construire des propositions de réaménagement qui tiennent compte des besoins et des intérêts de chaque habitant et usager – humain et non humain – du parc ? ». C’était une expérimentation des services pour tester l’approche. Des propositions intéressantes ont émergé, comme celle qui consistait à redonner une place à l’eau dans le parc, en faisant ressortir la rivière souterraine ou en créant une mare écologique.
Mais un élu s’en est ému en Conseil municipal en critiquant, avec sarcasme, le fait que la ville avait financé un atelier visant à prendre en compte les intérêts des vivants non humains : la légitimité de ce type de démarche est donc encore à construire. Mais nous sommes optimistes car de nombreuses initiatives émergent.
Comment alors construire la légitimité des méthodes de concertation avec les vivants ?
Les approches sensibles sont éloignées de notre fonctionnement classique qui donne peu de crédit à l’intuition et à l’émotion. Nous semons des graines. Les personnes avec qui nous travaillons vivent des expériences et s’en inspirent dans leurs pratiques. Il est difficile aujourd’hui d’identifier l’impact sur les pratiques de concertation et sur les aménagements. Nous avons besoin de tester ces méthodes sur des projets d’aménagement réels pour avoir des retours d’expériences qui rassurent. Il est important aussi que les institutionnels comme l’Office français de la biodiversité, le ministère de la Transition écologique ou le Parc naturel régional des Bauges [2], continuent à s’emparer du sujet.
Nous sommes donc dans une recherche d’équilibre entre l’utilisation du sensible et l’objectif de transformation territoriale. J’aimerais que peu à peu, nous intégrions ce type de méthode dans tous les processus de concertation liés à l’aménagement des territoires. Mais il faut que certains agents et élus se lancent. La question avance mais nous nous heurtons à la mise en œuvre concrète de l’idée d’intégrer les droits de la nature.
Car les approches scientifiques chiffrées, sur le réchauffement climatique et l’effondrement de la biodiversité, n’entrainent pas les gens. L’approche 100 % rationnelle, coupée de nos émotions, nous mène dans le mur. Pour lutter contre l’effondrement du vivant, il faut agir sur des changements transformateurs, dont le rapport sensible au vivant fait partie. Si nous réparions concrètement notre relation sensible aux vivants, nous pourrions peut-être avancer plus rapidement dans les nécessaires transformations.
Propos recueillis par Sylvie Barnezet