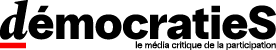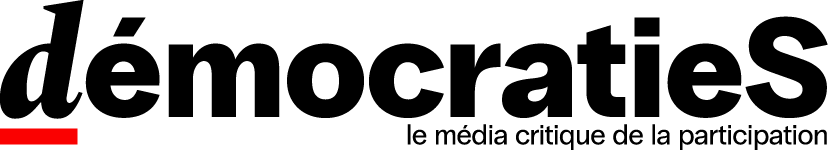Entretien avec
Pascal Ferren
Philosophe, urbaniste à l'agence Camille Alfada et auteur associé à l’Agence Bipolar
Pascal Ferren imagine et expérimente concrètement des méthodes pour approcher la nature par les sens et traduire ses intérêts. Avec des commissaires-interprètes indépendants qui, à l'instar des commissaires-enquêteurs, seraient recrutés, formés et chargés d'intervenir sur des projets d’aménagement pour traduire l'avis de la nature.
Quelles méthodes mettez-vous en place, tant pour récolter que pour traduire les expressions du vivant non humain dans vos démarches ?
Prenons un exemple. Dans le cadre du projet du grand parc de Lunaret à Montpellier, un vaste espace naturel en plein cœur de ville qui va être transformé, j’ai – avec l’Agence Bipolar – une mission de programmation comportant un fort volet de concertation, afin de transmettre des orientations à un concepteur paysagiste qui assurera la maîtrise d’œuvre. Nous avons proposé deux ateliers. L’un dans lequel nous mobilisons les usagers potentiels humains et un autre pour les non-humains.
Concerter avec le vivant pose deux questions : comment approcher sensiblement la nature ? Et comment traduire ce qui est récolté ? En fait, nous répondons beaucoup mieux à la première question qu’à la deuxième.
Pour aborder un espace naturel avec un groupe, nous disposons de différents outils : les approches sensibles, l’éco-psychologie américaine des années 1970-1980[1], le travail développé par le laboratoire Cresson[2], des jeux de situation (par exemple avec les yeux bandés), des petites méditations guidées, des voyages immobiles… J’utilise beaucoup le silence. L’idée est d’inviter les gens à s’interroger sur ce qu’ils entendent, sur ce qu’ils sentent, à voyager, à s’élever, à imaginer qu’ils sont un oiseau, qu’ils sont la rivière… à se mettre « à la place de », en somme. Ce qui n’est pas si difficile.
La deuxième question est plus compliquée : qu’est-ce que je fais de ce que nous ressentons lors de ces approches ? C’est là que je défends l’intérêt du travail avec des personnes habituées à ce type d’exercice. Pour le grand parc de Lunaret, nous avons sélectionné des humains « traducteurs ». Ce ne sont pas des usagers ni même des voisins du parc, mais plutôt de bons canaux : des interprètes des voix de la nature. Ce qui m’intéresse ce n’est pas leur avis, mais l’avis potentiel de la nature qu’ils transmettent. Et pour bien traduire, il faut être un peu étranger…
Quel est le rôle de ces humains traducteurs ?
Ils traduisent, où essaient de traduire en langage humain les perspectives, visions, intérêts de la nature. J’aime cette analogie de la traduction, je la trouve très riche. Contrairement au gardien, l’interprète n’est pas le protecteur. Un interprète de n’importe quelle langue doit aller vivre dans le pays, comprendre ses codes, s’entraîner. Je pense que pour la traduction des intérêts de la nature, c’est un peu pareil. C’est une traduction complexe, qui demande de la pratique : pratique de la nature elle-même, de l’interprétation, de ses perspectives.
Je crois que de nombreuses personnes en sont capables avec des outils, un peu de formation, en étant guidées, avec un peu de connaissance et du recul. Et cette traduction n’est pas l’apanage des scientifiques, la science est une manière de connaître très rigoureuse, mais il existe d’autres manières de connaître et, surtout, de transmettre les voix de la nature.
Pouvez-vous expliquer votre idée de commissaires-interprètes ?
À l’image des commissaires-enquêteurs et de leurs rôles, très codifiés, des commissaires-interprètes indépendants seraient recrutés, formés et chargés d’intervenir sur des projets d’aménagement pour traduire l’avis de la nature. Au même titre que les commissaires-enquêteurs, ils n’auraient pas le droit d’enquêter sur un territoire où ils ont des intérêts propres.
Avec Bipolar, nous sommes en train de recruter un premier groupe. Ce sont des personnes qui en ont envie et qui ont des compétences potentielles de traduction : un naturaliste, une éco-psychologue, un soignant, une biologiste, un poète, une violoncelliste, une chorégraphe : des manières de connaître et de traduire assez diverses qui vont se compléter.
Comment vous-même, traduisez-vous à l’architecte ou au paysagiste ce qui a été exprimé ?
Je note, j’essaie de faire une liste quasiment oulipienne[3] des paroles partagées par les interprètes. Je note de manière très factuelle, puis j’organise, je fais des sortes de métaplans de concertation. On pourrait dire que je traduis, in fine, en langue programmatique, les traducteurs de la nature.
Les participants vont dire : « quand on a marché, j’ai senti beaucoup de sécheresse. J’ai trouvé ça très uniforme. J’avais l’impression que là-bas, loin du chemin, les vivants étaient plus heureux. J’avais l’impression que les chemins étaient morts, j’avais envie d’aller jouer dans la forêt, etc. » Parfois c’est encore plus vague. Le langage utilisé par les gens est souvent assez poétique. Si je conserve l’exemple du Lunaret, ils vont parler de chaleur, de sensations, d’odeurs, d’impressions. Je vais alors dire aux concepteurs : « N’oubliez pas que le paysage méditerranéen est un paysage d’odeurs ». Je vais écrire qu’il y a un problème avec l’uniformité des chemins, qu’il faut peut-être créer des chemins de traverse, varier les qualités de chemin. À noter que cela fonctionne aussi parce que je croise tout cela avec d’autres ateliers et une analyse du site, évidemment.
Le détour par l’artistique peut-il être enrichissant ? De quelle manière ?
Je crois aux moyens artistiques dans la traduction des intérêts de la nature. Dans l’exemple dont nous parlons, nous avons organisé un atelier sensible avec une improvisation musicale et je suis passé par un travail poétique. On peut aussi mobiliser la chorégraphie : à la fin de l’expérience sensible, plutôt que de partager des mots, il est possible de partager des gestes. Cela débloque des imaginaires.
Vous-même, développez-vous des approches artistiques ?
Oui, notamment la Mission relations, une fiction institutionnelle que j’écris et expérimente avec mes amis de Bipolar. C’est un service public potentiel qui met en œuvre une politique publique souhaitable, celle de l’écologie relationnelle. Ce service public aiderait les collectivités et les organisations publiques locales à produire des avis de la nature, via les commissaires-interprètes notamment, à démêler des conflits entre espèces, à célébrer des attachements, à mettre en œuvre une planification affective des territoires. Nous essayons, via des performances, des formes publiques, des expérimentations, de rendre crédible cette écologie du sensible. La crédibilité et la légitimité de ces approches, souvent caricaturées ou renvoyées aux sphères de l’intime, du soin ou de la sorcellerie, sont fondamentales.
Les espaces ainsi conçus sont-ils différents ?
Nous sommes à la maternelle de cette école de l’approche sensible. Mais la manière d’envisager les espaces publics serait différente sans ce type d’approche, c’est sûr. Reprenons l’exemple du grand parc de Lunaret. La collectivité souhaitait créer des belvédères. Notre atelier a questionné cette idée : que voulons-nous voir ? Faut-il forcément voir loin ? N’aurions-nous pas envie de voir de près ? Parce que la nature est proche… Le travail sur les odeurs nous a amené à nous demander ce que serait un belvédère à odeurs.
Vos démarches permettent-elles de travailler les conflits de perceptions et d’usages ?
Je crois, oui. Si vous avez des outils pour pluraliser les intérêts en présence, c’est-à-dire montrer qu’il existe d’autres intérêts, comme les intérêts de la nature mais aussi de certains groupes d’humains, le conflit sera beaucoup plus fertile.
La démarche doit commencer par une explicitation des intérêts en présence. Et c’est seulement à partir de là qu’il est possible de négocier. Le fait de mettre le vivant dans l’espace de débat enrichit cet espace. Prenez l’exemple d’un barrage et d’un projet d’usine hydroélectrique. La concertation associe les pêcheurs qui souhaiteraient pêcher des carpes, mais il faudrait également entendre les carpes elles-mêmes. Il faudrait donner la parole aux moules perlières, aux gardons, tout comme aux sédiments. Cela permettrait de construire des alliances différentes, de recomposer les jeux d’opposition. Il n’y a pas de raison pour que les vivants non humains ne soient pas représentés dans la négociation.
Propos recueillis par Sylvie Barnezet