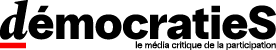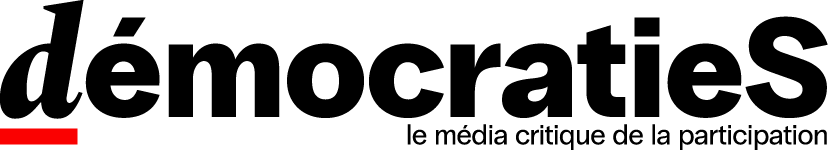Entretien avec
Alexandre Zabalza
Professeur de droit à l'université de Bordeaux
Théoricien du « bien commun environnemental », le professeur de droit Alexandre Zabalza teste cette innovation juridique avec les habitants de la Vallée du Ciron (Gironde) pour défendre ce territoire menacé.
Comment le droit peut-il prendre en charge la reconnaissance du vivant non humain ?
J’ai émis de sérieuses réserves, pendant longtemps, avant de reconsidérer le sujet à la lumière d’une autre approche, celle des communs. Je crois qu’il faut comprendre les droits de la nature à travers deux éléments fondamentaux de notre rapport au monde : d’un côté, la terre en tant que ressource commune ; de l’autre, la maison dans sa dimension symbolique, qui dit quelque chose de nos manières d’habiter cette terre.
Le droit est l’architecture de notre culture : il construit des repères, il résiste aux effondrements. Alors, sur quoi peut-on s’appuyer ? D’abord sur le droit de l’environnement, centré sur la protection des intérêts humains. Mais il me semble nécessaire de lui adjoindre des droits de la nature, pour prendre en compte, autant que possible, les intérêts propres des entités naturelles. Ensuite, sur le droit civil, en particulier sur la notion de bien commun. Le code civil reconnaît d’une part les biens et d’autre part les choses communes, mais rien entre les deux. C’est là qu’il faut innover, en créant un véritable régime juridique des biens communs qui, aujourd’hui, n’existe pas.
En quoi serait-ce une voie préférable à celle, généralement évoquée, de la personnification d’un écosystème ou une espèce ?
C’est vrai que, logiquement, on associe les droits à la personne juridique. Pour le sens commun, c’est simple : si on reconnait des droits à la nature, alors il faut en faire une personne. C’est ce que montrent de rares cas récents, comme le fleuve Whanganui en Nouvelle-Zélande et la Mar Menor en Espagne [Lire l’article]. C’est une possibilité, mais ce n’est pas la seule. Et surtout, l’idée suscite beaucoup de résistance chez les juristes parce qu’elle bouscule une distinction ancienne[1] : les entités naturelles – arbres, rivières, montagnes… – ne sont pas des personnes.
Je défends une autre voie. On peut très bien reconnaître des droits à une entité naturelle sans en faire une personne. Dans ce cas, il faut qu’il y ait une personne chargée de défendre ces droits. Il faut distinguer le sujet titulaire des droits (par exemple, le fleuve) et la personne qui agit pour lui (une association, une autorité publique…)[2]. C’est l’intérêt de la perspective des communs.
Vous mettez votre réflexion théorique à l’épreuve du terrain, en accompagnant les habitants de la vallée du Ciron. Avec quelle portée ?
En France, aujourd’hui, aucune déclaration citoyenne sur les droits de la nature n’a de valeur juridique. Mais ce n’est pas une raison pour ne rien faire. Avec les habitants de la vallée du Ciron, nous avançons pas à pas. Nous traçons un chemin qui, dans deux, dix ou quinze ans, pourra peut-être déboucher sur une loi, voire une inscription dans la Constitution. À notre échelle, nous essayons de construire une boussole des communs.
Parfois, il suffit d’un juge un peu audacieux pour changer la donne. Regardez ce qui s’est passé en 2024, au tribunal de Nantes : un couple veut faire couper le magnolia des voisins qui gêne une nouvelle fenêtre qu’il a fait poser. Le couple est dans son droit, les règles d’urbanismes sont respectées. Mais le juge refuse. Il considère que couper l’arbre serait une atteinte disproportionnée à la biodiversité du lieu. C’est un cas rare, presque inespéré, le couple avait 99 % de chances de gagner. Mais un jugement peut déplacer les lignes. Cela montre que la transition vers les droits de la nature peut venir d’en bas, du terrain. Aujourd’hui, le juge lui-même est attentif à la protection de l’environnement.
Quelle démarche adoptez-vous dans la vallée du Ciron ?
Nous travaillons uniquement avec les habitants, sans importer de modèle tout fait. Ce qui compte pour nous, ce sont les liens anciens entre les amoureux du Ciron et ce territoire. Les gorges du Ciron traversent une forêt de hêtres présente depuis 40 000 ans. Ce lien est vivant : quand l’eau baisse en température dans les gorges, cela crée un brouillard qui enveloppe les vignes et permet la pourriture noble du Sauternes. C’est un équilibre fin entre nature, climat et culture.
En identifiant la vallée comme un “bien commun environnemental”, les habitants tiennent à démontrer que ce lieu est aussi un bien commun culturel, qui entre dans le patrimoine commun de la nation. Les droits permettent d’éclairer cela. Pendant un an, nos étudiants du diplôme universitaire de droit de l’environnement[3] ont mené un diagnostic de terrain. Ils ont étudié la biodiversité, mais aussi les moulins, la cuisine locale, les pratiques artisanales… Avec le droit, on cherche à réarticuler ce qui fait l’identité d’un lieu : sa géographie naturelle et sa culture.
Le rapport final, remis au Conseil départemental, fait plus de 400 pages. Mais, derrière ce travail, il y a une lutte plus large : la vallée est menacée par un projet de ligne à grande vitesse, alors qu’elle est déjà traversée par deux autoroutes. Les habitants interpellent l’Etat et la Région : « Comment voulez-vous que notre territoire survive s’il est découpé en onze petits bouts ? » J’ai envie de reprendre une citation de Bernard Charbonneau, dans Tristes Campagnes : “On pleure les indiens des autres, mais on tue les siens”.
Comment le mouvement organise-t-il la défense de la vallée ?
La communauté qui s’est mobilisée autour des droits du Ciron vient de se constituer en association, Ciron Bien Commun (CBC). La communauté, qu’on appelle aussi “le peuple du Ciron”, a rédigé une déclaration de droits. La création de l’association a demandé un an de discussions, de débats, d’ajustements. Et c’est une bonne chose : tout se construit sur une base citoyenne, démocratique, avec une gouvernance collégiale, sans président. Nous inventons en marchant, l’objectif est de créer un véritable parlement du Ciron représentatif de toutes les sensibilités territoriales. Si vous regardez les photos des premières assemblées, on voit beaucoup de cheveux blancs. Certains se sont empressés de le critiquer. Mais sont là des habitants et des amoureux du territoire, toutes sensibilités confondues. Les jeunes générations sont là aussi et l’association prévoit d’intégrer les acteurs économiques, les institutions, les habitants de tous âges.
Il fallait aussi aller vite. La structure juridique permet désormais de saisir un juge, notamment face au projet de ligne à grande vitesse. C’est à la fois une communauté de pensée, un espace d’action, et un outil de défense juridique.
En quoi CDC se distingue-t-il, au tribunal, d’une association classique de défense de l’environnement ?
C’est une association, donc avec le même régime juridique que d’autres structures de défense de l’environnement. Mais son objet social est tout à fait spécifique. Nous en avons pesé chaque mot pour que, dès les premières lignes des statuts, un juge puisse comprendre l’intérêt à agir. Nous y inscrivons d’emblée la notion de bien commun environnemental et nous définissons l’écosystème du Ciron par ses dimensions biologiques, hydrologiques et culturelles[4].
C’est la vraie question aujourd’hui, pour nous : comment faire reconnaître l’intérêt à agir au nom d’un territoire ? Au fond, on revient à la question fondamentale posée, dès les années 1970, par Christopher Stone[5] : les arbres doivent-ils pouvoir plaider ? Ce n’est pas un slogan poétique. C’est un point précis, juridique, stratégique. C’est là que tout se joue.
Propos recueillis par Valérie Urman