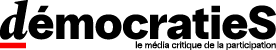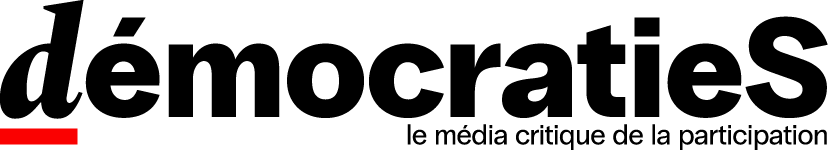Entretien avec
Julien Talpin
Directeur de recherches en science politique au CNRS
Il faut renforcer l'articulation entre démocratie délibérative, démocratie d'interpellation et démocratie directe en expérimentant le Référendum d'initiative citoyenne (RIC) : ce sont les pistes de Julien Talpin dans son ouvrage qui vient de paraître [1] , à partir de dix ans d'immersion dans les quartiers de Roubaix.
Roubaix et le quartier de l’Alma-Gare : pour la participation, c’est quasiment une expérience fondatrice. Qu’en reste-t-il aujourd’hui ?
Roubaix a été, dans les années 1970-1980, à l’avant-garde de l’innovation démocratique avec des expérimentations qui ont eu des répercussions sur le développement social des quartiers, sur la figure des chefs de projet et plus largement sur la démocratie participative. Mais cette histoire s’est un peu étiolée et, depuis les années 2000, la ville de Roubaix est moins innovante sur ces sujets. La culture politique héritée de l’Alma-Gare – faite de l’articulation de la coopération et du conflit – s’est peu à peu éteinte, même si elle reste portée par certains collectifs comme l’Université populaire et citoyenne (UPC).
Cependant, des héritages de cette expérience subsistent aujourd’hui dans les quartiers populaires. La rénovation urbaine et le logement, notamment, restent des questions centrales pour les organisations collectives, dans les démarches de participation et dans le rapport aux politiques. C’était vrai dans les années 1970, ça l’est encore aujourd’hui. Le deuxième héritage est la fait que l’imaginaire de l’Alma-Gare continue de nourrir des formes de participation ascendantes. Par exemple, il y a de nouveau un combat dans le quartier de l’Alma, à Roubaix, autour d’un projet de rénovation urbaine qui se nourrit de ce qui s’est passé dans les années 1970 et qui mobilise explicitement cette mémoire. Avec des espaces d’auto-organisation et des souhaits de négociation pour donner des débouchés aux interpellations et aux propositions des citoyens, comme cela s’était déroulé historiquement. C’est d’ailleurs ce qu’on a plus de mal à voir aujourd’hui : les collectifs n’arrivent pas à trouver des espaces de négociation politique.
Les quartiers populaires ne sont pas des déserts politiques. Les gens parlent beaucoup de politique. Ils interprètent les difficultés qu’ils rencontrent à partir de facteurs politiques : les expériences de discrimination, d’inégalité et d’injustice sont souvent analysées par des prismes politiques. Mais cette politisation ordinaire trouve difficilement des canaux collectifs d’expression. Ce paradoxe est le point de départ de mon interrogation.
Les mobilisations des Gilets jaunes et des quartiers populaires sont-elles similaires ?
Les quartiers populaires n’ont pas participé majoritairement au mouvement des Gilets jaunes. Est-ce à dire que ces mondes sociaux seraient complètement séparés ou opposés ? Dans les quartiers aujourd’hui, chez les descendants de l’immigration postcoloniale, les questions de discrimination, de racisme, d’islamophobie, de violences policières structurent les sentiments d’injustice. Dans leur relation à l’institution, aux services publics, à l’école, ils n’ont pas le sentiment qu’on favorise leur accès aux droits et ils disent être traités comme des citoyens de seconde zone.
Ces questions animent beaucoup moins la France périurbaine, la France des bourgs, ou la France rurale. Il y a malgré tout des points de jonction. Les colères et les sentiments d’injustice dans les quartiers, comme chez les Gilets jaunes, sont orientés vers l’État, qui est la cible principale du mécontentement populaire. Les institutions au sens large (police, école, mairie…) sont jugées responsables des inégalités et des discriminations. J’identifie donc une attente d’État et une demande de services publics. Si les gens sont très critiques envers les défaillances, voire les maltraitances institutionnelles, ils ne sont pas pour autant anti-État. La critique est à la hauteur des attentes.
Quels sont les facteurs qui réduisent l’expression des collectifs et des mouvements associatifs des quartiers ?
Je mets en avant trois facteurs. Premièrement, la question des libertés associatives. On ne laisse pas véritablement les formes d’organisation s’exprimer pleinement. Cela passe par une précarisation financière du monde associatif, tout particulièrement dans les quartiers, avec moins de ressources publiques et une forte diminution du nombre d’emplois aidés depuis 2017. Ces postes étaient assez précaires mais jouaient un rôle important de relais du travail associatif. Deuxièmement, le risque d’éventuelles sanctions pour des acteurs jugés trop critiques des pouvoirs publics induit une dépolitisation, des formes d’autocensure du monde associatif. Le troisième facteur, plus interne, tient aux formats de la participation et aux modes d’action dominants dans le monde associatif et participatif aujourd’hui : des réunions publiques, des expositions, des débats avec des sociologues, des formations… Ces formats assez intellectualisants peinent à toucher les plus précaires, les personnes qui ont un rapport conflictuel avec l’école. En outre, on n’obtient pas de victoire en organisant des débats. Pour briser la résignation, il faut montrer que la participation peut servir à quelque chose, qu’elle peut permettre d’améliorer, ici et maintenant, le sort des habitants.
La démocratie d’interpellation serait-elle une solution ?
On doit pouvoir avancer sur ce concept de démocratie d’interpellation, avec ses deux piliers : favoriser l’auto-organisation des collectifs et créer des ouvertures institutionnelles aux interpellations, en travaillant sur la démocratisation de l’action publique. Il faut construire des processus simples et ouverts pour que des collectifs puissent mettre leurs sujets à l’agenda des élus et puissent avoir des retours sur leurs prises en compte.
Les mobilisations ascendantes, notamment associatives, ont besoin de débouchés pour ne pas s’essouffler. Elles ne doivent pas se heurter à des prises de décision unilatérales qui produisent de la résignation et de la démobilisation. Et, de leur côté, il faut que les démarches participatives soient investies, subverties par des acteurs collectifs. On a mis l’accent, depuis vingt ans dans les démarches participatives, sur des citoyens individuels tirés au sort, mais on a aussi besoin d’acteurs collectifs, notamment pour porter la voix des groupes les plus précarisés, marginalisés. Il faut donc cette articulation dialectique entre auto-organisation, participation ascendante et transformation, démocratisation des institutions.
Il faudrait donc travailler en même temps sur la politique de relation aux associations et l’ouverture démocratique des institutions ?
Oui. Cela passe, d’une part, par la revitalisation démocratique des associations. Les critères de financements doivent être beaucoup plus transparents : la composition sociale des publics touchés, la capacité à atteindre des publics précaires, par exemple, pourrait donner un surcroît de financement ; tout comme les modalités d’organisation démocratique interne des associations pourraient conditionner des financements publics. Il y a un enjeu de transparence, de réflexion collective sur ces critères. Les financements ne devraient pas être décidés par les exécutifs seuls, mais par des espaces pluralistes avec des élus de l’opposition, des citoyens tirés au sort, pour sortir du sentiment de dépendance qui contribue à la dépolitisation. Mais cette proposition n’est pas accueillie à bras ouverts par les élus, y compris par les plus les plus fervents soutiens de la participation…
Il faut donc travailler sur les financements des associations, les aider à mettre en avant leurs positions et créer les conditions de débouchés politiques. C’est cet ensemble qui doit permettre de dynamiser et de renouveler les acteurs associatifs.
Et d’autre part, du côté de l’accueil des interpellations, je pense qu’il faut aller vers des formes de démocratie plus directe, y compris à l’échelle locale : il faut expérimenter des Référendums d’initiative populaire (RIC) locaux. Il faut innover, articuler des processus d’interpellation avec des assemblées de personnes tirées au sort dont les propositions déboucheraient sur des référendums locaux. Quand bien même tout ne sortira pas d’innovations procédurales, développer des RIC délibératifs locaux, cela aurait de l’allure !
Je crois que c’est l’articulation entre démocratie délibérative et démocratie directe qui peut contribuer à démocratiser la société.
Entretien réalisé par Sylvie Barnezet
L’histoire des luttes urbaines des années 1970 à l’Alma-Gare
À partir du milieu des années 1970, face à un projet qui devait raser des habitations ouvrières historiques pour construire des HLM, les habitants du quartier de l’Alma-Gare montent au créneau. Le premier Atelier populaire d’urbanisme est créé pour proposer un plan de réhabilitation d’une partie du quartier, plutôt que sa destruction, dans une approche d’autogestion. L’Alma-Gare devient alors, en France, l’une des expériences emblématiques de la démocratie participative. À travers une lutte de plus de dix ans, des années 1970 aux années 1980, des habitants de ce quartier populaire de Roubaix imposent aux pouvoirs publics un contre-projet de réhabilitation de leur quartier.
L’Alma-Gare a été un terrain d’expérimentations des premiers savoir-faire participatifs, en partie repris dans la politique de la ville naissante. Il a nourri l’imaginaire démocratique des militants.
A lire : https://journals.openedition.org/quaderni/1088