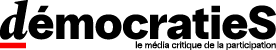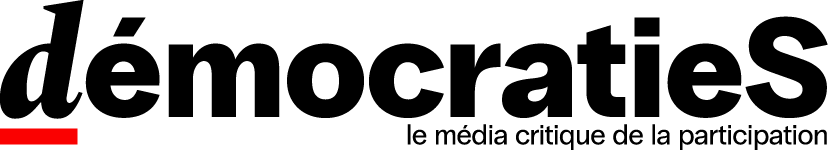Entretien avec
Stéphanie Tawa Lama
Politiste, directrice de recherche au CNRS, Centre de Sciences Humaines de New Delhi
Suchi Pande
Activiste indienne, chercheuse associée au Accountability Research Center, Washington DC.
En Inde, la société civile est à l’origine de dispositifs originaux qui mobilisent les plus pauvres auxquels les autorités viennent rendre des comptes. Mais la dynamique participative est en déclin dans un contexte politique défavorable. Regards croisés de la chercheuse Stéphanie Tawa Lama et de la militante Suchi Pande.
Quelles formes prend la participation citoyenne en Inde ?
Stéphanie Tawa Lama. Le principal dispositif institutionnel est l’assemblée villageoise, la gram sabha[1], que l’État fédéral a progressivement mis en place avec la décentralisation à partir de 1993. Deux amendements à la Constitution indienne ont donné une dignité constitutionnelle et une portée contraignante à la démocratie locale hors période d’élection. L’assemblée du village doit se réunir au moins deux fois par an, tous les citoyens et citoyennes sont invité.es à interagir avec le conseil local en questionnant et en suggérant des actions à mener. La gram sabha est, surtout, le collectif citoyen qui identifie les bénéficiaires des programmes d’aide aux plus démunis.
L’Inde étant une union de 28 États fédérés, chaque État a des marges de manœuvre pour aménager ces assemblées qui ne se ressemblent donc pas partout. Globalement, les gens qui participent sont ceux pour qui c’est le plus important, les pauvres. Pourtant, c’est un processus coûteux en temps, l’assemblée dure une demi-journée et les trajets peuvent être longs dans ces territoires très étendus. En raison de sa compétence sociale, la gram sabha est un dispositif institutionnel utilisé par et pour les pauvres.
Ce public – plus difficile à capter dans les démarches participatives occidentales – s’est-il habitué en Inde aux démarches inclusives ?
Stéphanie Tawa Lama. Les plus pauvres se mobilisent dans ce cadre précis, ce n’est pas le cas d’autres dispositifs institutionnels en Inde. L’équivalent urbain de l’assemblée villageoise, le ward committee, est moins clairement défini dans la Constitution. De ce fait, la plupart des États fédérés ont restreint sa portée participative : dans les deux-tiers des cas, il s’agit d’espaces de délibération entre les élus locaux et les agents des administrations, à l’échelle des quartiers. Delhi, par exemple, compte une douzaine de ward committees, mais ni la présence des citoyens ordinaires ni celle de la société civile organisée n’est prévue.
En réaction à ces limites, l’État de Delhi[2] a expérimenté un autre format, très proche du budget participatif : des assemblées de quartier, les mohalla sabha, ouvertes à tous les électeurs, se réunissent pour définir collectivement des priorités de développement local. Très mobilisateur, cet outil s’est révélé moins inclusif qu’espéré car ceux qui prenaient la parole étaient toujours des hommes, quasiment jamais issus des basses castes et rarement des musulmans – minorité de plus en plus discriminée dans l’espace public. Cette expérience a finalement pris fin, en raison d’oppositions politiques[3].
La participation émerge-t-elle aussi d’initiatives citoyennes ?
Suchi Pande. Les mouvements sociaux des années 1990 sont à l’origine d’un système d’audiences publiques, les jan sunwai [en hindi, « les doléances du peuple »], appelées aussi audits sociaux. Tout est parti des luttes populaires dans le Rajasthan rural où notre ONG, le MKSS [mouvement pour l’empowerment des paysans et des ouvriers] a défendu le maintien de l’emploi et le paiement effectif du salaire minimum. Souvent, les paysans et les travailleurs n’obtenaient pas l’intégralité des heures dues, l’argent disparaissant dans les rouages administratifs corrompus sans qu’il soit possible d’avoir accès aux registres officiels des salaires. Le salaire minimum rural étant une question de survie, les enjeux de transparence et de lutte anticorruption sont vitaux. Nous avons mis au point la méthode des jan sunwai pour entendre les citoyens lors d’un forum public où ils expriment leurs griefs et interpellent la puissance publique. C’est une méthode pour conscientiser les gens sur leurs droits et cela oblige les autorités à rendre des comptes.
Progressivement, cette pratique s’est étendue à d’autres États en répondant aux besoins d’autres luttes sociales. Cette action a conduit à l’adoption de la loi pour le droit à l’information, en 2004 ; puis le jan sunwai est devenu une démarche obligatoire dans la loi sur l’emploi rural garanti adoptée en 2005[4]. En s’institutionnalisant, le jan sunwai a pris le nom d’audit social : la plupart des États ont désormais inclus ces audits dans un ou deux programmes sociaux : le travail garanti et la sécurité alimentaire. Le Meghalaya, petit État dans le nord-est de l’Inde, l’a même étendu à une vingtaine de politiques publiques.
Il a donc fallu élaborer un standard méthodologique, en insistant sur la nécessité de créer des “unités d’audits sociaux” (services dédiés) dans chaque État et de garantir une organisation indépendante des audiences publiques. La société civile doit rester impliquée en tant que tiers organisateur expérimenté, et pour parer les pressions, les menaces pouvant s’exercer pour dissuader les gens de participer.
Dans les faits, qui s’exprime dans ces arènes-là ?
Suchi Pande. Avec les jan sunwai, on est directement passé de la doléance individuelle qui existait sous le régime féodal et colonial à l’expression publique et collective des citoyens. Tout le monde est invité à ces meetings ouverts, quelle que soit sa caste ou sa condition sociale.
Stéphanie Tawa Lama. En Inde, ce n’est pas du tout évident, pour les plus déshérités, de comprendre qu’ils ont des droits. Le sens de la hiérarchie sociale est si prégnant que les gens en bas de l’échelle peuvent interpréter ces droits comme une charité. L’assignation sociale ne les incite pas à revendiquer. C’est important de leur permettre d’interpeller les agents chargés de l’accès au riz à faible prix ou des 100 jours de travail minimum, dans un cadre qui pose clairement ce qui leur est dû. Ce dispositif de conscientisation rappelle, de façon régulière et claire, le fait que l’État a des devoirs et les citoyens ont des droits. En Inde, c’est un grand accomplissement.
Quels sont les impacts des dispositifs de participation ?
Stéphanie Tawa Lama. Dans certains cas, ils stimulent la participation électorale, c’était clairement le cas à Delhi. En Inde, la participation électorale est beaucoup plus forte dans les campagnes que dans les villes, la grande mégapole de Delhi étant l’un des endroits où les gens votent le moins. Quand les mohalla sabha ont été mises en place, la participation électorale a fait un bond spectaculaire, de plus de 10 points.
Les auditions publiques bousculent le jeu d’acteurs traditionnel. Ceux qui prennent l’habitude de se confronter aux citoyens peuvent mettre à profit cette capacité à accueillir les revendications pour incarner un État certes imparfait mais bienveillant et puissant. Si les bureaucrates tentent souvent d’éviter les audits sociaux, certains y vont pour gagner des marges de manœuvre dans leur propre administration.
La dimension délibérative – pas seulement pour appliquer les droits sociaux mais aussi pour construire les politiques publiques – est-elle un horizon démocratique en Inde ?
Stéphanie Tawa Lama. Cette ambition existe dans les discours politiques, mais le terme délibération n’est jamais employé, seulement les termes participation, échanges. Le premier élément mis en avant est la coprésence des citoyens, des élus et des agents, car ces occasions sont rares malgré tout.
Le grand défi est d’amener un collectif diversifié à dialoguer. C’est pourquoi le jan sunwai cherche une autre façon de faire parler les plus pauvres : les organisateurs savent qu’ils ne feront pas débattre les activistes, les bureaucrates, la classe moyenne urbaine et les paysans pauvres. Ils passent donc par le témoignage, avec une succession de présentations de cas et en utilisant au besoin des éléments culturels comme la chanson, les marionnettes ou le théâtre de rue, pour encourager les invisibles à se sentir légitimes à parler. Cela ne prend pas la forme d’une réunion publique au sens d’Habermas[5], néanmoins si l’on écoute bien, des choses sont dites qui attendent des réponses. Quelque chose se joue de l’ordre de l’échange d’arguments raisonnés.
Comment ces démarches participatives évoluent-elles actuellement ?
Stéphanie Tawa Lama. L’évolution actuelle va vers moins de délibération et plus de consultation. Les audits sociaux perdurent mais les autorités en minorent la portée critique. Désormais, les audiences publiques relèvent plus de la gestion de projet et moins de la conscientisation. Exemple symptomatique : au sud de l’Inde, l’État de l’Andhra Pradesh a introduit les audits sociaux dans ses politiques : il s’agit de réunions où les citoyens sont invités à noter individuellement une chose importante pour eux. Les agents publics recueillent ces avis sans ouvrir de discussion collective. Il s’agit clairement d’un aplatissement de la participation.
De façon générale, le climat politique actuel n’est pas favorable à l’effervescence participative.
Suchi Pande. Quand le Premier ministre Narendra Modi a accédé au pouvoir en 2014, il a tenté de démanteler la loi pour l’emploi rural garanti, qu’il considère comme un échec dispendieux. Il n’a pas réussi, mais la forte dynamique en faveur des audits sociaux n’existe plus. Malgré tout, les activistes continuent d’agir. Pas un gouvernement local n’a renoncé aux audits sociaux, même si certains peuvent être tentés de banaliser des formes faibles.
Avec la généralisation des audits sociaux, les États ont intégré certains principes participatifs. Dans des territoires comme le Bihar[6], il était impensable de faire dialoguer des castes sociales différentes et de faire participer des femmes. C’est le cas aujourd’hui. Cet État forme même ses agents à l’organisation d’audits sociaux.
Les ONG internationales constatent le fort recul de l’Inde au classement des démocraties dans le monde. Comment voyez-vous l’avenir ?
Stéphanie Tawa Lama. Au prochaines élections législatives, au printemps 2024, cela fera dix ans que Narendra Modi est au pouvoir. C’est un gouvernement caractérisé par une centralisation croissante du pouvoir et par le culte du leader. Ces deux éléments ne favorisent pas la participation. Cela étant, les principales démarches participatives que j’ai évoquées sont les initiatives d’États fédérés où le BJP, le parti de Narendra Modi, n’est pas nécessairement au pouvoir. A Delhi, le parti de l’Homme Ordinaire (AAP), au pouvoir depuis 2014, a abandonné la participation citoyenne, qui était pourtant un élément central de son identité politique. Ce parti radical s’est mué en parti gestionnaire, avec un leader qui révèle des tendances autoritaires. La vision ambitieuse de la participation, testée avec la mohalla sabha, s’est essoufflée en raison des multiples résistances et parce qu’elle ne rapporte par les bénéfices escomptés : le parti a gagné des élections mais en a aussi perdu d’autres ; au regard du calcul coût-bénéfice, le parti a considéré, par exemple, qu’il pouvait développer son grand programme d’éducation avec peu de participation et beaucoup de gestion par le haut. Les assemblées participatives ont bien joué un rôle, en plaçant les équipes pédagogiques dans un dialogue régulier avec les familles. Mais les dépenses massives ont permis de recruter des enseignants, d’équiper des salles de classe, de construire des écoles : c’est cela que le parti met en avant pour se faire élire dans d’autres États.
C’est donc toute la scène politique qui cède au repli autocratique ?
Stéphanie Tawa Lama. L’esprit participatif semble éteint en Inde. J’ai identifié trois cycles participatifs dans l’histoire du pays, le dernier a commencé dans les années 1990, marqué par la politique de décentralisation et par tous les dispositifs participatifs que nous avons évoqués ici. Mais il s’est progressivement ralenti ces dernières années. Ce cycle est aujourd’hui terminé, selon moi.
La dynamique politique indienne est maintenant organisée tout entière autour de ce bulldozer qu’est Modi : un leader charismatique, à la tête d’un parti puissant, idéologiquement solide, infiniment mieux doté financièrement que ses concurrents. Dans ce contexte, la participation n’est plus une stratégie prioritaire.
Y a-t-il encore une place pour l’initiative citoyenne et l’inventivité sociale ?
Stéphanie Tawa Lama. La société civile a toujours porté la demande de participation, et elle a toujours été la source de la critique, parfois dans une confrontation dure. C’est ce qui a fait la grandeur de la démocratie indienne. Or, le gouvernement Modi considère toute critique comme une attaque. Il a supprimé l’accès aux financements étrangers à des milliers d’associations qui, de ce fait, mettent la clé sous la porte.
L’Inde a été une si grande démocratie que l’on espère sa résistance. Toutefois, lors des dernières élections régionales, le BJP a encore remporté trois États sur quatre. La dynamique en vue des élections législatives reste très favorable au parti de Narendra Modi.
Suchi Pande. L’activisme politique est menacé et réprimé. L’activisme social conserve un espace pour agir, trouve des brèches. C’est difficile, mais seule l’action nous permet de rester optimistes.
Propos recueillis par Valérie Urman