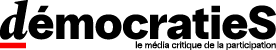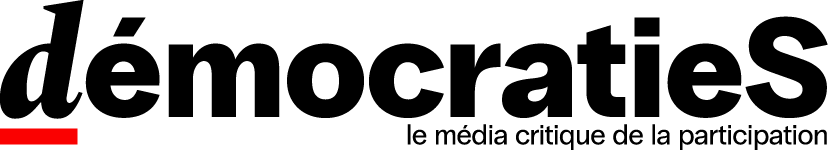Entretien avec
Philippe Descola
Anthropologue, professeur émérite au Collège de France.
L'anthropologue Philippe Descola invite à revoir radicalement notre relation aux mondes vivants pour être en mesure d'imaginer la transition écologique. Fervent soutien des expérimentations sociales menées dans les ZAD, le chercheur milite aussi pour le renouvellement démocratique.
« La nature, ça n’existe pas ». D’une formule, fameuse, l’anthropologue Philippe Descola résume l’œuvre[1] qui a renouvelé l’écologie en invitant à rompre avec les illusions du «naturalisme ». « Le naturalisme, c’est croire en l’existence de la nature, c’est-à-dire une totalité de non-humains vis-à-vis de laquelle les humains sont dans une position de surplomb, d’extériorité, de sorte que la nature devient un système de ressources, un objet d’investigation scientifique et, dans certaines circonstances, un objet de délectation qu’il faut protéger quand on l’a trop massacré, toujours en position d’extériorité ». Le concept de nature – tellement ancré qu’on ne trouve plus d’autre mot – façonne notre rapport au monde depuis trois siècles, nous dit Philippe Descola. Il forme le soubassement de l’économie marchande mondialisée qui détruit le climat et la planète. Cette séparation entre les humains et l’environnement n’est pourtant pas une conception universelle. L’anthropologue montre au contraire que, dans l’histoire des sociétés humaines, « ailleurs qu’en Europe, les continuités et discontinuités sont de nature très différentes ». Bonne nouvelle : on peut donc penser autrement nos relations aux milieux de vie, changer de vision pour sortir de la crise climatique.
Après quarante ans d’enquêtes ethnographiques et d’engagement qui l’ont mené de l’Amazonie équatorienne au bocage nantais de Notre-Dame-des-Landes, des Indiens Achuar aux désobéissants, c’est en citoyen que Philippe Descola aborde aujourd’hui les prolongements politiques de ses travaux. Face à l’urgence écologique, le chercheur assume son intérêt pour l’inventivité sociale des ZAD, les “Zones à défendre”, et s’est fait l’avocat des Soulèvements de la Terre, mouvement menacé de dissolution[2]. Dans l’entretien qu’il nous accorde, il s’exprime aussi, ce qui est plus rare, sur l’importance de la participation citoyenne et du renouvellement démocratique.
Vous montrez les liens entre la pensée « naturaliste » dominante et l’essor d’une économie de marché destructrice des équilibres environnementaux. Nos sociétés peuvent-elles changer de modèle pour mettre en œuvre la transition climatique ?
Pour penser une transition, il faut déjà avoir une idée d’où l’on part et où l’on veut aller, c’est une phase de déplacement d’un état du monde à un autre état du monde. Nos dirigeants, en France et ailleurs, vivent encore dans le système de l’énergie abondante et ne montrent pas une claire conscience des mondes vers lesquels on se dirige. Dès lors, la transition climatique se résume à une trajectoire énergétique pour passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables. Cette vision ne stimule pas l’imagination sociale pour inventer des futurs possibles sur des bases différentes du présent. Chez nos dirigeants, les modèles intellectuels du futur sont d’une grande pauvreté.
Comment penser la transition autrement que comme l’adaptation de notre présent ?
Les concepts du capitalisme post-industriel sont inadéquats pour penser « le nouveau régime climatique », comme l’appelle Bruno Latour, parce qu’ils sont fondés sur l’opposition entre nature et société, nature et culture, humains et non-humains, ce qui empêche d’inventer de nouvelles formes d’organisation, de cohabitations, de nouvelles relations au territoire. Tout cela n’est pas mis en discussion dans le débat public.
Je reconnais qu’il est difficile d’échapper à l’évidence de la « nature », beaucoup de gens sont choqués quand je dis que la nature n’existe pas. C’est simplement constater que la nature, comme totalité extérieure aux humains et vis-à-vis de laquelle ils sont en position de contrôle et de surplomb, est une idée singulière, propre à la pensée occidentale depuis la Renaissance. Cette pensée s’impose avec d’autant plus de puissance que l’on n’a pas conscience de son caractère relatif, alors que la plupart des sociétés humaines, dans le monde, ont posé autrement la relation des humains à leur milieu de vie.
Décrire la « nature » comme une réalité universelle nous exonère de la nécessité de penser autrement pour prendre soin du monde. Ce modèle si particulier s’en préoccupe seulement depuis peu et il le fait sous l’angle de la conservation de portions de nos écosystèmes considérés comme les témoignages d’une époque où nous n’avions pas tout saccagé. Je ne dis pas qu’il ne faut pas prendre des mesures de protection, cela va soi. Mais c’est un correctif, précaire, vis-à-vis de l’hubris[3] de modernité. L’exploitation économique des ressources naturelles et la protection de la nature sont les deux faces du même système.
Vous invitez à dépasser la protection de la nature : comment, alors, construire une autre relation avec les milieux de vie ?
Les humains peuvent facilement comprendre qu’ils sont les éléments d’un tout et que leurs capacités techniques les rendent responsables de la transformation de ce tout. On peut alors se décentrer, penser la transition climatique à partir d’expériences sociales inventives comme celles vécues dans les ZAD. On peut penser de nouveaux droits comme la reconnaissance de la personnalité juridique des milieux de vie : des montagnes, des rivières, des milieux forestiers, des espèces non-humaines pourraient disposer du même droit à agir que le propriétaire d’un terrain public ou privé. Avec la reconnaissance de la personnalité juridique, les milieux de vie deviennent propriétaires d’eux-mêmes et gagnent le droit à agir pour faire prévaloir leur intérêt. C’est une façon d’utiliser le langage du droit, ce grand langage social que nous pratiquons tous, en essayant de transformer l’antique division entre le droit des personnes et le droit des choses : l’inversion du sens de l’appropriation est un bouleversement intellectuel fondamental.
Dans les territoires qui expérimentent aujourd’hui un droit des non-humains, des humains sont nécessairement les « gardiens » des milieux de vie… Comment penser la stabilité, l’institutionnalisation de ce genre d’innovation ?
C’est tout le défi de notre siècle. L’idée que la terre est propriétaire d’elle-même n’est pas nouvelle, n’importe quel anthropologue a pu lire ça dans des centaines de monographies ethnographiques en Afrique, en Océanie, dans les Amériques. L’idée que l’on puisse posséder la terre s’est répandue avec le colonialisme et le développement marchand. La question aujourd’hui est d’inverser ce processus, non pas en revenant à des formes de sacralisation mais en imaginant d’autres façons de concevoir le rapport au territoire que celles qui ont cours depuis plus de deux siècles.
C’est pourquoi j’observe comment évoluent les premières expériences menées dans le monde. Elles ont débuté avec les mouvements protestataires de peuples autochtones, par exemple en faveur de la rivière Magpie au Québec. Il est intéressant de voir que des droits activés localement commencent à être reconnus par la puissance publique: par exemple, la personnalité juridique du fleuve Whanganui est désormais reconnue par le Parlement de Nouvelle-Zélande; et la personnalité juridique de la forêt amazonienne est examinée par la Cour constitutionnelle en Colombie. À présent, des populations européennes portent des projets similaires, comme en Andalousie pour la lagune de la Mar Menor. En France, j’ai participé en 2022 à l’expérience du Parlement de Loire, dont je remarque qu’elle a été initiée par un romancier[4] – l’imagination derrière ce projet n’est pas celle des ingénieurs.
Le Parlement de Loire est un travail collectif pour définir un nouvel état du droit. Écrire la loi était aussi l’ambition de la Convention citoyenne pour le climat : comment jugez-vous cette expérimentation-là ?
La convention citoyenne pour le climat a montré à quel point ce dispositif est efficace, à quel point des citoyens ordinaires pouvaient monter en compétence sur des sujets complexes, proposer des avis éclairés après délibération et aboutir à des solutions tout à fait intéressantes. C’est une satisfaction extraordinaire. On ne leur demande pas, comme aux experts des sciences sociales, d’avoir une réflexion spéculative, à partir d’informations existantes, sur d’autres façons de vivre la condition humaine. Ce n’est pas le rôle d’une assemblée de citoyens tirés au sort d’imaginer des futurs alternatifs. Son rôle est de mettre en avant des mesures que le pouvoir politique connait déjà mais qu’il n’est pas en mesure d’envisager frontalement. Le rôle d’une convention citoyenne est de changer le rapport de force politique pour redonner de la mobilité au système. Certes, le périmètre du débat est fortement cadré par la puissance publique et il est difficile d’imaginer, dans un système où c’est l’État qui définit les priorités, de ne pas répondre à la question qu’il pose. La principale frustration est que les réponses apportées par les citoyens sont faiblement prises en compte ensuite.
C’est pourquoi il me semble nécessaire que les citoyens se prononcent sur les institutions démocratiques de demain, c’est même un préalable pour résoudre les crises climatique et écologique. Je crois à l’efficacité d’une convention citoyenne sur la démocratie qui fonctionnerait avec l’appui d’experts et de juristes.
Dans ce sens, la participation citoyenne est un front réformiste très différent des expériences sociales radicales comme les ZAD, où les gens progressent à tâtons. A Notre-Dame-des-Landes, la ZAD fonctionne par assemblées générales où chacun a le droit de s’exprimer, y compris les gens de passage, et par filières techniques qui s’accordent entre elles pour la rotation des cultures ou pour l’utilisation des productions. C’est une façon d’expérimenter l’articulation entre l’expression de tous et des intérêts de branches. Cela ne marche pas toujours, il y a des conflits vifs…
Est-il possible, ou même souhaitable, que les institutions incluent les protestations radicales dans la diversité des avis citoyens ?
Je ne le crois pas. Il serait naïf de penser que les institutions, en particulier celles de l’État, vont considérer la critique radicale qui les met en cause, alors même que l’État criminalise les mouvements contestataires et les qualifient d’écoterroristes. On peut tout au plus espérer de l’État qu’il laisse exister des marges, qu’il tolère des territoires qui expérimentent les choses. Selon moi, Notre-Dame-des-Landes est l’expérience politique la plus créative depuis la Commune de Paris.
La brutalité de la puissance publique vis-à-vis de ces collectifs désobéissants montrent bien qu’il y a une prise de conscience du danger qu’ils représentent pour la stabilité du statu quo.
Dans l’affaire des Soulèvements de la Terre, je me suis porté co-requérant dans les deux phases d’examen du décret de dissolution par le Conseil d’État. Le mémoire produit par le ministère de l’Intérieur était fondé sur le concept de provocation à la violence « par insinuation », formulation qui permettait une définition très extensive des provocations pouvant justifier la dissolution du mouvement[5].
La participation citoyenne a-t-elle, à vos yeux, les mêmes vertus d’inventivité et d’espérance que ces mouvements activistes ?
Je ne suis pas naïf, je sais bien que l’existence de territoires alternatifs et l’énorme potentiel de suggestion expérimentale que représentent ces formes de vie collective ne vont pas aboutir à une transformation de nos modes de vie à brève échéance. Je pense que nous avons deux fronts ouverts, l’un radical, qui est fondé sur ces alternatives communales et leur expansion ; l’autre plus classiquement social-démocrate, dans lequel les citoyens s’efforcent de transformer les conditions d’exercice du pouvoir dans une démocratie moderne. Ce deuxième front, soft, est aussi important, il passe par des modalités différentes de présence des citoyens dans la vie publique, par des garanties que leurs options ne seront pas balayées par la seule arithmétique de l’élection au vote majoritaire. Militer pour le développement de territoires alternatifs n’est pas contradictoire avec l’engagement pour des formes plus démocratiques de présence des citoyens dans l’État. Il faut les deux.
La participation citoyenne peut fournir des leviers d’innovation dans l’action publique, à toute échelle. Il est intéressant, par exemple, de représenter les générations futures pour les inclure comme partie prenante des choix du présent. Le Japon l’expérimente dans des conseils municipaux, des ministères, mais c’est quelque chose que l’on trouvait historiquement dans certaines régions du monde où la continuité généalogique et la notion d’ancestralité sont importantes – je pense à l’Australie et à certaines régions d’Afrique, alors que cela n’est pas du tout présent en Amazonie où le temps est aplati et où les générations futures sont des abstractions.
Les verrous sont-ils d’abord de nature institutionnelle ou économique ?
Parmi les choses évidentes, je l’ai évoqué, il y a d’abord un nouvel équilibre institutionnel à trouver entre démocratie représentative et démocratie participative : un régime dans lequel les citoyens ne sont pas convoqués uniquement tous les cinq ans pour déléguer une partie de leur libre-arbitre et pour donner leur avis sur la personne en capacité de diriger le pays. Ils devraient, au contraire, être constamment sollicités pour prendre part aux décisions sur les problèmes qui concernent l’ensemble des citoyens.
Quant à modifier les règles du jeu économiques, le défi est évidemment complexe. Notre modèle économique est conçu, depuis la deuxième moitié du 18e siècle, sur des processus de production et de circulation des marchandises indépendants de toutes les autres dimensions de la vie sociale, familiale, religieuse, morale… C’est ce que l’économiste Karl Polanyi a appelé le « désencastrement » de l’économie[6]. Par exemple, en bonne logique économique, tout gain de productivité est réinvesti pour produire plus. Pourtant, dans d’autres sociétés humaines, les gains de productivité permettent de travailler moins pour dégager du temps à faire autre chose, des rituels, des fêtes, faire la guerre avec ses voisins. Dans ce cas, l’économie est déterminée par des besoins culturellement assignés et non pas comme un domaine soumis à seule logique de production. Le défi contemporain pour nos sociétés est de réencastrer l’économie. Les gens qui occupent la ZAD de Notre-Dame-des-Landes s’y essaient, en limitant l’élevage et les cultures aux besoins immédiats de leur territoire, sans s’inscrire dans un marché économique. Dans ce contexte, les échanges pour fournir la viande ou obtenir des céréales n’ont pas de finalité économique, ils s’évaluent à l’effervescence sociale qu’ils produisent.
Parmi les leviers de réencastrement de l’économie dans les rapports sociaux, je pense aussi aux monnaies locales ; ou encore à l’instauration d’un revenu universel de transition écologique. Cela pourrait permettre, par exemple, de maintenir l’activité des maraichers qui alimentent les territoires alternatifs sans faire de bénéfices.
La « décroissance » est un concept rejeté par les décideurs qui, pourtant, parlent de « sobriété ». N’est-ce-pas le signe que le capitalisme post-industriel peut s’approprier ce qu’il a d’abord rejeté ?
La sobriété renvoie aux comportements individuels pour réfréner la consommation alors que la décroissance est une politique économique qui prend acte du fait que les ressources de la planète étant physiquement limitées, on ne peut pas continuer à produire de plus en plus. Cette logique va à l’encontre du capitalisme fondé précisément sur l’accumulation.
Lorsque Total construit une centrale solaire sur un territoire, celle-ci ne bénéficie pas directement à la communauté locale car Total conçoit la production de l’énergie renouvelable à la manière de l’énergie nucléaire, c’est-à-dire en grande quantité. C’est le modèle dominant, celui des grands travaux, de l’économie d’échelle. Il est à l’œuvre partout avec la multiplication de grandes fermes éoliennes, en France et ailleurs, sur des terres agricoles ou forestières que l’on aménage pour servir les besoins des concentrations urbaines. On utilise ces territoires pour tendre vers une sorte d’équivalent, en énergie renouvelable, d’une centrale électrique conventionnelle. C’est une façon de penser les choses en ingénieur, selon la même politique que celle qui fût conduite pour l’énergie fossile.
Je constate toutefois que la pensée éco-politique pousse des modèles alternatifs au-delà de la marge et des ZAD. C’est un mouvement que j’observe aussi à Science Po, à l’Agro qui fût pourtant un temple des techniques agro-industrielles. En fait, dans beaucoup de grandes écoles où les étudiants se déprennent du moule ancien pour essayer de faire autre chose. C’est un mouvement irrésistible, je crois.
Propos recueillis par Valérie Urman