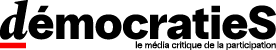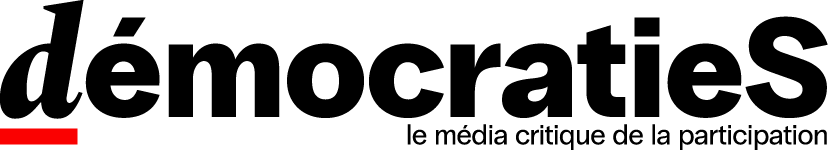par
Ilaria Casillo
Ancienne vice-présidente de la Commission nationale du débat public
Au travers de jalons sémantiques qui racontent dix années de pratique de démocratie environnementale à la Commission nationale du débat public (CNDP), Ilaria Casillo [1] propose une réflexion avec des convictions comme lignes fortes.
Il ne s’agit pas de dresser un bilan de deux mandats en qualité de vice-présidente, mais plutôt de revenir sur les enseignements que j’en tire, sur les limites des procédures de concertation actuelles et sur la situation de la participation citoyenne pour nous, théoriciens, acteurs, professionnels de la démocratie participative.
La nécessité d’une révolution sémantique
Je suis arrivée à la CNDP [2] en chercheuse, italienne, venant d’une autre autorité indépendante de Toscane. Dans mes bagages, j’avais de nombreuses références théoriques sur la démocratie participative et délibérative (Habermas, Dewey…)[3] et je me demandais bien ce que pouvait être leur utilité pour une autorité administrative indépendante, garante de procédures de droit dont les pratiques et le langage étaient très codifiés.
J’ai rapidement compris qu’un des enjeux majeurs était lié aux notions et à la sémantique dont se nourrissait l’action de la CNDP. Ces mots sont importants pour moi, car ils sont entrés désormais, non pas dans la rhétorique, mais dans le discours institutionnel de la CNDP et dans ses pratiques renouvelées.
Le premier jalon sémantique qui m’est apparu fondamental est celui de la « différence entre procédure environnementale et processus démocratique ». La CNDP est une instance qui met en place des procédures de concertation très encadrées par le code de l’environnement. Toutefois, puisqu’il s’agit de solliciter la parole citoyenne, sa mission doit être également celle de déclencher un processus démocratique, de créer une dynamique de dialogue qui va au-delà de la stricte procédure. Notre capacité à faire vivre et à articuler les deux – procédure et processus – a un effet sur la qualité des débats que nous mettons en place. Cela est parfois difficile à faire comprendre à des élus ou à des maîtres d’ouvrage qui considèrent devoir passer par une procédure, mais qui, in fine, se retrouvent confrontés à un processus démocratique exigeant, dont les effets vont au-delà du calendrier de concertation.
Deuxième notion : les « conditions de faisabilité et de confiance ». Lorsque je suis arrivée à la CNDP, j’entendais beaucoup parler d’acceptabilité des projets. Il s’agit d’une notion qui révèle une approche descendante et binaire de la participation (arriver avec un projet à prendre ou à laisser) ; j’ai beaucoup insisté pour que nous utilisons la notion de conditions de faisabilité sociale d’un projet, qui traduit une approche constructive de la participation et qui incite davantage à travailler sur le « oui », « à condition que » et sur le « non, sauf si ».
Ensuite, la notion « outreach », que je tenais de mon passage dans une ONG plutôt que dans la recherche, renvoie à l’idée d’aller chercher dehors, à l’extérieur des lieux physiques et sociaux habituels, des personnes qu’il est difficile d’atteindre, pour les amener dedans. J’ai la prétention de penser que ce terme a inspiré la mise en place du 6ème principe de la CNDP, celui de l’inclusion, qui rappelle l’importance d’aller chercher les publics les plus éloignés de la décision et de la vie de la cité, car ce sont souvent eux qui ont tout à gagner ou tout à perdre et qu’il est crucial de consulter. L’outreach n’est pas seulement une question de stratégie de mobilisation, c’est avant tout une question de volonté effective de considérer comme importante la parole la plus éloignée et la plus faible.
Continuons, avec le « concernement » : c’est un mot qui n’existe pas en français et qui essaie de traduire le principe « what do they care about » qui consiste dans le fait que les personnes se mobilisent pour ce qui leur tient à cœur. Ce concernement nous oblige à travailler et à structurer nos débats afin que le public puisse se rendre compte comment marche tel ou tel projet, mais surtout ce que ça change pour eux, pour leur cadre de vie, pour leurs économies, pour leur bonheur. Cette notion nous impose également d’installer le débat dans la sphère publique (une autre de mes formules, à laquelle je tiens beaucoup), car nous avons le devoir de favoriser et d’améliorer la qualité de nos espaces collectifs de débat à partir de la sphère publico-médiatique.
Encore un anglicisme, avec « one size fits all ». Cette notion, je l’ai appliquée à la question cruciale des méthodes d’information et de participation. Dans la participation, il y a une seule règle d’or à mon sens : il n’y a pas de méthode à taille unique qui serait applicable à toutes les concertations. À chaque territoire, chaque projet, chaque public, sa méthode. Cette dernière n’est jamais neutre. C’est sur cette question que se joue et que s’est joué un des tournants les plus ambigus de la participation citoyenne, c’est-à-dire sa mise en méthode et sa dépolitisation, sa réduction à des outils (civic tech, tirage au sort, etc.), plutôt qu’à des manières d’être et de procéder de la participation.
Et « setting versus solving » : un, parmi les nombreux lieux commun autour de la participation citoyenne, celui selon lequel elle devrait servir à résoudre les conflits, faire du problem solving. La participation sert en réalité tout d’abord à faire le setting, c’est-à-dire un paramétrage collectif des problèmes ou des conflits auxquels il faut trouver des solutions. Penser que la participation doit intervenir seulement sur la définition de la solution et non pas sur la redéfinition du problème signifie non seulement adopter uniquement une approche positiviste mais aussi se priver de la dimension heuristique propre à la démocratie dialogique. Par ailleurs, l’expérience m’a appris que c’est lorsqu’on réfléchit ensemble aux problèmes que les meilleures solutions apparaissent.
Enfin, le « syndrome NIMBY et TINA » : toutes celles et ceux qui s’occupent de participation citoyenne ont entendu parler du syndrome NIMBY dont souffrirait le public et en particulier les opposants aux projets. Il s’agit du Not in my backyard (pas dans mon jardin) au nom duquel les projets seraient rejetés. S’il est vrai que de telles postures existent dans les débats, il serait trompeur de réduire la cause de tout conflit ou de toute contestation à cela. Personnellement, je me suis souvent trouvée devant un autre syndrome dont on parle moins et qui affecte quant à lui le décideur ou le porteur du projet : TINA There is no alternative, il n’y a pas d’alternative. Traduit en d’autres termes : mon projet est le meilleur, il n’y a aucune alternative possible. Cette posture braque le public et empêche même le débat de se dérouler correctement et de déployer toutes ses vertus en termes de propositions, de travail collectif d’amélioration ou d’amendement d’un projet.
Le défi d’être du côté du public
Quand je suis arrivée à la CNDP, celle-ci était bien différente de celle qu’elle est aujourd’hui. C’est normal, et c’est là le premier enseignement que j’ai intégré en travaillant dans deux autorités indépendantes en Italie et en France : les institutions ne sont pas comme le Léviathan décrit par Hobbes [4], elles ne sont pas des entités désincarnées ; nous faisons les institutions que nous habitons et les institutions sont les hommes et les femmes qui les habitent, avec leur singularité, leur vérité, leur rigueur (ou pas), leur sincérité (ou pas), leur loyauté (ou pas).
Garantir des procédures de concertation pendant dix ans amène à être au contact constant et direct avec les publics. Il s’agit de centaines de personnes rencontrées dans les ateliers publics, sur les marchés les week-ends, dans les fermes et exploitations agricoles ; les jeunesses rencontrées dans les écoles ou dans leurs réseaux de socialisation. Toutes ces personnes m’ont appris tout d’abord l’importance de la parole contraire, du dissensus fécond qui améliore non seulement les projets, mais surtout la démocratie que nous bricolons à chaque fois que nous sommes amenés à débattre et à nous convaincre. Ces personnes m’ont aussi appris qu’en démocratie, la légitimité de la parole et de la décision ne peut pas se baser seulement sur l’expertise, sur le savoir, ou sur les élections ; que la sphère publique est faite d’opinions, d’interprétations dont il faut tenir compte ; qu’il y a un écart, et aujourd’hui – hélas – un gouffre, entre le légal et le légitime avec lequel nous devons de plus en plus composer ; que la disqualification des revendications et des mobilisations citoyennes est un chemin qui ne mène nulle part.
Trois convictions et un paradoxe
On peut continuer à me dire que la participation fait perdre du temps, je serai toujours du côté de celles et ceux qui considèrent qu’elle permet d’approfondir la démocratie et de prendre de meilleures décisions. On pourra encore me rétorquer que la participation coûte de l’argent, je serai toujours du côté de celles et ceux qui croient que si la démocratie coûte c’est parce qu’elle a de la valeur. On pourra s’obstiner à m’opposer que la participation donne la parole à celles et ceux qui ne sont pas représentatifs de la société, je serai toujours de celles et ceux qui croient que la participation n’est pas faite par des majorités ni des minorités qui se (dé)comptent, mais par des arguments qui se pèsent et se confrontent au-delà de qui les porte.
Tout cela apparait aujourd’hui d’autant plus compliqué à porter que les temps sont très difficiles pour la démocratie, mais aussi pour la participation institutionnelle.
Si on regarde le contexte actuel, un constat majeur nous apparaît sous les yeux. Nous théoriciens, praticiens et acteurs institutionnels de la concertation, nous sommes face à un paradoxe.
D’un côté, il y a une diffusion des pratiques participatives dans l’action publique et une structuration d’un champ théorique et professionnel de la participation qui permettent d’affirmer que la participation est mûre, qu’elle a fait ses épreuves. Le problème est que ces preuves sont surtout méthodologiques. Pour le dire autrement, la démocratie participative a démontré qu’elle sait s’appuyer sur des outils, sur des méthodes et des compétences rigoureuses, bref qu’elle fait faire. Elle a le know how.
En même temps, elle ne semble pas avoir réussi à reconfigurer le système de pouvoir qu’elle ambitionnait, selon certains, de remettre en discussion.
Elle ne semble pas non plus avoir produit des formes d’engagement politique renouvelées (hormis les mobilisations hors concertation institutionnelle). La promesse participative d’un partage de la décision, de l’empowerment ne semble pas avoir contribué à éviter les dérives populistes et extrémistes de nos démocraties contemporaines, surtout dans les pays où la participation citoyenne institutionnelle semble devenue une norme de l’action publique.
Tout s’est passé comme si, en s’arrêtant et en mettant l’accent sur le “comment faire”, on a oublié le “pourquoi”, l’horizon politique de la participation.
Il est impossible, et même inopportun, de revenir ici sur les causes, multiples, de la conjoncture paradoxale qui traverse la participation citoyenne contemporaine : elle n’a jamais été si diffuse et légitimée, et en même temps elle n’a jamais été si peu capable de changer le système de pouvoir. C’est comme si la participation avait gagné en ampleur ce qu’elle a perdu en profondeur.
Est-ce que constat doit nous faire renoncer ? Non. Il nous oblige plutôt à porter et à réaffirmer une certaine vision de la participation ancrée dans sa raison la plus profonde : la promesse d’une émancipation individuelle et collective.