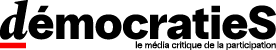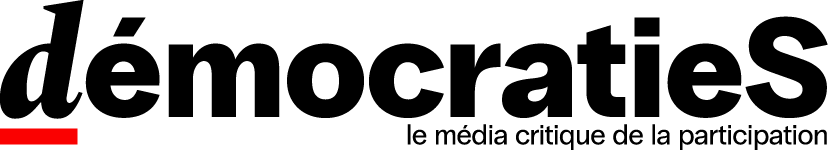Entretien avec
Isabelle Ferreras
Sociologue et politologue
L'entreprise doit changer par le haut, estime la sociologue Isabelle Ferreras, en proposant d'instaurer une chambre des travailleurs, dotée de pouvoirs au moins équivalents à ceux du conseil d'administration. Une première étape, avant de viser le rachat collectif du capital.
Que veut dire exercer la citoyenneté en entreprise, dans votre esprit ?
L’article premier de la Déclaration universelle des droits humains nous dit : « Tous les êtres humains naissent libres, égaux en dignité et en droit. » Dans la vie au travail, où les gens passent le plus clair de leur temps, on est loin d’être un égal en dignité, en droit. C’est une contradiction centrale de nos démocraties : d’un côté, nous nous reconnaissons dans l’idéal politique posé par l’article 1er, d’un autre côté, le régime économique organise une grande part de notre vie quotidienne. Ce régime, le capitalisme, je l’analyse aussi comme un régime politique qui alloue des droits politiques. C’est pourquoi, au cœur de ma compréhension du capitalisme, je place l’entreprise et non pas le marché. La société anonyme est l’institution centrale du capitalisme, elle distribue les droits politiques de gouverner le quotidien du travail. Ce n’est pas l’idéal d’égalité, mais la possession d’une propriété qui donne ce droit de gouverner. Cela exclut immédiatement tous ceux qui n’apportent que leur travail à l’aventure de l’entreprise.
J’ai donc proposé le concept d’investissement en travail, par comparaison avec l’apport en capitaux. Le droit des sociétés valorise le capital. L’investissement en travail est renvoyé à un tout autre domaine juridique, le droit du travail. La relation de subordination, centrale dans le droit du travail, est un principe d’ordre politique : il implique que le salarié, en signant un contrat de travail, abandonne son droit à l’égalité, à l’égale dignité. C’est la contradiction intense que les gens vivent au quotidien. J’ai appelé cela la contradiction capitalisme/démocratie. Dans mon premier livre[1], j’ai exposé ce que m’ont appris les caissières de supermarchés : travailler, c’est faire une expérience politique qui mobilise des conceptions sur la justice, c’est juste ou injuste d’organiser les horaires comme ceci, de rémunérer les gens comme cela… Au travail, la conception qui va s’imposer est celle du dirigeant, qui agit dans l’intérêt des actionnaires. C’est le despotisme tel que le définit Aristote : la capacité de prendre les décisions indépendamment du point de vue d’autrui, et sans reconnaître à autrui le droit d’avoir même un avis sur la question.
Dès lors, être citoyen dans l’entreprise, c’est aspirer à l’égalité en droit et en dignité, et se poser la question des moyens institutionnels pour faire advenir ce projet.
Le dialogue social, la représentation syndicale, ne sont-ils pas les contre-pouvoirs suffisants ?
L’histoire sociale indique le chemin, bien sûr. Je vois l’architecture du dialogue social, les droits collectifs conquis par la lutte syndicale, comme les embryons de la démocratisation, ce sont les ébauches d’une prise en charge institutionnelle de l’égalité en droit. Mais aucun des droits acquis ne touche à la finalité de l’entreprise : que va-t-on produire ? Les droits portent seulement sur l’aménagement du travail, sur la question des moyens, des horaires, de la santé, de la rémunération. Dans ce moment de bifurcation que constitue la crise écologique, la question de la finalité des entreprises, de leur impact social, environnemental, interpelle de plus en plus. L’enjeu de démocratisation n’en devient que plus pertinent.
Le libéralisme économique a réussi à imposer l’idée qu’il y avait une frontière étanche entre le champ politique et le champ économique. C’est une construction culturelle. A partir des années 1980, on est passé d’une économie industrielle à une économie de services, marquée par les technologies de l’information et de la communication. Avec les réseaux sociaux, le travail fait partie de l’espace public. On ne devrait donc pas être surpris que les individus aspirent à peser sur le gouvernement de leur vie, dans l’entreprise comme dans la société, car ils ne font plus la différence.
Vos travaux s’appuient sur l’idée que les « investisseurs en travail » doivent disposer de droits au moins équivalents à ceux des « apporteurs en capitaux » : les mêmes pouvoirs aux salariés et aux actionnaires ?
Oui, collectivement. Le travail, ce n’est pas juste un moyen de générer du profit. C’est d’abord un investissement consenti par des êtres humains qui mettent en jeu leur personne. C’est pourquoi, je définis le capital comme un apport et le travail comme un investissement. Pour quelqu’un qui a acheté des parts d’une société cotée en bourse, le risque est de perdre la valeur de son action. C’est un risque important, qui justifie que l’on accorde des droits aux actionnaires. Le travailleur, lui, peut tout perdre, son travail, son revenu, sa vie, ce qui justifie de reconnaître la primauté de l’investissement en travail.
Toute la littérature sur la responsabilité sociale de l’entreprise a mis en avant le concept de parties prenantes, pour y intégrer les investisseurs en travail, les clients, les fournisseurs, les sous-traitants… C’est ce petit déplacement qui permet à l’économie de se réinventer, en passant du capitalisme d’actionnaires (shareholders) au capitalisme de parties prenantes (stakeholders) : les grandes institutions sont toutes alignées là-dessus. Dans ma compréhension, on noie les travailleurs dans l’océan des parties prenantes, ce qui maintient la primauté de pouvoir aux actionnaires.
Comment proposez vous de mettre en œuvre une égalité réelle ?
L’histoire nous inspire. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, à Rome, le pouvoir était intégralement dans les mains des grands propriétaires, les patriciens. La plèbe se révolte, autrement dit les investisseurs en travail, l’armée, les marchands, tous ceux qui rendent des services vitaux, sans lesquels Rome ne peut pas fonctionner. Quel est le compromis trouvé ? On accorde un droit de veto collectif sur toutes les décisions qu’auparavant les patriciens prenaient seuls. Dans l’histoire, la sortie des despotismes est rendue possible par ce moment de démocratisation, c’est-à-dire la reconnaissance d’une partie constituante – et non pas une partie prenante – invisibilisée jusque-là. C’est la naissance du bicamérisme, qui ne cessera d’être réinventé.
Notre histoire sociale montre l’intuition d’une seconde chambre dès la fin de la guerre, avec l’instauration du comité d’entreprise, devenu aujourd’hui le comité social et économique (CSE) : c’est la voie institutionnelle, par laquelle les travailleurs choisissent des représentants élus sur des listes déposées par les organisations syndicales, dans le but d’établir un dialogue avec les dirigeants à l’échelle de l’entreprise. Cette intuition reste embryonnaire, cantonnée à l’information-consultation : le CSE ne discute pas la finalité de l’entreprise, le type de production, la répartition des profits, l’impact écologique, etc.
Il faut passer à une phase plus exigeante, en positionnant cette instance comme une véritable chambre de représentation des investisseurs en travail. Cette seconde chambre serait placée au même niveau de pouvoir que le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, et devrait donc valider la stratégie de l’entreprise.
Quel rôle tiendraient les organisations syndicales dans ce nouveau système de gouvernance ?
Un rôle clé, parce que mon raisonnement n’est pas une théorie hors-sol. Dans l’histoire de notre vie économique et démocratique, le syndicalisme est l’acteur collectif, qui a été capable de construire une représentation des investisseurs en travail, de les organiser, et d’articuler cette représentation à un projet de société démocratique. Il faut s’inscrire dans cette histoire. Est-ce que tous les syndicats sont organisés de manière démocratique et satisfaisante ? Non. Est-ce qu’ils n’ont pas eux-mêmes leurs propres défis internes à prendre à bras-le-corps ? Absolument. Et justement, le projet de démocratisation des entreprises devrait permettre le renouvellement, non seulement des énergies utopiques – comme disait le philosophe Jürgen Habermas – mais des capacités de mobilisation et de rénovation du syndicalisme lui-même.
Donc, oui, je pense que le syndicalisme est un acteur incontournable. Un projet de démocratisation des entreprises qui se ferait sans lui serait dangereux, au risque de déraper dans le patriotisme d’entreprise. Le syndicalisme est l’acteur qui permet la solidarité trans-entreprise, comme disait Georges Friedman, le père de la sociologie du travail en France. La démocratisation de l’économie doit servir un projet de solidarité, plutôt qu’un projet de repli sur soi des plus riches : d’un côté les salariés de l’entreprise X qui seraient bien payés et qui auraient voix au chapitre ; de l’autre, des univers professionnels délaissés.
La critique des syndicats est forte, leur pouvoir d’entrainement déclinant…
Le syndicalisme deviendra ce qu’on en fera. Il faut prendre au sérieux les études portant sur le renouvellement de sa capacité de mobilisation, sur la transformation des mandats par les volontés de la base, etc. Les travaux de la politologue Hélène Landemore, sur le tirage au sort, pointent une façon intéressante de distribuer les mandats dans une entreprise. On peut imaginer que des salariés choisissent parmi les listes syndicales celle qui leur convient le mieux, pour ensuite tirer au sort des représentants, en respectant les proportions établies à l’étape précédente. Il y a un tas de pratiques à mettre en place pour rendre la participation féconde dans l’entreprise.
Les sujets stratégiques n’étant pas abordés avec les organisations syndicales, elles sont en quelque sorte victimes de cette configuration d’infériorité politique, mais j’aimerais bien les voir se rebeller davantage à ce sujet. Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, a pris publiquement position là-dessus, à l’occasion de la sortie de notre livre « Hé patron ! » en disant que la place des salariés n’est pas d’occuper un strapontin dans les conseils d’administration, mais de disposer de droits suspensifs sur les grandes décisions prises au niveau des conseils d’administration. C’est le principe philosophique du droit de véto suspensif, enfin reconnu à la partie constituante jusqu’alors oubliée.
Cette démocratisation « par le haut » est un préalable selon vous ?
On a essayé la démocratisation par le bas, par exemple avec l’ouverture d’espaces d’expression à l’échelle de l’atelier. Il ne faut pas prendre les managers pour des idiots : depuis plus de 40 ans, ils sondent ce que pensent les salariés et essaient d’ajuster les cultures managériales, pour mieux mobiliser les travailleurs. Le problème relève d’abord de la distribution du pouvoir. C’est un problème de régime politique, donc il faut le traiter comme tel. Cela étant, j’ai conscience qu’en changeant les institutions de gouvernement, il convient aussi de changer la culture de la participation et de la délibération. On ne peut pas penser les structures, sans la culture.
La version aboutie de la démocratisation serait-elle donc, à vos yeux, d’étendre le modèle des coopératives à toute l’économie ?
Pas n’importe quelle coopérative. Celles qui m’intéressent le plus sont les coopératives de travailleurs. Car le véritable enjeu est que les investisseurs en travail s’autogouvernent et que le capital se démocratise également. Donc il faut qu’ils puissent racheter collectivement le capital. A mon sens, les plans d’actionnariat salarié – par exemple quand les travailleurs accèdent à 5 % du capital d’un grand groupe – n’améliorent pas le projet démocratique. Il faut un plan de rachat collectif du capital par les travailleurs. Là, l’État a un rôle crucial à jouer, auprès des banques publiques, qui devraient pouvoir appuyer ces rachats.
L’extension du modèle coopératif sert la possibilité de faire entrer l’économie dans le projet démocratique. C’est urgent. Plus nous esquiverons en pensant que l’économie peut rester non-démocratique dans le cadre d’une société démocratique, plus les pathologies de la démocratie prolifèreront – absentéisme, vote pour les extrêmes – et plus la crise écologique s’aggravera.
Propos recueillis par Valérie Urman et Pierre-Yves Guyhéneuf