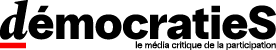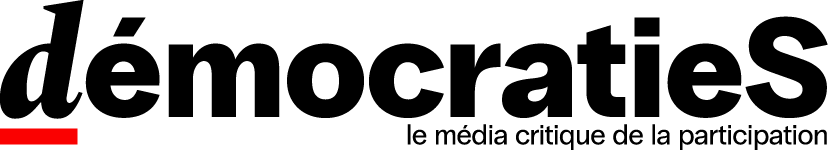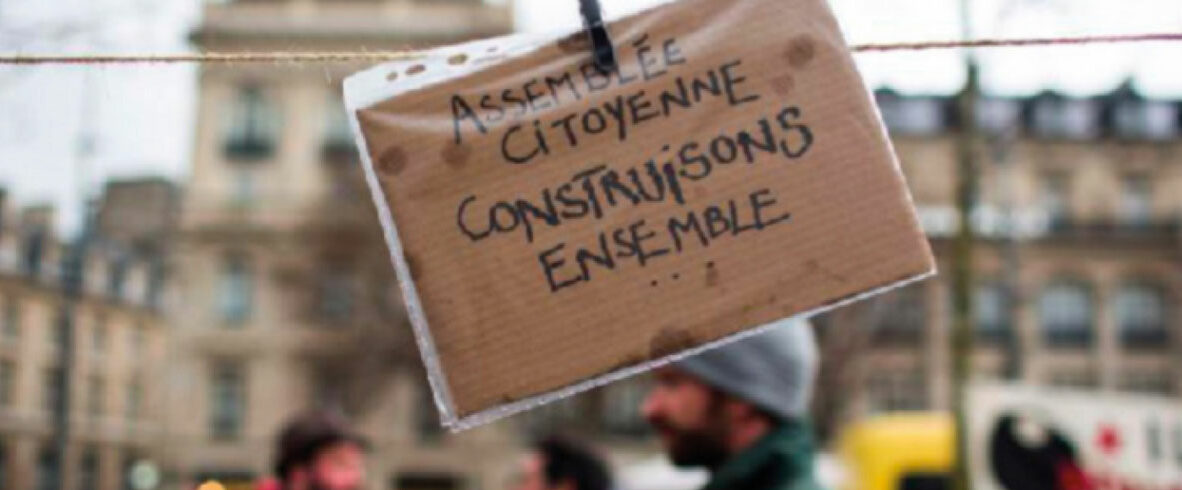Entretien avec
Carole-Anne Tisserand
Doctorante, Ecole des Mines de Paris
Frédéric Gonthier
Professeur de science politique à Sciences Po Grenoble
La défiance envers les institutions politiques ne cesse de croître, en France comme dans l’ensemble des démocraties européennes. Comment retisser le lien entre citoyens et gouvernants ? C’est la question analysée par Carole-Anne Tisserand et Frédéric Gonthier [1].
Pour vous, les innovations démocratiques pourraient renforcer la confiance politique. Mais ce lien n’est pas automatique. Pourquoi ?
C’est l’un des points les plus importants de notre travail : une innovation démocratique [2] n’est pas une baguette magique. Elle ne produit pas automatiquement plus de confiance. Tout dépend de la manière dont elle est conçue, articulée et intégrée dans le fonctionnement des institutions.
Prenons un exemple : une assemblée citoyenne peut susciter beaucoup d’enthousiasme au départ. Mais si les règles de sélection des participants ne sont pas claires, si les débats semblent orientés ou si les recommandations ne sont jamais prises en compte, le résultat peut être contre-productif. Au lieu de restaurer la confiance, on alimente la frustration.
Il y a aussi la question du contexte. Un dispositif peut fonctionner dans une ville où les élus sont perçus comme ouverts et accessibles, et échouer dans un territoire marqué par une méfiance profonde. L’innovation, pour être efficace, doit donc s’inscrire dans une stratégie plus large, où les institutions montrent qu’elles prennent réellement en compte la parole citoyenne. Cela implique de ne pas prendre les innovations démocratiques comme des moyens de domestiquer les revendications des citoyens ou d’aplanir les clivages politiques, ce qui est souvent pointé par la littérature sur le marché de la participation. Sans cette volonté politique claire, le risque est de créer de la déception plutôt que de la confiance.
Quelles sont vos principales recommandations pour renforcer l’impact de ces dispositifs ?
Aujourd’hui, de nombreuses innovations restent au stade de l’expérimentation : elles créent un effet vitrine, mais elles disparaissent après quelques mois. Pour qu’elles produisent un impact durable, il faut les inscrire dans le temps long, leur donner une base juridique solide et leur assurer des moyens stables. C’est ce qu’il faut entendre par l’institutionnalisation des innovations démocratiques. Cela va au-delà d’une simple inscription dans les institutions au sens juridique et administratif, mais nécessite en fait une réelle routinisation dans l’implémentation et l’usage des innovations démocratiques.
Cela suppose, par exemple, de prévoir des financements pluriannuels pour éviter les effets d’annonce sans lendemain, mais aussi de laisser une certaine souplesse : une innovation doit pouvoir s’adapter aux réalités locales, aux spécificités d’un territoire ou aux attentes d’un public. Cela suppose aussi une réelle transformation des pratiques au sein des administrations, afin de donner aux agents le temps et les ressources pour articuler leur activité avec la mise en place des innovations démocratiques.
Autre point essentiel : il ne suffit pas d’accumuler des dispositifs, il faut les relier entre eux. Une consultation en ligne qui n’est pas suivie d’une délibération collective, ou une assemblée citoyenne nationale dont les propositions ne sont jamais discutées au Parlement, ce sont des occasions manquées. Ce que nous préconisons, c’est une véritable chaîne participative, où chaque étape — consultation, délibération, décision — est connectée aux autres.
Enfin, nous plaidons pour une évaluation systématique. Trop souvent, on ne sait pas si ces innovations atteignent leurs objectifs. Il faut des indicateurs clairs, des bilans publics et, surtout, un suivi transparent des recommandations. Quand une proposition est rejetée, il est crucial d’en expliquer les raisons. C’est un principe simple, mais fondamental pour la crédibilité des institutions.
Vous insistez aussi sur la différence entre « confiance » et « crédibilité institutionnelle ». Pouvez-vous clarifier ?
C’est une distinction essentielle. La confiance politique, c’est ce que ressentent les citoyens : est-ce qu’ils pensent que leurs institutions agissent dans l’intérêt général ? La crédibilité institutionnelle, ce qu’on appelle aussi trustworthiness, c’est autre chose, ce sont les qualités objectives qui justifient qu’on puisse avoir confiance : la transparence, l’équité, l’inclusivité, la réactivité.
Le problème aujourd’hui, c’est que beaucoup d’initiatives se concentrent sur la première dimension sans travailler la seconde. On soigne l’image, on communique beaucoup mais si, derrière, les institutions ne changent pas leurs pratiques, la confiance ne dure pas. Une innovation démocratique réussie doit donc jouer sur les deux tableaux ; elle doit donner aux citoyens des raisons objectives de faire confiance, tout en transformant la manière dont les institutions fonctionnent au quotidien. C’est ce double mouvement qui peut restaurer durablement le lien démocratique.
Concrètement, quelles innovations vous semblent les plus prometteuses aujourd’hui ?
Les mini-publics délibératifs [3] et les conventions citoyennes sont parmi les plus intéressants. Quand ils sont bien conçus, qu’ils permettent de croiser des savoirs experts et des expériences vécues, et surtout quand leurs recommandations sont réellement intégrées dans les décisions, ils peuvent transformer la relation entre citoyens et institutions. Mais à une condition : il faut qu’ils soient institutionnalisés. Un mini-public ponctuel a moins d’impact qu’une instance délibérative régulière, intégrée aux processus politiques.
Les budgets participatifs fonctionnent aussi très bien, notamment à l’échelle locale. Mais là encore, tout repose sur la crédibilité du processus. Si les projets votés ne sont pas financés, si les délais de mise en œuvre sont trop longs, la confiance se retourne vite en méfiance.
Quant aux plateformes numériques, elles ont un potentiel énorme pour élargir la participation, toucher des publics éloignés, diversifier les points de vue. Mais leur succès dépend de deux conditions : lutter contre l’exclusion numérique et garantir que les contributions citoyennes aient un véritable poids dans les arbitrages finaux. Sinon, ces outils risquent de renforcer le sentiment d’impuissance.
Vous évoquez la nécessité d’hybrider les formes de participation ?
Nous pensons, avec d’autres, qu’il faut sortir de l’opposition entre démocratie directe, démocratie représentative et démocratie participative. L’avenir, c’est une démocratie hybride, où les dispositifs participatifs et la démocratie directe viennent enrichir, compléter et parfois réorienter les institutions représentatives, sans les contourner.
Concrètement, cela peut vouloir dire, par exemple, qu’une plateforme de consultation en ligne serve à recueillir des idées, qu’une assemblée citoyenne délibère ensuite sur les plus pertinentes et que ces propositions soient discutées dans les instances législatives ou exécutives. Mais cela suppose une vraie coordination entre les différents niveaux de gouvernance — local, national, européen — et une meilleure formation des élus, comme des agents publics à l’écoute active, à la facilitation et à la gestion des conflits.
L’objectif, c’est de construire des parcours démocratiques cohérents pour les citoyennes et citoyens, où la participation et la délibération sont des composantes intégrées de la décision publique.
En quoi ces recommandations permettraient-elles de répondre à la crise démocratique actuelle ?
La crise actuelle est double. D’abord, une crise de représentation : beaucoup de citoyens ont le sentiment que leur voix ne compte plus. Ensuite, une crise de crédibilité : les institutions sont perçues comme opaques, lentes, parfois indifférentes aux attentes sociales.
Les innovations démocratiques peuvent jouer un rôle décisif, mais seulement si elles sont prises au sérieux. Il ne s’agit plus d’expérimenter pour expérimenter, mais d’assumer une transformation profonde de nos pratiques démocratiques. Il s’agit d’institutionnaliser ces dispositifs, de les relier entre eux, de les évaluer rigoureusement et de rendre des comptes. Autrement dit, il s’agit de jouer sur leur complémentarité et d’en faire un élément structurel de la décision publique.
Bien sûr, les innovations démocratiques ne sauveront pas, à elles seules, la démocratie. Les droits sociaux ont besoin d’être revitalisés conjointement aux droits civiques et politiques. Mais si les innovations politiques sont pensées comme des outils durables, articulées entre elles et intégrées aux circuits de décision institutionnels, elles peuvent contribuer à restaurer la confiance entre citoyens et gouvernants. C’est là tout l’enjeu : passer des expérimentations symboliques à une transformation systémique.
Entretien réalisé par Sylvie Barnezet
Quelques innovations à suivre de près
Pour qu’un dispositif suscite la confiance, il doit donner aux participants le sentiment que leur voix compte et que leurs contributions influencent réellement les décisions. C’est ce qui explique le succès du modèle mis en place dans la communauté germanophone de Belgique, à Ostbelgien. Depuis 2019, une assemblée citoyenne permanente est intégrée au Parlement régional : les recommandations formulées par les mini-publics doivent obligatoirement recevoir une réponse motivée des élus.
Un autre levier central est la transparence. En Grèce, la plateforme Diavgeia impose depuis plus de dix ans la publication systématique de toutes les décisions administratives. En rendant visibles les arbitrages, en permettant à chacun de vérifier comment l’argent public est dépensé et quelles décisions sont prises, ce dispositif a contribué à restaurer la perception de responsabilité des institutions.
Les innovations démocratiques peuvent aussi créer des dynamiques d’apprentissage collectif. Les conventions citoyennes sur le climat, en France comme ailleurs, en sont un exemple marquant. Lorsqu’elles permettent de croiser expertises et expériences vécues et que leurs recommandations sont sérieusement prises en compte, elles enrichissent la décision publique et favorisent une nouvelle forme de confiance, plus réflexive et plus exigeante.