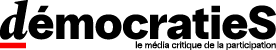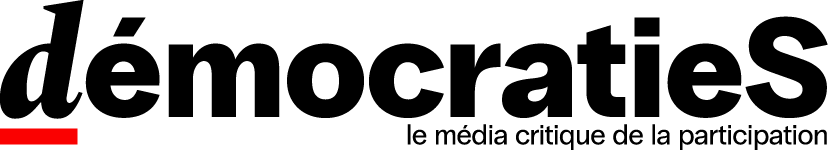Entretien avec
Camille de Toledo
Ecrivain, chercheur associé à l'Institut d'études avancées de Nantes
Après le Parlement de Loire, l’écrivain Camille de Toledo anime une nouvelle démarche collective entre art, science et participation, qui porte les premières propositions de loi citoyennes en France sur les droits de la nature.
En 2019, avec le Pôle Art et Urbanisme (Polau) à Tours, Camille de Toledo lance les Auditions du Parlement de Loire, réunissant pendant trois ans des figures de toutes disciplines. Un travail d’intelligence collective sur la personnalisation juridique du fleuve qu’il restitue dans un récit : Le Fleuve qui voulait écrire[1]. Penseur singulier du mouvement des droits de la nature en France, l’écrivain a poursuivi sa démarche avec l’Internationale des rivières (2023-2026), en tant que chercheur associé à l’Institut d’études avancées de Nantes. Il pousse cette fois la dimension participative et normative du projet, qui porte les premières propositions de lois citoyennes pour les droits de la nature. Trois textes, coécrits avec des scientifiques et un conseil d’habitants, ont été déposés le 30 avril 2025 à l’Assemblée nationale[2]. Un pas de plus vers ce « tournant » qu’identifie Camille de Toledo : « Accorder un droit aux entités naturelles, c’est faire émerger un nouvel acteur juridique, un être qui parle, qui agit, qui oblige à revoir les contrats que nous passons avec le monde vivant ».
Le Parlement de Loire avait mobilisé des anthropologues, hydrologues, chercheurs, artistes… L’Internationale des rivières s’appuie aussi sur des citoyens. Qu’est-ce qui a changé, quel est l’enjeu ?
Camille de Toledo. Ma pratique consiste à utiliser les récits, les outils de la narration, pour transformer les façons dont nous habitons. Le projet dit du Parlement de Loire impliquait des chercheurs de tous horizons, notamment lors d’auditions publiques. Il y a toujours une dimension performative, narrative, dans les processus de transformation que j’accompagne. Là, j’avais repris le modèle des auditions parlementaires, ces hearings organisés pour instruire des propositions de lois. Cette dramaturgie de la décision collective, de l’instruction pour des « lois à venir », est un pivot de ma démarche. Les sciences de la vie et de la Terre, ainsi que l’ensemble des apports scientifiques sur le climat ou la biodiversité, nous portent à transformer notre droit et nos institutions. Il faut donc retisser ce lien entre une parole experte et la voix des citoyennes et des citoyens à rebours de médias qui participent à une production d’ignorance et de ressentiment. Vers une Internationale des rivières, ce nouveau récit instituant, repose encore sur cette intelligence collective à retrouver pour changer nos manières de vivre, d’habiter. À l’issue des auditions du Parlement de Loire, il manquait à mes yeux deux dimensions : d’une part, ce que j’appelle un « cosmopolitisme des lieux », c’est-à-dire une réflexion à une échelle large, comparatiste, internationale ; et d’autre part, le recours au souverain, aux voix et témoignages des communautés habitantes, des citoyennes et citoyens, pour dessiner ensemble la texture de ces « lois à venir ».
Ces citoyens forment un Conseil des témoins limité à douze personnes. Pourquoi ce format ?
Le douze est un chiffre archaïque que l’on retrouve dans de nombreux passages bibliques. C’est aussi une référence à l’art du récit avec Twelve angry men (Douze hommes en colère), le film de John Ford. Le Conseil des témoins s’est forgé autour d’un terme clé : c’est quoi être le témoin d’un monde qui change, d’une transformation du droit ? Le terme renvoie à la parole des témoins lorsqu’un jury délibère. La scénographie que je propose n’est pas celle du procès, du jugement. Je demande l’inverse aux citoyennes et citoyens qui m’accompagnent. Comme en littérature où l’on parle de suspension of disbelief, je leur demande de suspendre leur jugement ; d’accueillir des informations nouvelles… C’est ce qui a lieu lors des hearings, des auditions. On peut penser à cette écoute dont doivent faire preuve les jurés pour peser les pour et les contre. Il faut comprendre ce qui en train de se jouer dans ce tournant terrestre des droits de la nature, voir les questions que cela pose dans le droit moderne et dans nos sociétés naturalistes – pour reprendre les catégories de la pensée du philosophe Philippe Descola [voir notre entretien avec Ph. Descola]. Ce travail d’instruction accompli, quelque chose peut advenir. Mais mon horizon, c’est d’aboutir à un changement de la loi. Lors des auditions du Parlement de Loire, le terrain n’était pas encore mûr, le cadre des droits de la nature était trop peu connu. Il fallait, d’abord, effectuer ce travail d’initiation. Aujourd’hui, avec le projet nantais, il a été possible d’aller jusqu’à la co-écriture des « lois à venir ».
Voyez-vous le projet comme une approche participative ?
Par rapport à une démarche de démocratie participative, j’apporte ma double formation d’artiste et de chercheur, en mobilisant les fictions de l’art. Et j’ajoute l’expérience, une mobilisation des affects. Au-delà de la discussion collective et du processus d’instruction, je propose des expériences affectives qui concourent à un accueil de certaines métamorphoses de la perception. Ce sont des expériences esthétiques, des temps d’écoute, que je tire de mes pratiques de la thérapie et de la méditation. J’appelle cela des « méditations transformatives ». On ferme les yeux et on mobilise les autres sens, on utilise des processus de visualisation du monde à venir qui rejoignent les pratiques de design fiction, pour voir ce qui résiste en nous. Dans tout processus de transformation, les expériences permettent de travailler sur les peurs et les fixations traumatiques, pour dénouer les résistances.
Avec des chercheurs et des citoyens, vous avez rédigé trois propositions de loi déposées à l’Assemblée nationale. Combien de temps a exigé ce travail ?
Trois ans. Si l’on fixe à une communauté humaine un horizon trop court pour produire une décision, quelque chose se crispe et produit l’effet inverse. Il faut autoriser le flottement, rechercher la suspension du jugement, pour attendre le moment où la délibération collective prend cette forme quasi métabolique. C’est ça qui rend le changement possible. C’est une recherche très consciente d’un mode d’échange dans la douceur, débarrassé du poison de la violence politique et de la brutalité du temps court.
Quels repères démocratiques fixez-vous à ce collectif, par exemple pour garantir l’équivalence de la parole entre les citoyens et les chercheurs, y compris vous ?
La critique des « démarches d’initiés », des « processus élitistes » m’a toujours paru parfaitement démagogique. En réalité, la démocratie participative est, par essence, une scène d’initiés. Je crois que nous sommes tous des acteurs et actrices dans une bataille culturelle pour définir les termes de la vie commune. J’assume pleinement le fait d’être là pour défendre une sensibilité, une forme, pour donner des voix et une force juridique aux entités naturelles. Je l’énonce pour les personnes qui s’engagent dans ces processus. Et je les laisse cheminer. Ils savent parfaitement « le monde à venir » vers lequel je veux les emmener.
Il n’y a de toute façon ni neutralité de la science aujourd’hui, ni neutralité des espaces démocratiques ou médiatiques. Le Conseil des témoins a été formé par « la main du hasard ». Ce n’est pas moi, mais Caroline Lanciaux, responsable du développement scientifique et des partenariats à l’Institut d’études avancées de Nantes, qui a recruté les participants pour que notre chemin ensemble nourrisse des réflexions sur le territoire, pour Nantes, pour l’estuaire, pour le fleuve. La Convention citoyenne pour le climat avait d’autres moyens, elle a fait différemment, en tirant au sort 150 citoyens pour approcher une diversité de population. Mais elle a souffert d’autres biais. Le dispositif était fortement orienté par le pouvoir exécutif qui a imposé d’emblée sa logique.
Comment avez-vous animé le collectif ?
Caroline Lanciaux, qui fut donc « la main du choix », à partir des enjeux du territoire, avait la charge du soin, de l’attention, de l’information. J’avais, pour ma part, la charge de proposer des expériences d’écoute, des visualisations, des rencontres. On a entendu des politistes, des hydrogéologues, des anthropologues, des théologiens, des élus… Rien n’est demandé aux citoyens a priori, je suspends la charge de produire quelque chose. Mais il y a ce moment très fort où, le collectif ayant traversé des savoirs, des expériences, il veut agir, passer à l’acte, même en débordant celles et ceux qui l’ont encadré. Apparait l’envie de transformer le savoir reçu et de produire quelque chose. C’est ce qui a eu lieu : le Conseil des témoins a décidé d’écrire des lois instituant les droits de la nature en France, pour la Loire et pour l’estuaire.
Raconter collectivement, c’est ainsi que vous définiriez la méthode ?
Je ne revendique pas de méthode, chaque projet est différent. J’avance avec un collectif. Celui-ci avait au moins trois polarités : les citoyens, les chercheurs associés et les pollinisateurs, ces artistes invités à suivre le processus. C’est un moment frappant lorsque les images de la photographe Anne-Marie Filaire et de la documentariste Camille de Chenay sont données à voir au Conseil des témoins, car les citoyens se voient alors comme protagonistes de l’histoire en cours.
Des régions du monde ont adopté des droits de la nature. Vous ont-elles inspiré ?
Il y a beaucoup de confusions dans les commentaires sur ce mouvement pour donner des droits à des entités naturelles. La principale consiste à mélanger les questions qui relèvent du droit constitutionnel et du droit public avec les questions qui relèvent du droit privé. La lagune de Mar Menor, en Espagne, est désormais une personne non-humaine et elle relève du régime général des personnes dans le droit privé. Dans Le Fleuve qui voulait écrire, j’avais abordé les deux dimensions à la fois. D’une part, comment le contrat social est en train de s’ouvrir aux perspectives, aux valeurs, aux besoins des êtres naturels ? D’autre part, comment instituer, dans le jeu d’acteurs de nos sociétés, des sujets de droit non-humains ? Ce sont des questions liées, mais entièrement autonomes. On pourrait changer l’organisation du bicamérisme en France, pour accueillir les voix de la nature ; et pourtant, ne pas permettre que la Loire devienne un sujet de droit. Et l’inverse est possible. Mais on peut aussi faire les deux ensemble. Depuis les auditions du Parlement de Loire, je travaille moins sur la dimension publique. Je cherche plus à donner forme à un monde avec des acteurs qui portent les valeurs, les temporalités des entités naturelles. Je me demande notamment ce que l’affirmation de personnes naturelles dotées de droits pourrait changer à l’économie politique dans laquelle nous vivons.
Comment représenter ces entités naturelles, concrètement leur donner une voix ?
Il y a un réflexe de démocratie participative que l’on retrouve dans le modèle proposé par la Loi Mar Menor de 2022. Dans ce cas espagnol, seul exemple européen actuellement d’une personne non-humaine dotée de droits, la tutelle mise en place dépend de trois conseils avec des règles de majorité. Le risque, à mes yeux, c’est d’avoir un ensemble complexe et qui dévore les budgets alloués à la lagune. Ce que l’on doit rechercher, à mes yeux, c’est un chemin d’incarnation, qui donne un maximum de puissances d’agir, dans l’espace social, aux entités naturelles. Il faut éviter que les droits reconnus aux non-humains se dissolvent dans des agencements participatifs lents et couteux. Et puis, en France, cet ensemble institutionnel existe déjà avec les Agences de l’eau, par exemple. On doit donc vraiment œuvrer à faire émerger une « voix ».
Je suis aligné sur ce point avec Marie-Angèle Hermitte, la juriste française pionnière qui, dès les années 1990, parlait « d’animisme juridique ». Pour instituer une perspective non-humaine, l’exemple néo-zélandais pour représenter le fleuve Whanganui me semble préférable : deux gardiens humains pour être le visage humain et la voix humaine de la rivière. L’intensité d’incarnation est plus forte. Et donc, l’aura de la rivière aussi. Il est plus facile dans ce cas de faire entendre le point de vue propre de l’entité naturelle.
Quelle forme d’organisation proposez-vous dans les textes déposés à l’Assemblée ?
Les textes portant sur la personnalité juridique de la « Loire avec son bassin versant » et sur les droits de l’estuaire hybrident ces deux modèles : une incarnation forte, pour le « visage humain », suivant la voie prise pour le Whanganui, mais avec certains éléments de la loi Mar Menor, en particulier les critères de désignation des gardiens et ceux portant sur les ressources propres de la personne et son existence sociale. Pour être dans le Conseil des gardiens de la lagune de Mar Menor, c’est un lien d’attachement à l’entité naturelle ou un critère d’engagement scientifique ou écologique avec la lagune qui sont privilégiés.
La troisième proposition de loi, qui vise la reconnaissance en droit français de ces nouveaux sujets du droit, est une « loi-cadre », elle laisse ouverte la question des formes de l’incarnation. Il existe mille chemins pour incarner les voix des entités naturelles.
Pourquoi cette distinction entre incarnation et représentation ?
La représentation, c’est ce qui va mal dans nos démocraties. On parle depuis des décennies de « mal-représentation ». L’incarnation, c’est un mot qui porte une autre valeur, une autre exigence. Cela ramène du corps dans l’espace abstrait des humains. Si nous créons, dans le droit, ces nouveaux acteurs pour porter les valeurs, les besoins, les modes d’existence des entités naturelles auxquelles nous sommes attachés, notre unique objectif doit être de travailler à l’intensification de leurs présences dans l’espace social. La représentation a tendance à voler des puissances d’agir, d’énonciation. À l’inverse, avec l’incarnation – « visage humain » et « voix humaine » des entités naturelles – on a un lien beaucoup plus fort qui est recherché : un entrelacs, humain et non-humain, indémêlable.
Mais bien sûr, à ce stade, nous faisons des propositions. La discussion publique ne fait que commencer pour détourer ces nouveaux êtres du droit. L’option pour la Seine semble être de créer une personne Seine relevant du droit public[3]. L’option pour la Loire est également sur la table des députés à qui nous avons confié les propositions. Pareil pour l’estuaire. Mais à ce stade, là n’est pas le plus important. Comme dans les processus que j’anime, je pense qu’il nous faut « suspendre le jugement », laisser flotter les formes à venir, en discuter, en proposer d’autres. Il faudra, dans tous les cas, permettre des adaptations pour respecter les lieux, les modes d’attachement, les formes et forces auxquelles nous nous apprêtons à donner des puissances d’agir, en société.
Propos recueillis par Valérie Urman