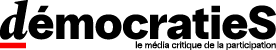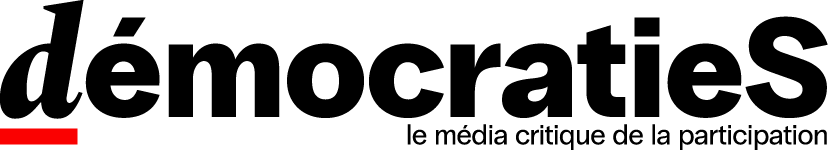Antoine Ancelet-Schwartz
Doctorant en science politique
Je soutiens ici que notre rapport à la chanson comme objet de loisirs, futile ou scandaleux, au choix, dit quelque chose de notre rapport à la politique et, plus précisément, à la démocratie.
En façade, la pratique musicale n’est guère encouragée en politique. Pourtant, chanter en manif et parfois danser sur les playlists qui font partie de la culture de la protestation à la française, c’est habituel. Se lancer dans un karaoké à une soirée d’université d’été, à une fête de parti ou de syndicat, pourquoi pas ? À titre d’exemple, les karaokés de Marine Tondelier sont devenus presque autant une institution que sa veste verte. Pousser la chansonnette dans les repas des aînés ou dans les maisons de retraite lors des campagnes électorales, ça se fait : à Lyon, Gérard Collomb était réputé pour sa bonne maîtrise de l’exercice. En revanche, quand c’est un député qui entonne un chant traditionnel dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale, le rappel à l’ordre est immédiat et le jugement sans appel : c’est forcément grotesque et bien à l’image de l’auteur de la performance, Jean Lassalle.
À quoi bon vouloir que chacune et chacun puisse faire entendre sa voix, si la voix en question doit se taire dès lors que le propos est accompagné d’une mélodie ? Pourquoi ne chanter que sous la douche ou dans les embouteillages ? D’autant plus que nombre de chansons alimentent nos représentations, ajoutent quelque chose à nos convictions, entrent dans nos répertoires.
Si on propose de positionner, sur une échelle droite gauche, « Ma liberté de penser » de Florent Pagny et « Foule sentimentale » d’Alain Souchon, la plupart d’entre nous allons ranger ces chansons dans les mêmes boites, leur appropriation par des groupes sociaux bien précis leur ayant donné leur coloration partisane. Et il n’y a pas que les chants militants, les protest songs, les « People have the power » de Patti Smith ou « Le peuple a le pouvoir » de Tiken Jah Fakoly… Il y a aussi les chansonniers, toujours aussi appréciés, par des personnes aux opinions différentes, comme en témoigne le succès des Goguettes. Même des groupes de musique mondialement connus chantent la politique. « Electioneering » de Radiohead, est un excellent témoignage de la défiance croissante des électeurs envers la démocratie représentative, de l’évitement et de l’autonomisation qu’elle suscite. « Politik » de Coldplay, n’est pas seulement une critique de la réaction guerrière et sécuritaire de l’Occident après le 11 septembre, c’est aussi un petit traité de sciences sociales sur la politisation. Et on ne compte plus les œuvres de fiction dont les musiques ont été reprises par des acteurs politiques, comme « l’Arbre au pendu » de la série de films Hunger games.
De plus en plus de politistes et de sociologues tissent ce lien entre chanson et expression démocratique. Philippe Corcuff intègre depuis longtemps des bouts de chansons d’Eddy Mitchell à ses publications. Le dernier ouvrage de Vincent Tiberj « La droitisation française. Mythe et réalités »[1], est chapitré avec des titres de chansons. Tout récemment, à l’occasion de la sortie de leur ouvrage, « Burn-out militant : comment s’engager sans se cramer » [2], Hélène Balazard et Simon Cottin-Marx ont partagé une playlist illustrant leurs principales idées.
Mais alors, pourquoi l’espace public délibératif, nos réunions, nos conférences, nos assemblées sont-elles des lieux où le chant est proscrit, même quand on propose une animation en intelligence collective avec tisane, post-it et facilitation graphique ? Invitons aussi la chanson ! Cet objectif ne me semble pas hors de portée (de notes de musique !).
La chanson peut nous enrichir, par son univers et les conditions de sa production, tant les représentations de la chanson et de la démocratie amènent à des questions communes : dans quel système chacun peut-il le mieux jouer sa partition ? Avons-nous vraiment besoin de chef d’orchestre, à quelle place, pour faire quoi ? Devons-nous préférer les seuls en scène ou plutôt les chorales ? Et ces dernières doivent-elles être aussi professionnelles que possible, ou devons-nous prêter aussi l’oreille aux pratiques amateures ?