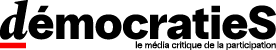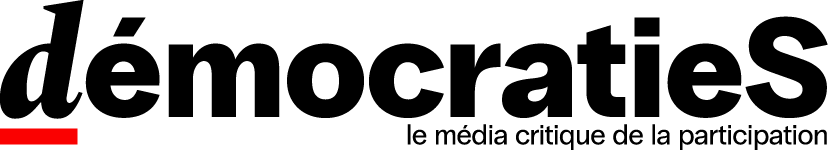avec
Guillaume Petit
Docteur en science politique, service de la participation en Région bruxelloise
Cartographier, montrer mais aussi outiller les acteurs du territoire : ce sont là des rôles du Service de la participation citoyenne de la région de Bruxelles-Capitale. Avec Guillaume Petit à la manœuvre, en tant que chargé d’étude et auteur d’un inventaire des pratiques sur le territoire.
Expliquez-nous comment la politique participative en région bruxelloise s’inscrit dans un contexte plus large ?
L’histoire récente des dispositifs participatifs en Belgique est souvent mise en récit à partir de la crise gouvernementale de 2010, résumée au record mondial de durée sans gouvernement de 541 jours ! Dans ce contexte, des personnalités ont promu la participation citoyenne et la démocratie délibérative [1], comme voie alternative et complémentaire pour pallier l’absence de gouvernement fédéral et des chercheurs se sont engagés pour outiller ces démarches [2]. La recherche académique repère quatre vagues [3] : une émergence des mini-publics [4] à partir des années 2000 ; le moment de la crise de 2010-2011 ; puis une diffusion progressive pendant la décennie suivante et, enfin, les débuts d’une institutionnalisation plus marquée depuis la fin des années 2010.
Autre élément de contexte important : l’intégration, dans les institutions publiques, d’espaces pérennes de participation citoyenne. Par exemple, le Parlement francophone et le Parlement régional bruxellois ont mis en place des commissions délibératives mixtes dès 2017, avec tirage au sort de citoyens et délibération collective avec des élus, assorties à un mécanisme de pétition pour suggérer de nouveaux thèmes. À l’est de la Belgique, la communauté germanophone a institutionnalisé, en 2019, un modèle d’assemblée citoyenne permanente intégrée dans le fonctionnement du Parlement. Plus récemment, en Région bruxelloise, on a vu le lancement d’une assemblée citoyenne pour le climat depuis 2022. Le Parlement fédéral a aussi voté en 2023 un texte pour faciliter le recours au tirage au sort, même si celui-ci n’a pas encore trouvé d’application.
C’est dans ce contexte qu’est créé le service de la participation de la Région bruxelloise. Quel est son rôle ?
Il faut d’abord préciser ce que recouvre la Région bruxelloise. Institutionnellement, c’est un ajout récent à la fédéralisation de l’État belge en 1989. La Région, dont le nom officiel est Région de Bruxelles-Capitale – Brussels Hoofdstedelijk Gewest – compte 1,25 million d’habitants et est composée de 19 communes, dont la ville de Bruxelles avec 198 000 habitants. En cela, elle a une dimension proche d’une métropole française. Mais elle dispose des compétences d’une région, au même titre que la Flandre et la Wallonie, avec des élections distinctes, un Parlement et un gouvernement régional.
Le service de la participation a été créé en 2022, au sein du département Connaissance territoriale de perspective.brussels, le centre d’expertise pour le développement régional et territorial. Ce service est un service ressource, avec un rôle d’accompagnement et de mise en commun, qui offre une expertise aux acteurs publics. Nous gérons une plateforme nommée participation.brussels qui reprend une partie de nos activités et de nos outils, avec des éléments théoriques et pratiques sur la démocratie, la participation et la délibération citoyenne. De plus, nous mettons en place des formations et des espaces d’échange entre agents de la participation.
Vous avez réalisé un inventaire des pratiques participatives sur le territoire bruxellois. Quels en sont les éléments notables ?
Quantitativement, nous identifions surtout une forte majorité d’actions au niveau communal, relevant souvent de l’aménagement urbain et du cadre de vie. Le tirage au sort se retrouve dans une douzaine de ces initiatives. Dans la moitié des cas, c’est le moyen exclusif de constituer un panel, dans l’autre moitié, c’est une voie de recrutement complémentaire. C’est trop peu pour voir le verre à moitié plein, mais on mesure quand même un progrès ! Il faut noter que la pratique du tirage au sort est facilitée en Belgique [5], grâce à l’existence d’un registre national qui intègre aussi les résidents étrangers.
Nous avons également repéré les communes disposant d’un service de participation citoyenne, avec un budget alloué et des moyens humains. Elles sont 11 sur les 19 communes de la région. Elles ont souvent des effectifs limités, en moyenne de 1 à 1,5 ETP [équivalent temps plein] si on met à part la ville de Bruxelles. Mais même sans service dédié, on y trouve des interlocuteurs engagés sur la participation, qui s’occupent d’environnement, d’aménagement urbain, de logement ou de mobilité.
Le tirage au sort, mais aussi d’autres innovations sont assez développées, lesquelles ?
Nous avons effectivement bien repéré le tirage au sort et la volonté d’institutionnaliser de façon pérenne des dispositifs ; mais plus largement à Bruxelles, le contexte social, linguistique et culturel renforce l’enjeu d’inclusion de publics diversifiés. La traduction incite à questionner l’accessibilité et la vulgarisation. Et je pourrais aussi évoquer le modèle de financement et de collaboration avec le secteur associatif, qui permet d’impliquer les participants grâce à un travail de proximité, dans la durée. C’est un modèle qui connaît aussi des difficultés, mais qui contraste avec les évolutions en France [6].
Dans notre rapport, nous documentons également la pratique du « devoir de suite ». Ce qui ressort d’abord, c’est la mise en œuvre de certains projets, notamment des budgets participatifs ou de tout ce qui implique un financement. Autrement, les réponses des pouvoirs publics sont plutôt de l’ordre de la communication, sans toujours questionner si les suggestions citoyennes sont appropriées. À l’inverse, quand les suites s’incarnent dans la mise à jour de plans d’action publique, cela n’est pas forcément rendu public. Nous voulons travailler à faire progresser les deux aspects.
Par ailleurs, une partie des démarches sert au travail inter-administrations, important dans le contexte bruxellois où le service public régional est en partie organisé par organismes thématiques. Il est important de permettre à des citoyens de s’exprimer de façon globale, sans devoir adapter leurs suggestions à la compétence propre de telle ou telle administration. Notre service sert aussi à renforcer cette transversalité.
Enfin, le devoir de suite, c’est aussi le fait de réitérer la participation, de donner de nouveaux rendez-vous et des repères sur les différentes phases des projets, d’avoir des temps publics où l’on revient sur l’ensemble des débats, sur ce qui a été fait ou pas. Notre inventaire permet de mettre en valeur les projets où de telles considérations sont pensées dès l’amont.
Le service de la participation a mis en place un accord-cadre permettant à d’autres administrations de connaître des prestataires du territoire. Quel est son apport ?
En Belgique, comme en France ou ailleurs, un certain nombre d’associations ou d’entreprises (cabinets d’urbanisme, de conseil..) se sont développées sur le marché de la démocratie participative. Dans notre inventaire, les trois quarts des gestionnaires de projet déclarent faire appel à des prestataires. Dans le détail, on distingue à peu près trois tiers : une première partie délègue la totalité d’une démarche ; une autre fait appel à des prestataires pour un appui méthodologique sur un projet ou sur l’ensemble de la politique de participation ; enfin d’autres sont en demande ponctuelle de renfort ou de soutien organisationnel.
La centrale de marchés proposée par notre administration régionale est divisée en lots, pour faire appel à un aspect en particulier (communication, recrutement, animation…) ou être accompagné sur l’ensemble d’une démarche. Pour chaque lot, il y a un travail de sélection de quatre à six consortiums. Le but est de faciliter le recours aux marchés publics, d’apporter une garantie de qualité et d’encadrer les pratiques et les tarifs. Par contre, ce mécanisme facilite l’accès mais n’amène aucun budget supplémentaire ; c’est-à-dire qu’on ne finance pas les autres administrations qui ont recours à la centrale.
De fait, nous nous sommes rendu compte que cet accord-cadre a pu renforcer l’interconnaissance entre acteurs publics et privés, ainsi qu’une mise en réseau entre acteurs privés. S’il demeure avant tout un mécanisme de compétition, il permet des formes de coopération et d’échanges collectifs.
Quelles questions de méthode vous êtes-vous posées pour le repérage et l’analyse des démarches participatives ?
D’abord celle de la définition : que fait-on entrer dans le périmètre ? Nous nous sommes concentrés sur l’offre de participation des institutions publiques, dans une perspective de transparence de l’action publique. Nous regroupons 150 démarches, mais c’est loin d’être exhaustif. Cette définition restreinte n’est pas satisfaisante, car la participation citoyenne peut bien sûr s’entendre de façon beaucoup plus large, mais nous n’avions pas les moyens d’inclure des initiatives ascendantes, parfois portées par des collectifs éphémères.
Une autre question est celle des niveaux de participation. Les répondants ont axé leurs réponses sur la consultation et la co-construction. C’est du déclaratif et on peut dès lors se demander si on parle vraiment de co-construction. Une définition minimale mais exigeante serait d’avoir une délibération entre acteurs sur un pied d’égalité, qui ont chacun leur mot à dire dans le débat qui mène à la décision. Dans les faits, je pense qu’en tant que porteur de projet, on n’a pas forcément envie de dire qu’on mène un exercice uniquement consultatif !
Les niveaux de co-décision et de délégation ne sont, eux, pas beaucoup investis. Mais la délégation l’est davantage que la co-décision. Ici, je crois qu’on retombe encore sur un problème de définition. Si on se réfère à la fameuse échelle d’Arnstein [7], la délégation prend un sens de contrôle et de pouvoir citoyen, allant jusqu’à des formes d’auto-gestion. Cela existe dans le cadre des occupations temporaires ou transitoires, avec des formes de cogestion entre équipes communales, associations et citoyens. Mais la plupart semblent avoir lu le mot « délégation » au sens du financement par appel à projet ou subsides. C’est intéressant, mais « financer » et « déléguer », ce n’est la même idée !
Pour analyser ces déclarations, nous avons aussi mesuré le degré d’engagement en plus du niveau de participation : qu’est-ce que font les personnes qui participent ? Quelles actions entreprennent-elles ? Est-ce qu’elles sont là pour écouter, donner un avis individuel, construire un avis collectif, prendre des décisions, mener des actions ? Croiser le niveau de participation et le degré d’engagement permet de mettre le doigt sur les problèmes de définition évoqués.
Quelles suites voyez-vous à cette étude ?
Les principales suites sont l’extension, l’approfondissement et l’actualisation. Un autre enjeu important est la considération à apporter aux initiatives qui ne relèvent pas de l’offre institutionnelle de participation.
Une question qui a émergé lors des temps de restitution est celle de l’étude des publics. Il s’agirait de ne pas seulement interroger : qui fait participer, à quoi ? Mais aussi : qui participe ? Nous nous sommes centrés sur les mécanismes, sans rentrer dans une sociologie des participants, mais je suis tout à fait d’accord avec l’idée qu’il faille s’intéresser à leurs profils, à ce qu’ils pensent et ce qu’ils retirent de ces espaces participatifs.