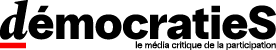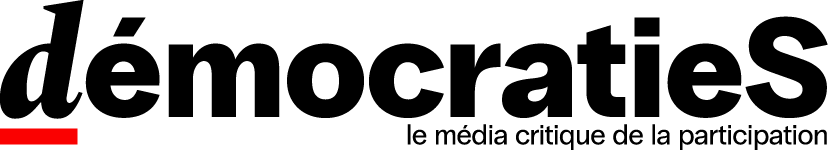Entretien avec
Marine Calmet
Présidente de l'association Wild Legal
La personnification de la nature s’expérimente sous des formes diverses. Leur intérêt tient moins à la forme juridique qu’aux effets transformatifs sur le partage des pouvoirs dans la gouvernance locale du milieu naturel, considère la militante Marine Calmet.
En quoi le droit actuel est-il inadapté, selon vous, pour protéger le vivant ?
Le droit de l’environnement s’inscrit dans une démarche de protection des ressources naturelles en tant que marchandises ou services. Il préserve les milieux de vie auxquels nous attachons une valeur matérielle ou immatérielle. Il traduit des valeurs – utilitariste, patrimoniale – que nous accordons à notre environnement. Ce droit objectivise le monde vivant selon des critères d’usage ou de propriété : il est incomplet et impuissant à saisir nos rapports d’interdépendance vitale avec les milieux naturels.
Les droits de la nature répondent à cette incapacité, en se donnant pour fonction de subjectiviser les entités naturelles, pour refléter une relation juste avec le vivant.
Tout un pan de la biosphère est exilé de nos institutions politiques, hors de notre regard. Cet aveuglement conduit à l’effondrement du vivant. Faire entrer les autres qu’humains dans notre horizon mental conduit à rénover de fond en comble nos modèles démocratiques[1].
Pourquoi la plupart des expériences de reconnaissance du vivant non humain concernent-elles l’eau ?
Qu’il s’agisse de barrages, de méga-bassines ou de pollutions, les atteintes aux milieux aquatiques sont perçues comme une menace vitale. Elles catalysent les révoltes populaires qui exigent de donner priorité à la vie. C’est un mouvement de résistance, comme l’a montré la mobilisation citoyenne pour la lagune de la Mar Menor, en Espagne [lire notre article sur la Mar Menor], et pour beaucoup d’autres écosystèmes dans le monde.
Mais le mouvement des droits de la nature porte un objectif de protection intégrale de l’ensemble des milieux, pas seulement aquatiques. L’Équateur a été le premier pays, en 2008, à donner des droits à la Terre Mère – compris comme l’ensemble du territoire sans distinction – inscrits directement dans sa Constitution. D’autres pays ont pris une voie différente, en accordant à une forêt, une montagne, un statut juridique d’entité vivante par l’adoption d’une loi spécifique [lire notre article Droits de la nature, repères historiques ].
Quelle appréciation portez-vous sur des approches aussi différentes ?
L’intérêt du mouvement des droits de la nature est d’être organique, il vient du sol et des gens. L’exemple de l’Équateur est puissant mais c’est un cas unique au sens où il s’agit d’un moment démocratique propre à cette région avec sa culture, sa cosmopolitique andine et des circonstances politiques favorables. Les communautés autochtones et les ONG ont porté ce combat, les autorités ne l’oublient pas. Quinze ans plus tard, en dépit des retournements politiques et économiques, les gouvernements successifs n’ont pas pu revenir sur ces droits fondamentaux. Alors que l’administration voudrait distribuer à tout va de nouveaux permis miniers et intensifier la pêche, la Constitution permet à la société civile organisée de tenir bon et de défendre ces acquis devant les juridictions. C’est un accomplissement décisif en comparaison de ce que nous observons en droit français.
La puissance de ce changement systémique représente, pour moi, un idéal. Mais le principe de réalité impose de tenir compte d’autres options, chaque avancée compte. Il suffit de voir la dureté du combat maori en Nouvelle-Zélande où la situation est tendue au sein du Parlement. Les communautés doivent se battre pour faire reconnaitre les droits de la nature, écosystème par écosystème. Les maoris considèrent que certaines montagnes, fleuves ou forêts sont des entités indivisibles et vivantes, avec lesquelles ils entretiennent un lien inaliénable, les assimilant à des ancêtres éloignés. Faire reconnaître juridiquement leurs valeurs traditionnelles participe aussi d’une lutte d’émancipation du pouvoir colonial. Après la reconnaissance de la personnalité juridique du fleuve Wanganui, ils ont obtenu des droits similaires pour le Mont Taranaki[2] et la montagne a retrouvé son nom d’avant la colonisation britannique.
Le mouvement des droits de la nature a l’avantage de produire des démonstrations opérationnelles, les modèles différents traduisant la diversité des héritages culturels. Le fil rouge, partout, c’est la reconnaissance de l’altérité.
Quelle forme ces droits pourraient-ils prendre en France ?
Selon moi, la personnalité juridique n’est pas un obstacle, bien qu’elle fasse débat parmi les juristes [lire notre entretien avec Alexandre Zabalza] et même parmi les écologistes. Notre droit reconnaît déjà les parcs naturels comme des personnes morales dotées d’un budget, d’un conseil d’administration, de la capacité d’agir en justice. Personne ne trouve bizarre qu’un parc naturel soit une personne. C’est donc un véhicule juridique qui devrait permettre d’embarquer des droits.
Notre histoire justifie, dans la continuité des personnalités morales accordées aux entreprises ou aux syndicats, de créer des « personnes naturelles ». Ce que les économistes et les juristes ont su conceptualiser pour répondre aux besoins des organisations humaines, nous pouvons l’adapter aux besoins des écosystèmes.
La question déterminante, au-delà de la forme juridique à définir, c’est de repenser le modèle démocratique permettant d’exercer effectivement ces droits.
Comment envisager la représentation des « personnes naturelles » ?
C’est un problème de processus de décision et de partage des pouvoirs. Et cela interroge aussi les approches de participation. Aujourd’hui, on consulte les citoyens sur les grands aménagements affectant leur environnement. Il faut faire entrer les milieux naturels, en tant que sujets, dans l’agora. J’aime beaucoup la phrase d’Ilaria Casillo [vice-présidente de la Commission nationale du débat public] disant que « les droits de la nature sont l’aboutissement des droits participatifs, la pièce manquante du puzzle ».
Nos modèles de représentation ne sont pas pensés pour protéger la nature pour elle-même. Dans les institutions, la nature n’a pas de siège réservé, les citoyens sont ramenés à leur condition d’usagers, les défenseurs de la nature sont noyés parmi les parties prenantes. Par exemple, dans les commissions locales de l’eau, comme dans les comités de bassin, les associations qui défendent la nature siègent au même titre que les acteurs exploitant les milieux aquatiques, les énergéticiens, les pêcheurs, les agriculteurs, les acteurs du tourisme…
Les organes de gouvernance des milieux naturels ne sont pas pensés pour subordonner les décisions aux limites écologiques et à l’habitabilité des milieux de vie.
Comment concevoir une gouvernance appliquant les droits de la nature ?
En s’inspirant des idées du mouvement des droits de la nature à l’international. En Espagne, le Conseil de gouvernance de la Mar Menor vient de se constituer. On manque de recul pour l’évaluer mais le modèle est intéressant. Il s’appuie sur trois comités articulant les pouvoirs des élus, des acteurs locaux, des scientifiques et des citoyens qui disposent d’une représentation majoritaire dans le Conseil des gardiens. Cette pondération des pouvoirs dans un organe de représentation du milieu naturel, c’est du jamais vu.
D’autre part, l’Espagne et l’Équateur ont reconnu à toute personne – physique ou morale – le droit d’agir en justice au nom de la nature en cas de violation de ses droits. Cela règle une épineuse question : il ne peut pas y avoir de mainmise sur la représentation de la nature par quelques-uns dans un comité. Chacun de nous est lié au milieu de vie, chaque citoyen et citoyenne doit pouvoir défendre la nature.
Je suis moins convaincue par l’organisation des « gardiens » du fleuve Wanganui, en Nouvelle-Zélande, car l’instance de tutelle est composée de deux membres, une personne nommée par les clans maoris, l’autre par le gouvernement. Cette gouvernance risque de mener à un blocage, l’État s’efforçant de conserver le contrôle de la décision. J’y vois un reliquat de l’histoire coloniale. Cela montre bien que le plus dur à obtenir, ce n’est pas la création d’une personne morale, ni même des droits pour la nature, c’est le rééquilibrage du rapport de force.
Nos institutions sont-elles mûres pour une telle transformation ?
C’est une transition démocratique à mener. Pour reprendre l’exemple des commissions locales de l’eau, on les appelle les petits Parlements de l’eau alors que le pouvoir tient essentiellement dans la main du préfet. Il peut bloquer des décisions collégiales, même lorsque celles-ci s’accordent pour protéger les milieux aquatiques. Il faut repenser l’équilibre politique et les processus de décision au sein de nos institutions.
Culturellement, la France vous paraît-elle réceptive à ces nouveaux droits ?
Notre histoire, la tradition humaniste, la philosophie des Lumières, les droits humains, ont forgé un système de valeurs solide et en constante évolution. À mes yeux, la reconnaissance du statut juridique et des droits de la nature est le prolongement logique de l’élargissement progressif de notre société aux minorités oppressés, noirs, femmes, enfants… C’est un post-humanisme qui répond à l’invisibilisation des vivants autres qu’humains dans notre sphère politique.
Malheureusement, on ne peut pas ignorer que beaucoup de choix politiques, ces dernières années, tendent à faire reculer les droits environnementaux et sociaux, priorisant les objectifs économiques. La concentration du pouvoir et des richesses dans les mains d’une minorité est un obstacle majeur pour les droits de la nature, comme pour les droits humains.
Percevez-vous une évolution dans les territoires sur ces questions ?
Depuis 2021, Wild Legal a consolidé un réseau de 25 sites pilotes en France ; il en existe des dizaines d’autres en métropole et dans les territoires ultramarins. Dans ces temps de crise démocratique et écologique, le mouvement progresse rapidement, notamment auprès des acteurs de terrain, confrontés aux lacunes du modèle juridique actuel et déterminés à consolider la protection du vivant. C’est un mouvement de re-légitimation de la parole et de l’action citoyenne, de réappropriation des outils du droit au service des populations et des territoires.
Notre mouvement, qui promeut la diversité des cultures, trouve un écho particulier en Corse, en Martinique, en Nouvelle-Calédonie, en Guyane. Le droit coutumier kanak peut nous inspirer des solutions juridiques, comme le “principe unitaire de vie” qui traduit les liens culturels et biologiques entre les humains et leur milieu.
Propos recueillis par Valérie Urman