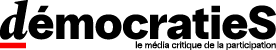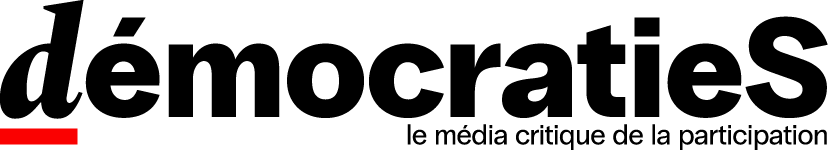Entretien avec
Anita Baudry
Coordinatrice du pôle social du Centre socioculturel de Chemillé-en-Anjou
Emmanuel Bioteau
Géographe, professeur à l'Université d’Angers.
Des territoires du Maine-et-Loire et d'Alsace, accompagnés par des chercheurs, se sont engagés pendant trois ans pour mobiliser des personnes éloignées de l’emploi. Les transformations se font ressentir au sein des institutions autant que chez les personnes.
Pouvez-vous expliquer les fondements du projet La Locomotive ?
Anita Baudry : Le projet La Locomotive a été lancé dans le cadre du Plan d’Investissement Compétences 100 % Inclusion qui avait pour vocation de développer de nouvelles formes d’accompagnement des publics les plus éloignés de l’emploi [1]. L’idée centrale de notre projet était que les personnes concernées devaient être associées, dès le démarrage, à l’élaboration de la démarche. Ce sont des personnes isolées, en situation de pauvreté, de précarité, des parents solos, des jeunes sortis du système scolaire, des personnes en situation de handicap, des primo-arrivants, des personnes ayant un suivi judiciaire… Le projet a réuni quatre territoires : deux dans le Maine-et-Loire, à Cholet et à Chemillé-en-Anjou, et deux en Alsace, à Strasbourg et à Molsheim-Schirmeck, donc deux en milieu urbain et deux dans le rural.
Vous souhaitiez toucher les 10 à 20 % de personnes qui n’entrent pas dans les dispositifs classiques. Comment êtes-vous allés à la rencontre de ces personnes isolées ?
Anita Baudry : Dans notre territoire, par exemple, nous avons commencé avec des personnes bénéficiaires du RSA. Nous avons ensuite associé des personnes qui apprenaient le français avec l’association Forma.Clé. Puis, nous avons réuni un groupe de personnes en recherche d’emploi. Peu à peu, ces personnes ont réfléchi avec nous : comment contacter les personnes non connues des institutions et associations, non accompagnées ? Nous avons ouvert des permanences dans les communes, le bouche-à-oreille a fonctionné, nous avons pu recruter une personne qui a fait du porte-à-porte… Finalement nous avons touché de nombreuses personnes qui étaient en dessous des radars, en situation d’isolement.
En quoi le fait d’associer des personnes accompagnées a changé vos démarches habituelles ?
Anita Baudry : Contrairement à des enquêtes ou à des retours d’expériences de professionnels, nous étions dans la réalité et non dans l’interprétation. Ce n’est pas la même chose d’organiser une réunion de mise en place d’un accueil collectif avec des professionnels et des habitants autour de la table, que de la faire uniquement entre professionnels, en imaginant ce que voudraient les personnes ou ce qui les intéresserait. Nous avons dû adapter notre langage, notre façon d’agir, notre vocabulaire.
Alors que les professionnels réfléchissent, analysent, structurent, organisent, planifient avant de passer à l’action, les habitants eux, poussent à agir, à nous mettre rapidement en mouvement. Mais ce processus de coopération demande aussi du temps, le temps de se connaitre, de se faire confiance et d’apprendre à travailler ensemble, tout en prenant en compte les particularités de chacun.
Emmanuel Biotteau : Ce que cela a pu changer dans le processus ? Je dirai, dès le départ, une plus grande attention portée aux paroles, à la description des situations rencontrées par les personnes : une approche sensible, basée sur les vécus, à l’appui de témoignages, plutôt que les représentations que l’on peut se faire. Cela a aussi permis de rendre évidente la nécessité d’une approche transversale plutôt que le déploiement d’actions sectorisées ; les enjeux pour une personne accompagnée sont nécessairement multiples et imbriqués. Donc une adaptation immédiate aux besoins ressentis, mais aussi un ajustement des temps ! Les ateliers, comme les temps de rencontre individuels, ont systématiquement été pensés à partir des problématiques de temps et de mobilité des personnes, l’un allant avec l’autre.
Le projet a duré trois années. Le soufflé n‘est-t-il pas retombé ?
Emmanuel Bioteau : Il fallait bien ce temps pour tout construire collectivement. Certaines personnes ont mis deux ans pour venir régulièrement, sortir de chez elles, ne serait-ce que pour lire le journal dans les locaux. Le projet La Locomotive a une dimension très individualisée, l’idée n’était pas de faire entrer les personnes dans une démarche, mais de les associer à un chemin qui se définissait avec et à travers elles. Rien n’était obligatoire. Ce sont les personnes qui décidaient de leur parcours. Les partenaires ont toujours organisé des réunions ensemble pour prendre en commun, si possible, toutes les décisions. Tout le monde avait voix au chapitre et la même voix. C’est pour cela qu’il faut du temps, ce n’est pas inné pour un professionnel de se mettre à la même hauteur qu’un participant. À la fin, il n’y avait plus de distance entre les chercheurs, les professionnels et les personnes accompagnées.
Anita Baudry : Toujours avec les personnes impliquées, nous avons imaginé à Chemillé-en-Anjou un billet loco qui assurait le suivi tout au long du parcours. Nous avons créé des espaces de discussion, plus ou moins formels et les personnes, au fil de l’eau, pouvaient tout secouer, en disant par exemple : « Vous arrêtez avec votre vocabulaire, parce que là, vous êtes en train de parler de diagnostic, vous êtes en train de parler de protocoles, c’est bon, on n’est pas malades » et ensemble nous réajustions au fur et à mesure. Le programme s’est nourri de l’approche du croisement des savoirs et des pratiques développée par ATD Quart monde [2].
Dès le départ, vous avez mis en place un suivi évaluatif, sous forme de mesure de l’impact, l’avez-vous travaillé avec les personnes impliquées ?
Emmanuel Bioteau : Les critères n’ont pas été choisis avec les personnes accompagnées, mais les outils et méthodes de collectes d’informations ont fait l’objet d’échanges en amont. Toute information obtenue a été le fruit d’une négociation, en ajustant l’outil de collecte à la situation de la personne, à ses aspirations [3].
Anita Baudry : En tant que professionnels, au départ nous avons vu cette mesure de l’impact comme une injonction à devoir remplir des tableaux. Nous n’avions pas l’habitude, dans notre secteur d’activités, de remplir ce type de tableaux. Mais après les premiers éléments d’observation, nous avons pu voir tout l’intérêt d’adopter cette démarche. A Chemillé-en-Anjou, les habitants ont participé à l’élaboration d’un carnet de voyage qui a alimenté la mesure de l’impact.
Le projet a permis aussi d’embarquer des partenaires sur le territoire, des acteurs publics et privés ?
Anita Baudry : À Chemillé-en-Anjou, nous sommes partis du centre social, lequel est également antenne de la Mission locale du Choletais. Puis une structure d’insertion par l’activité économique nous a rejoint, puis un centre de formation intervenant sur le français langue étrangère, un lycée autour des décrocheurs scolaires, une association sur des questions de mobilité, une coopérative d’acteurs… Nous avons souhaité associer une agence d’intérim classique. Mais nous n’avions pas avec nous la direction nationale et, pour l’équipe locale, le rapport entre le temps imparti et le bénéfice ne convenait pas. On se rend compte que pour les structures de droit privé stricto sensu,
– sans parler de toutes celles qui sont de l’économie sociale et solidaire – ce type de démarche prend trop de temps, car nous sommes dans un mécanisme qui repose sur une absence de bénéfices financiers à court terme.
Le projet La Locomotive a facilité nos liens avec la mairie et la Maison départementale des solidarités. Il nous a permis de mieux nous connaître entre associations et institutions dans le territoire et de lancer ensuite d’autres projets, comme Territoires zéro non-recours, porté par la commune. Aujourd’hui, la coopération s’installe mieux entre nous, grâce au vécu de La Locomotive. Mais il faut la cultiver, continuer à travailler ensemble, associer les personnes dès le début, en s’appuyant sur des méthodes de croisement de savoirs, de porteurs de parole… Dans les propos des élus, on sent qu’ils ont entendu des choses, comme le fait d’avoir besoin de temps pour mobiliser et permettre que la confiance s’installe…
Vous avez travaillé dans quatre territoires, deux dans le rural et deux dans l’urbain. Avez-vous repéré des différences entre territoires en termes de mobilisations d’acteurs et de personnes ?
Emmanuel Bioteau : En termes de mobilisation, en milieu rural, à partir du moment où vous arrivez à créer de l’interconnaissance avec une personne, vous pouvez assez rapidement l’étendre au voisinage ; les contacts ont fonctionné par grappes de personnes. En milieu urbain, au pied d’immeubles, il faut mobiliser grâce à des intermédiaires qui connaissent le quartier, car les intervenants travaillent avec des populations importantes. Par exemple à Strasbourg, ce sont des quartiers de 8 000 à 10 000 habitants.
Chaque territoire, en fonction de son organisation et de sa sociologie, a développé des méthodes spécifiques pour aller à la rencontre des publics. Les solutions reposent sur les grappes relationnelles entre personnes et institutions ; les centres sociaux ont joué, dans certains territoires, un rôle central, pivot de la connaissance des personnes et constructeurs de collectifs.
Le projet a un effet sur les territoires, au sens où La Locomotive est parvenue à créer de nouvelles habitudes, de nouvelles façons de faire ensemble.
Propos recueillis par Sylvie Barnezet
Les carnets de voyage
Tout au long du projet, des équipes de chercheurs des universités d’Angers et de Strasbourg ont été parties prenantes de la démarche. Il s’agit de deux unités du CNRS : le laboratoire Espaces et Sociétés (ESO) qui a pour projet scientifique de contribuer à l’appréhension de la dimension spatiale des sociétés et le Laboratoire interdisciplinaire en études culturelles (LINCs). Des carnets de voyage ont été écrits par les chercheurs pour garder trace de toutes les étapes, méthodes et outils développés : des personae, des jeux, des balades… Des formats courts explicatifs ont aussi été réalisés, structurés en neuf chapitres.
Tout est à retrouver sur : https://www.la-locomotive.org/index.php/voyageurs.html