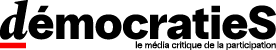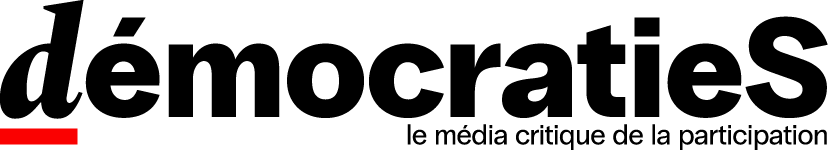par
Nicolas Camerati
Sociologue, chargé de médiation à la Maison de l’IA
Qu’est-ce que l’intelligence artificielle pourrait faire aux espaces participatifs ? À partir d’une expérimentation menée avec le Conseil de développement de la métropole du Grand Paris, Nicolas Camerati pointe la manière dont la technologie peut pousser à se poser les bonnes questions.
Ce qui fait tenir un processus collectif, ce sont des cadres qui mettent les personnes en relation. Quand on veut produire du commun, il faut des manières de faire qui structurent le processus de réflexion. Il faut également des conditions matérielles (espaces, outils, objets, accessoires) qui rendent les échanges possibles, visibles et sûrs. L’architecture, à la fois matérielle et procédurale, permet aux idées de circuler, aux désaccords d’être travaillés et aux décisions de se stabiliser.
L’IA, outil et objet d’observation
C’est en travaillant ces configurations – manières de faire, supports, dynamiques d’interaction – que je me suis posé la question : que se passe-t-il quand on ajoute un élément non-humain dans la chaîne ? Et si l’on introduisait une intelligence artificielle dans un dispositif participatif, comme on introduit une carte, un tableau de post-it, une image projetée ? Non pas pour décider ni parler à notre place, mais pour organiser ce qui se dit, reformuler ce qui se cherche, faire apparaître ce qui ne se voit pas toujours ? L’IA, dans ce cadre, n’est pas plus intelligente qu’un cercle de parole ou qu’un plan annoté : c’est un accessoire parmi d’autres, placé dans une situation dont on observe les effets. Ce qui m’intéresse, ce n’est pas ce qu’elle est, mais ce qu’elle fait faire. Et c’est précisément cette hypothèse que nous avons mise à l’épreuve au sein du Conseil de développement de la métropole du Grand Paris.
L’expérimentation a démarré sur un paradoxe : utiliser l’intelligence artificielle pour analyser l’intelligence artificielle ! Une tautologie qui a rapidement trouvé un écho auprès des participants. Car cette idée ouvrait un espace pour mettre à distance nos préjugés : avant de statuer sur ce que l’IA pourrait ou devrait faire dans le cadre de la métropole du Grand Paris, il fallait d’abord explorer ce que nous croyons déjà savoir d’elle.
C’est dans cette logique que nous avons inscrit le protocole liée à une demande concrète : accompagner les participants du Conseil de développement dans la rédaction de recommandations sur l’usage de l’intelligence artificielle dans les politiques publiques métropolitaines. Mais au lieu d’aborder ce sujet de manière abstraite, nous avons fait le pari de mettre les outils sur la table, les manipuler ensemble, les tester dans nos propres processus. Ce jeu de miroirs – réfléchir sur l’IA tout en travaillant avec elle – a transformé la commande en terrain d’expérimentation et d’innovation.
Crainte, fantasmes, méfiance, enthousiasme
Ce double mouvement correspond bien à la vocation du Conseil de développement. En tant que centre de participation citoyenne, il ne se limite pas à produire des avis ; il cherche aussi à ouvrir des voies nouvelles, dans les méthodes mises en œuvre et dans les possibles de la participation. L’introduction de l’IA ouvre l’hypothèse de la considérer comme un accessoire [1] pour construire une intelligence collective. L’objectif étant de suspendre momentanément les jugements épochè [2] pour explorer, ensemble, ce que l’IA fait concrètement. Cela suppose de prendre au sérieux les représentations initiales de chacun : la crainte, les fantasmes, la méfiance, l’enthousiasme. Toutes ces projections forment une matière de départ. Nous avons choisi de les accueillir, de les nommer, de les confronter et d’en faire un levier de réflexion collective.
Utiliser l’IA, c’était déjà une façon d’en parler autrement à partir de l’expérience, des usages, des réactions du groupe. C’est dans ce contexte qu’ont été lancés des ateliers conçus comme une série d’allers-retours entre expérience et analyse, où chaque séance nourrit la suivante. Pas de programme figé, mais des formats ajustés en fonction des retours : l’atelier devient une scène d’enquête collective, où l’on apprend en faisant et en doutant ensemble.
Le premier atelier a valeur de démonstration. L’objectif est d’éprouver des usages concrets : vitesse de réponse, capacité de synthèse, génération d’images, production de vidéos, rédaction de fiches d’analyse. Différents outils sont mobilisés – ChatGPT, DALL·E, Gamma, Veed – sur des questions tirées directement des politiques publiques métropolitaines : densité urbaine, mobilité, tourisme. La projection en temps réel de ces contenus produit un effet de bascule ; l’IA cesse d’être une abstraction pour devenir une réalité manipulable et discutable.
Les réactions sont immédiates et contrastées. Intérêt pour la rapidité et la clarté des réponses, mais aussi réserves sur les biais, le coût énergétique, la standardisation des contenus, les risques d’hallucinations [invention de faux contenus par l’IA] et les enjeux éthiques. Plutôt que de les écarter, nous avons accueilli ces critiques comme des matériaux.
Un dialogue entre les participants, le médiateur et l’IA
Au fil des ateliers, un point s’est imposé : la qualité de l’interaction conditionne la qualité des résultats. Plus les participants formulent des demandes précises, nuancées et contextualisées, plus l’IA produit des réponses pertinentes. Le cheminement des questions l’illustre : « Comment l’IA peut-elle contribuer à transformer la métropole du Grand Paris en un espace stratégique, durable et inclusif ? » L’IA propose d’abord un panorama structuré (optimisation des flux, planification, résilience, coordination). Puis, « Nous hésitons entre la résilience urbaine et la coordination métropolitaine. Peux-tu développer ces deux axes et nous aider à choisir ? » L’IA entre dans le détail, compare les options et explicite des critères de décision. Et enfin : « Peux-tu combiner les deux axes en t’appuyant sur les procès-verbaux des 131 communes, les PLU et les conseils municipaux, pour dégager des priorités convergentes ? » L’IA passe d’une logique d’inspiration à une co-construction stratégique, avec méthode, priorisation et plan de mise en œuvre.
Ces expériences instaurent un dialogue à trois : entre les participants, le médiateur et l’IA. Les exercices permettent de passer de thèmes généraux à des questions concrètes et situées. Progressivement, chacun comprend que l’IA ne remplace pas les savoirs, mais aide à les reformuler, à les comparer et les mettre en discussion – y compris sur les doutes – pour mieux orienter l’action sur le territoire. La précision des “prompts” [les demandes formulées à l’IA] s’impose comme une compétence collective : plus les questions sont attentives et minutieuses, moins les biais affleurent, plus la discussion s’enrichit. L’art du prompt se révèle un levier d’apprentissage partagé, un outil de co-construction entre expériences vécues et intelligence artificielle.
Usages, limites et conditions
Ce parcours met en évidence plusieurs leviers : la capacité de l’IA à rendre visible la parole minoritaire sans la déformer ; la possibilité de structurer rapidement des idées disparates sans les hiérarchiser à outrance ; et enfin une reconnaissance indirecte, celle de voir ses mots repris, reformulés et intégrés, ce qui renforce le sentiment d’utilité des participants.
Les ateliers ont fait émerger des divergences et des angles morts. Plus les participants prenaient la mesure de l’utilité des outils, plus ils poussaient la réflexion, jusqu’à exiger des arbitrages sur ce que la métropole peut assumer. À plusieurs reprises, la direction du Conseil de développement a dû rappeler le cadre des responsabilités, distinguer ce qui relève de l’expérimentation de ce qui engage la gouvernance (données, éthique, moyens, périmètre d’action). Ce détour a déplacé la discussion de l’émerveillement technologique vers une délibération située sur les usages, les limites et les conditions de déploiement. Sujet complexe, y compris pour les services métropolitains, mais la conversation est devenue plus précise, plus située et plus opératoire, au service d’un agenda d’actions réalistes.
Nous avons alors assumé cette double lecture : l’atelier comme dispositif de test et comme outil d’enquête collective sur les conditions mêmes de l’agir démocratique.
Vers un double gain ?
Au terme de ce cycle, deux acquis se dégagent. D’abord, la commande initiale du Conseil de développement : les recommandations sur l’usage de l’IA dans les politiques publiques métropolitaines seront publiées par la métropole du Grand Paris et chacun pourra consulter les résultats. Ensuite, l’expérimentation a confirmé l’intérêt de l’IA comme accessoire de la participation qui permet d’organiser, de reformuler, de faire apparaître convergences et dissensus, et accélère la production de contenus partageables. L’IA n’est ni acteur politique, ni expert en surplomb, elle n’entre pas dans des rapports de force avec les citoyennes et citoyens, elle n’alimente pas des luttes d’ego entre participants et organisateurs. Disponible et neutre, elle soutient le travail commun sans s’y substituer.
L’enjeu est désormais de mesurer et d’expérimenter la possibilité d’utiliser ce type d’accessoire pour des associations locales et des administrations ancrées dans les territoires, qui connaissent leurs besoins et leur contexte, mais auxquelles manque souvent l’opérationnalisation : clarifier un projet, le présenter à la communauté, préparer des dossiers pour des budgets participatifs ou d’autres financements. Le principe de gouvernance demeure : l’expertise locale et l’intelligence collective, augmentées par des accessoires adéquats.
Nous sommes à portée d’un double gain. Gain de temps : itérations plus rapides, contenus réutilisables. Et gain de compétences : montée en qualité des projets. Sans dénaturer la délibération et en restant ancrés dans les besoins locaux et la connaissance territoriale des habitants.