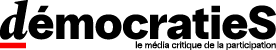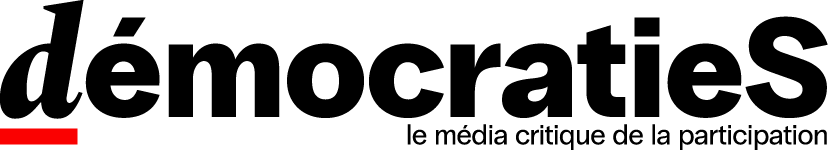Antoine Ancelet-Schwartz
Doctorant en science politique
On ne sait plus où donner de l’oreille, si on veut écouter tous les épisodes du Moment démocratique (podcast porté par un collectif d’une trentaine de structures), des Démocratalks (celui de Démocratie ouverte), de Boulevard de la démocratie (celui de A Voté), de 2026 (celui de Fréquence commune)…. On peut écouter le très bon À la cité, du sociologue Mickaël Chelal. On peut aussi écouter ceux des organisations qui transforment leurs séminaires et conférences en podcasts, comme la Commission nationale du débat public (CNDP) ou l’Observatoire des libertés associatives… Mais aussi ceux des médias qui créent leur podcast spécial démocratie, comme Vie de maire de Ouest France ou Chroniques démocratiques de Radio Campus Paris… À noter enfin les politistes qui se lancent eux-mêmes, comme ceux qui animent Démopratiques… Si on ajoute la possibilité d’écouter tous les replays de webinaires et les chaînes spécialisées, comme MOB le média de la démocratie… il nous faudrait mille vies pour tout écouter !
Tous ces contenus sont originaux, nous apportent des connaissances nouvelles, proposent des points de vue spécifiques ; ils constituent également des archives sonores du débat sur la démocratie, pour le temps présent et à venir.
On peut se réjouir de cette abondance créative. On peut espérer qu’elle forme un écosystème assez important pour que la bataille culturelle pour la démocratie soit menée avec les voies et moyens nécessaires. On peut se dire que la diversité de ces podcasts permet à nos oreilles, attentives à certains contenus ou certaines formes auditives plutôt que d’autres, de trouver les ondes qui leur plaisent. Mais il faudrait pour cela réunir des conditions….
D’abord, que les créatrices et créateurs de ces contenus se parlent. Et se parlent publiquement, pour dire ce qui est voulu dans ces formes, ce qu’il est prioritaire de proposer de mettre en débat. Et écoutent aussi (démarche qui devrait aller de soi quand on veut proposer quelque chose à des gens : est-ce que ça intéresse quelqu’un et qui ?).
Il faudrait ensuite que des moyens soient mutualisés. À quoi bon travailler à la production et à la diffusion de ces contenus dans son coin ? Et lorsque des ouvrages ou des rapports sont publiés, est-ce qu’il faut se battre pour avoir ses autrices ou auteurs en premier, ou plutôt se coordonner pour savoir ce qui assurera au mieux la publicité de ces contenus ?
Il faudrait encore se demander qui la forme podcast touche et qui elle concerne, en se posant la question du langage employé pour raconter nos histoires. Il existe un langage commun pour parler de démocratie entre groupes sociaux différents, on le trouve par exemple dans les Cahiers de doléances de 2018-2019, mais il est peu utilisé dans les podcasts…. Résultat, ces contenus s’adressent le plus souvent à ces “toujours les mêmes” que l’on déplore de retrouver dans toutes nos réunions de dispositifs dits participatifs.
On peut minimiser ces problèmes. Après tout, Gil Scott Heron a sans doute raison, « la révolution ne sera pas télévisée ». Ni baladodiffusée, donc. À moins de se parler et de s’organiser !
Les podcasts ou chaînes YouTube citées dans cette chronique, par ordre d’apparition :
- Le Moment démocratique : https://www.lemoment.org/le-moment-democratique
- DémocraTalks : https://smartlink.ausha.co/democratalks
- À la cité : https://podcastrepublic.net/podcast/1788911190
- Boulevard de la démocratie : https://www.ouest-france.fr/podcasts/boulevard-de-la-democratie/
- Podcast de la CNDP : https://www.debatpublic.fr/le-podcast-de-la-cndp-5913
- Podcast et vidéos de l’Observatoire des libertés associatives : https://libertesassociatives.org/type-ressource/nos-publications/podcasts-et-videos/
- Vie de maire : https://www.ouest-france.fr/podcasts/vie-de-maire/
- Chroniques démocratiques : https://www.radiocampusparis.org/emission/pk1-chroniques-democratiques
- DémoPratiques : https://rss.com/podcasts/demopratiques/
- MOB, le média de la démocratie : https://mob-media.info/
- … et pour une version actualisée de The revolution will not be televised : https://youtu.be/