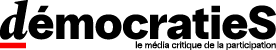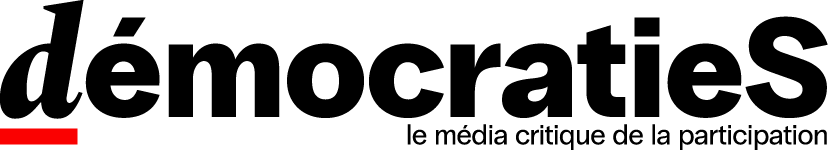Entretien avec
Camille Morio
Juriste spécialisée en droit de la démocratie participative.
Le droit français réserve le pouvoir de décision aux élus et limite fortement l’innovation démocratique. Mais dans les faits, les communes participatives progressent, souvent dans le non-dit.
Dans quelle mesure l’arsenal juridique français permet-il l’innovation démocratique ?
L’innovation démocratique, c’est tout ce qui vise à revitaliser la démocratie en renforçant la place des citoyennes et des citoyens dans le processus de décision [1]. Cela passe notamment par des démarches délibératives ou des dispositifs de démocratie directe. Au regard de cette définition, on constate que le droit limite l’innovation démocratique.
La première raison est que le droit français encadre fortement l’identité des personnes pouvant exercer le pouvoir de décider. Le principe général est celui de la prohibition de l’incompétence négative, expression compliquée pour dire qu’il est interdit à une autorité publique de se défaire de son pouvoir de décision. Dès lors, tout ce qui relève de la démocratie directe est quasiment exclu ou exceptionnel.
La deuxième raison, c’est la frilosité du système politique et administratif à l’égard de la participation. Il a fallu se battre pour que la loi soit issue des représentants de la Nation et non plus du monarque, d’où notre forte culture de la représentation. Il y a aussi une culture de la séparation entre la sphère publique et la sphère privée. L’idée que les pouvoirs publics doivent tenir un rôle central dans la détermination de l’intérêt général, pour éviter la captation par les intérêts privés, marque les relations entre les pouvoirs publics et les citoyens encore aujourd’hui.
Troisième facteur, l’État est décentralisé mais reste unitaire. Les collectivités territoriales ont un périmètre de décision bien délimité. L’État ne les autorise pas à décider la manière dont elles vont prendre les décisions, par opposition à d’autres États, fédérés ou confédérés comme la Suisse ou l’Allemagne. Notre décentralisation à la française est une décentralisation élective plutôt que participative : la Constitution dit que les collectivités territoriales s’administrent librement, mais par des conseils élus (art. 72 al. 3).
Est-ce une spécificité de l’échelon communal ?
Plutôt non. Certes, l’article L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dit que le droit des habitants de la commune à être consultés sur les décisions qui les concernent est indissociable de la libre administration des collectivités territoriales. De plus, la loi prévoit de nombreuses instances participatives dans le bloc local [les communes et intercommunalités]. Toutefois, la jurisprudence ne voit dans l’article L2141-1 qu’une déclaration de principe, sans contrainte juridique. Quant aux instances participatives, la loi ne prévoit que de la consultation très classique, ce n’est pas en soi une innovation.
Les initiatives poussant vers la codécision des élus et des citoyens – en s’inspirant des assemblées mixtes en Belgique, par exemple – parviennent-elles à forcer ce cadre ?
Le cadre juridique proscrit la codécision stricte, mais les expériences délibératives systématisées créent une culture de la participation ; elles ancrent l’association des personnes non élues à la prise de décision publique dans les habitudes de gouvernance. Plus que le droit, cela peut faire évoluer les pratiques politiques.
Le droit est assez binaire dans sa manière de cadrer le monde : les dispositifs sont décisionnels ou consultatifs. Dans la pratique, lorsque la consultation transforme les habitudes de gouvernance, les frontières entre le consultatif et le décisionnel s’estompent.
Une collectivité peut associer systématiquement les citoyens et intégrer leurs propositions, ou contre-propositions, dans les choix publics. Tant qu’elle ne dit pas au début « Je vais suivre le jugement des citoyens », tout en s’appropriant leurs positions à la fin, il n’y a pas de difficulté juridique puisque c’est bien la commune qui aura pris la décision. Le droit n’empêche pas d’instituer dans les faits une forme poussée d’association des habitants à la décision.
Dans les cas de Grenoble et Poitiers, les préfets ont reproché aux élus d’aller trop loin en matière de pouvoir citoyen et ont soumis certains dispositifs participatifs à la justice. Est-ce un signal ?
Ce sont des cas rares, très médiatiques. Les communes concernées vont parfois volontairement à la confrontation. Elles s’en servent de tribune pour faire avancer la cause participative [lire l’encadré ci-dessous].
Il n’y a pas de statistiques accessibles sur le nombre de recours portant spécifiquement sur la démocratie participative, mais il semble improbable que les services préfectoraux exercent un contrôle tatillon. Ils sont notoirement sous-équipés pour cela. De nombreux actes des collectivités passent sous les radars. Et si le contrôle préfectoral s’exerce, cela se traduit par un courrier pré-contentieux ou une lettre d’observation et les communes obtempèrent. Pendant l’année 2024, on discerne une vingtaine de décisions de justice liées à la démocratie participative (hors environnement et urbanisme), un chiffre modeste. Parmi ces affaires, une petite minorité résulte d’une action du préfet, la plupart proviennent de tiers.
S’il n’y a pas un État tatillon, il peut y avoir des préfets tatillons dans certains contextes, encouragés par exemple à surveiller l’action d’un exécutif fraichement élu aux commandes d’une grande ville [2].
Quels sont les effets produits par la multiplication récente de lois sur la démocratie locale et sur les compétences des collectivités ?
La complexité de la répartition des compétences entre les échelons territoriaux fragmente l’action publique, réduit la lisibilité, ce qui freine le développement de la participation. Le droit renforce ce phénomène dès lors qu’il exige que les consultations organisées par une collectivité ne portent que sur ses domaines de compétence. Est-ce bien légitime d’imposer à l’autorité organisatrice qu’elle soit la seule compétente sur le sujet ? Par exemple, une commune concernée ne pourrait pas organiser une consultation locale sur un projet d’autoroute qui passerait sur son territoire, car elle n’est pas compétente pour en déterminer le tracé, alors que le projet a un impact conséquent pour elle et ses habitants. Cette interdiction pose sérieusement question.
Quelle évolution du droit vous parait souhaitable pour la démocratie municipale ?
Le renforcement de la décentralisation est nécessaire pour permettre aux collectivités de gagner des marges de manœuvre sur la façon dont elles souhaitent décider.
Le droit pourrait contraindre davantage à organiser la participation hors des champs de l’environnement et de l’urbanisme. Il gagnerait à prévoir des dispositifs par lesquels les citoyens pourraient déclencher eux-mêmes la participation sur un sujet. On pourrait même imaginer un droit général à la participation.
Sur le déroulement de la participation, le cadre juridique a progressé en se posant en garant de principes démocratiques fondamentaux à respecter [3]. Mais il reste à en assurer l’effectivité réelle, notamment devant les juges. Il reste aussi à fixer un statut du citoyen participant.
Enfin et surtout, sur les suites à donner aux dispositifs participatifs, le droit est défaillant. Il faut introduire des dispositifs décisionnels. La loi pourrait prévoir un certain nombre de choses, mais un changement radical passerait par une révision de la Constitution.
Est-ce qu’on utilise le droit pour ne pas faire de la participation ?
Généralement non, sauf en période préélectorale où le cadre juridique est invoqué de manière excessive pour suspendre toutes les démarches. En fait, il y a simplement quelques grands principes à respecter, les outils participatifs ne devant pas servir de tribune pour un camp politique. La collectivité peut scrupuleusement veiller au pluralisme des positions exprimées. Et un conseil citoyen peut utilement organiser un débat entre candidats. J’essaie toujours de rassurer ceux qui préfèrent mettre en pause les dispositifs participatifs, ou même qui arrêtent d’informer, de communiquer. Ce qui est interdit, c’est la promotion publicitaire de l’action, c’est-à-dire la communication méliorative [qui présente quelque chose de manière avantageuse], mais l’information n’est pas interdite. Ce serait un comble que la participation s’arrête justement dans une période aussi intense en démocratie.
Les communes peuvent-elles créer des groupes de travail ouverts aux citoyens et aux acteurs du territoire ?
Il y a une grande liberté notamment via les comités consultatifs [4] appelés commissions extra-municipales dans le langage courant. Mais ces comités ne peuvent pas prendre la place des commissions administratives, dont le rôle est de préparer les séances du conseil municipal sur des sujets précis [5]. Cela a déjà été essayé, mais c’est censuré par la juridiction administrative. Cela étant, il reste possible de créer des comités consultatifs sur ces sujets : leurs avis ne seront jamais contraignants mais rien n’empêche de les suivre dans les faits.
Le droit va-t-il dans le sens de la démocratisation des intercommunalités ?
Il a institué les conseils de développement, instances de représentation de la société civile organisée qui s’impliquent sur la stratégie de l’intercommunalité [lire l‘entretien avec Marie-Christine Jaillet]. Point méconnu – qui s’appliquera dès le printemps 2026 – la loi Engagement et proximité de 2019 [6] pose l’obligation, à chaque nouvelle mandature, de délibérer sur la manière dont le public et le conseil de développement vont être associés aux choix politiques et à leur évaluation. C’est hors du commun !
Les intercommunalités ne peuvent pas recourir au référendum local ; et il y a une ambiguïté sur la possibilité de mettre en place une pétition locale à leur niveau. Mais elles peuvent imaginer des dispositifs délibératifs poussés : certaines ont organisé des conventions citoyennes ambitieuses. Les intercommunalités ne sont donc pas si verrouillées que cela. Avec les transferts de compétences dans les domaines de l’environnement et de l’urbanisme, elles n’ont d’ailleurs pas le choix. Mais nos gouvernants font parfois marche arrière. Ainsi, le Sénat a adopté un amendement gouvernemental permettant de déroger à l’obligation de créer des conseils de développement. Le texte [7] est en cours d’examen à l’Assemblée nationale.
Propos recueillis par Valérie Urman et Sylvie Barnezet
Combat juridique pour indemniser les citoyens participants
La ville de Poitiers n’a qu’à moitié remporté sa passe d’armes avec le préfet de la Vienne qui lui contestait en justice le droit de verser une indemnité aux participants de la nouvelle Assemblée citoyenne et populaire.
Dans un premier jugement, en mars 2025, le tribunal administratif avait rejeté le recours du préfet et donné raison à la ville en soulignant que rien n’interdisait d’indemniser des citoyens pour leur participation. Huit mois plus tard, en novembre 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux confirme le rejet tout en estimant qu’aucun texte n’autorise l’indemnisation prévue par la Ville : elle invalide une partie de la délibération municipale qui fondait l’indemnité sur la qualité de « collaborateurs occasionnels » octroyée aux membres de l’assemblée citoyenne. Elle considère que les collectivités publiques « peuvent également prévoir que les personnes ainsi associées se voient attribuer une indemnité pour le temps consacré à ces fonctions ».
La position de la cour d’appel de Bordeaux a déçu Ombelyne Dagicour, adjointe à la démocratie locale, à l’innovation démocratique et à l’engagement citoyen de Poitiers, pour qui « cette affaire illustre combien le droit peine à suivre les évolutions démocratiques à l’œuvre dans nos territoires ».